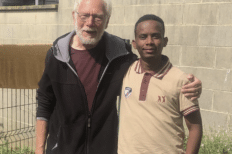Valérie Mirachi : vivre avec l’idée de la mort
Valérie Mirachi : vivre avec l’idée de la mort
Comment vivre en sachant que l’on va mourir ? À toutes les époques et dans toutes les civilisations, l’homme s’est posé cette question. Dans un essai limpide, Philosopher et apprivoiser la mort, Valérie Mirarchi l’examine depuis l’Antiquité grecque.
Publié le
· Mis à jour le
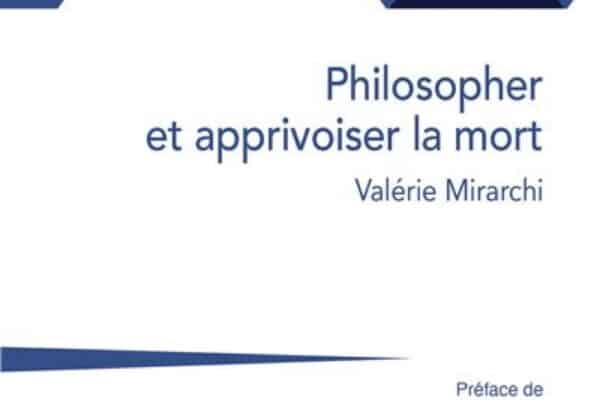
« Le vent se lève ! Il faut tenter de vivre ! » C’est sur ce très beau vers de Paul Valéry que Valérie Mirarchi clôt sa traversée philosophique de l’épopée humaine, de Platon à Sartre et Simone de Beauvoir, examinant comment le rapport à la mort a été envisagé au fil des siècles. « Faire l’expérience de la proximité de sa propre mort future permet de se reconnecter au désir de vivre, d’intensifier sa jouissance de l’existence et, parfois, de réorganiser sa vie pour en changer le cours », constate-t-elle. Ajoutant : « Apprivoiser la mort, c’est peut-être apprendre à vivre pleinement en acceptant nos limites, à transformer l’angoisse en lucidité, et à embrasser l’éphémère comme source de richesse plutôt que de terreur. »
MYTHES ET RITUELS
L’homme est la seule espèce vivante à avoir conscience de sa propre finitude qui se traduit, depuis la nuit des temps, par l’élaboration de mythes et croyances et la mise en place de rituels funéraires qui reflètent son besoin de lui donner un sens, observe l’autrice. Mais que faire de cette « présence paradoxale, à la fois omniprésente et insaisissable » ? À la question : “Peut-on être heureux en sachant qu’on va mourir ?”, ne faut-il pas substituer celle-ci : “N’est-ce pas plutôt la conscience de sa mort qui garantit une vie pleine, en en révélant la profondeur et l’intensité ?”
L’immortalité devient dès lors un leurre, une “fausse bonne idée”, puisque, comme l’écrit le docteur en philosophie Benoît Basse dans sa préface, « rien ne garantit qu’une existence illimitée aurait davantage de signification ». « Nous trouvons intolérable l’idée de notre propre destruction, et pourtant, que ferions-nous de notre vie si nous disposions d’un temps indéfini ? L’éternité risquerait de rendre nos propos insignifiants, nos efforts vains et nos désirs sans but. La finitude, bien qu’angoissante, donne une urgence à nos actions et un sens à nos choix. C’est peut-être parce que notre temps est limité que nous éprouvons le besoin d’agir et de créer. »
LUMIÈRE PARTICULIÈRE
De tout temps, la mort a été un sujet étudié par les philosophes. Les Grecs anciens, qui n’opèrent pas « de distinction claire entre religion et philosophie, entre mythe et raison », l’envisagent comme une composante du réel. Chez Platon, elle n’est pas un « anéantissement », mais une « délivrance » qui permet à l’âme de « monter vers la lumière et revenir à sa patrie céleste ». Elle connaît donc, comme dans les croyances orientales, notamment égyptiennes, « une nouvelle forme d’existence ». Pour Épicure, au contraire, elle est un « phénomène purement physique » qui doit être combattu comme « l’un des principaux obstacles à la joie de vivre ». Il s’agit de vivre comme si elle n’existait pas. Ce que contestent les stoïciens qui la considèrent intégrée à la vie. Il convient alors de « l’affronter lucidement », sans se plaindre, ni s’apitoyer sur son sort. Ces idées vont être supplantées par la promesse d’une vie éternelle du christianisme qui exercera « une influence considérable sur l’Occident ».
Valérie Mirarchi passe en revue une demi-douzaine de philosophes. Montaigne constate que penser à sa mort permet de mieux se connaître soi-même. Pascal est, lui, convaincu que lui faire face est indispensable pour comprendre sa propre condition, considérant, à rebours de Montaigne, que « seule la religion apporte une réponse à l’homme ». Jusqu’à Sartre pour qui, non seulement, la mort ne donne aucun sens à la vie, mais la rend absurde. Pour lui, résume l’autrice, « on vient au monde sans raison et on en part sans plus de raison ».
Michel PAQUOT
Valérie MIRARCHI, Philosopher et apprivoiser la mort, Éditions universitaires de Dijon, 2025.