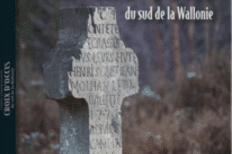Grégory Renard, pionnier belge en intelligence artificielle
Grégory Renard, pionnier belge en intelligence artificielle
Né à Mouscron en 1975, Grégory Renard découvre l’IA en 1996, alors que personne n’y croyait vraiment. De la voix humaine aux premiers assistants vocaux, de la Belgique à la Silicon Valley, ce pionnier discret défend une IA à la fois technique, éthique et profondément humaine.
Publié le
· Mis à jour le

À cinquante ans, le Belge Grégory Renard est l’un des acteurs de l’intelligence artificielle (IA) les plus écoutés d’Europe, aussi à l’aise dans les laboratoires de la Silicon Valley que face aux institutions européennes. Tout a commencé lorsque, enfant, il regarde Goldorak et, surtout, Ulysse 31 qui le fascine. L’ordinateur de bord, cette “intelligence centrale” capable d’aider et de dialoguer, nourrit son imaginaire. À 10 ans, il écrit ses premières lignes de code et, en 1996, tout juste passé la vingtaine, il se plonge dans l’IA, alors réservée à quelques laboratoires et passionnés. Mathématicien de formation et autodidacte en informatique, il traverse le dernier des trois “hivers” de l’IA (qui désignent des périodes de désillusion et de désinvestissement après des phases d’euphorie et d’attentes exagérées), puis lance en 2011 l’assistant vocal Angie et reçoit en 2022 la NASA FDL Merit Award pour ses travaux appliqués en IA aux sciences de l’espace.
Au-delà des prouesses techniques, Grégory Renard plaide pour une IA responsable et profondément humaine. Conscient des risques d’attachement excessif aux machines, il alerte sur la nécessité d’un meilleur encadrement des interactions homme/machine. À travers l’organisation Everyone.AI, qu’il a cofondée, il milite pour la prévention des dérives numériques, la sensibilisation des parents et la formation des enseignants. Son concept de “ceinture de sécurité cognitive” vise à poser des garde-fous sans freiner la recherche. Depuis 2016, il écrit et intervient d’ailleurs sur ces questions d’éthique, participant à des groupes de réflexion internationaux sur la régulation. « Il faut avancer, mais ensemble, en conscience », souligne-t-il. Pour lui, « l’IA n’est pas une menace, c’est le prolongement de l’humain ».
Envie de lire la suite ?
Découvrez nos offres d’abonnement…
Vous aimez le contact du papier ? Vous aimez lire directement sur Internet ? Vous aimez les deux ? Composez votre panier comme bon vous semble !