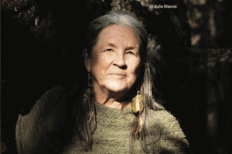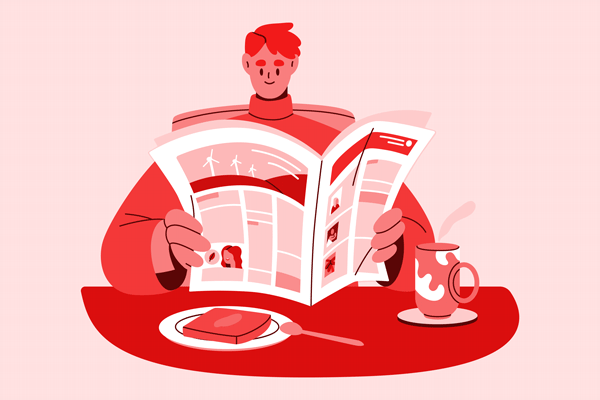Le grand méchant woke
Le grand méchant woke
Féminisme, islamo-gauchisme, décolonialisme, théorie du genre, écriture inclusive, transidentité, cancel culture, appropriation culturelle, intersectionnalité, déconstruction…Autant d’épouvantails présumés saper les fondements de notre démocratie, voire de notre civilisation. Réunis sous l’appellation woke ou wokisme, à qui sont-ils supposés faire peur ?
Publié le
· Mis à jour le
Pas un jour sans que le mot « woke– ne soit jeté dans les médias, tel un anathème. Tantà´t c’est Greta Thunberg, militante écologiste, tantà´t c’est Annie Ernaux, prix Nobel de littérature, qui en font les frais. Hier, c’était une polémique sur le titre d’un roman d’Agatha Christie, sur le déboulonnage d’une statue de Léopold II, sur un baiser non consenti par Blanche-Neige au Prince charmant ; aujourd’hui, on s’écharpe autour du rà´le d’Ariel la Petite Sirène, confié pour la première fois à une actrice noire. La politique n’y échappe pas. En France, le précédent ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, anti-woke, pourfendeur de l’écriture inclusive, des antiracistes et des anticapitalistes, a été remplacé par Pap Ndiaye, historien, spécialiste des Black studies, donc forcément suspect de wokisme.
STAY WOKE, OU LES LUTTES ANTIRACIALES
En Belgique, Georges-Louis Bouchez (président des libéraux francophones) et Sammy Mahdi (président des chrétiens-démocrates flamands) ont clamé leur détestation du wokisme. L’un « parce qu’il accentue les clivages de la société », l’autre parce qu’il perçoit ce mouvement « comme une commode victimisation ». Désormais, chacun est sommé de choisir son camp, délimité par ce fameux vocable, et pour l’observateur·rice lambda, le débat idéologique ressemble de plus en plus à une bagarre entre irréductibles Gaulois.
Pour tenter d’y voir clair, un peu d’histoire s’impose. Le mot « woke– , qui vient du verbe anglais awake, éveillé, a été employé dans un sens militant antiraciste pour la première fois en 1939 par un chanteur de blues, Lead Belly. Martin Luther l’a ensuite utilisé en 1965. « Dans les années 2010 pré-Trump, explique l’historienne belge Marie Peltier, on voit toute une série de minorités s’organiser, manifester, et, pour certaines, se réapproprier la terminologie woke, mais être aussi dis- créditées dans les mêmes termes. » Repris dans le sillage de Black Lives Matter, le mot s’est imposé dans les médias et est devenu viral. En 2016, un documentaire sur ce mouvement s’intitule, justement, Stay woke. On entre dans les années Trump, les clivages s’accentuent, et le « on ne peut plus rien dire » flambe dans le débat public étatsunien.
Si, en France, la polémique met quelques années à s’installer, elle se répand très rapidement. « C’est très frappant, poursuit Marie Peltier : tout le monde désigne les wokes, sans très bien les définir, comme des personnes autoritaristes, qui veulent imposer un diktat. En même temps, ils·elles sont qualifié·es de bisounours. Mais, en général, ce terme est utilisé pour disqualifier les idées progressistes et les luttes sociales : les luttes antiracistes, les idées écologistes, le fé- minisme post-#metoo… toutes les idées progressistes qui ont pris ou prennent de l’ampleur ces dernières années. »
PARANOIA COLLECTIVE
Marie Peltier, qui a beaucoup étudié la question du complo- tisme autour des attentats du 11 septembre, ne peut s’empê- cher de lire les discours anti-woke à l’aune d’une certaine paranoà¯a collective. « L’imaginaire complotiste contemporain est connu pour s’attaquer à deux cibles : la défiance vis-à -vis des institutions démocratiques, accusées de travailler au profit d’une minorité cachée, et le rejet et la haine des minorités. » Toute cette sémantique autour de la culture woke n’y échappe pas, accusant les politiques et les médias d’être à la solde de minorités, qu’elles font passer avec leurs militant·es comme des censeurs, des responsables de rap- ports de domination.
Les exemples font florès, et l’intérêt de chaque polémique réside dans le clivage qu’elle révèle entre deux visions du monde. Prenons, par exemple, Les dix petits nègres, le célèbre roman d’Agatha Christie rebaptisé Ils étaient dix en 2020, l’arrière-petit-fils de l’autrice ayant décidé que ce titre risquait de « blesser ». Le livre, écrit en 1939, utilise le mot « nègre » qui aujourd’hui n’a plus vraiment cours, étant donné ses connotations racistes, esclavagistes et coloniales. En France, une partie de l’opinion a hurlé à la cancel culture, au maccarthysme, bref à la censure. Sait-on que la version américaine avait renoncé à ce terme dans le titre dès 1940, suivie par l’Angleterre… quarante-cinq ans plus tard ? On peut déplorer ce changement et discuter sans fin de l’évo- lution du sens des mots, et de leur charge historique, mais de censure, il n’y eût point : juste une décision éditoriale à caractère commercial.
BLANCHE-NEIGE NON CONSENTANTE
L’affaire récente du baiser de Blanche-Neige convoque le concept de cancel culture, mais aussi celui du consentement, fer de lance du mouvement #metoo. En mai 2021, à l’occasion de la réouverture des parcs Disney aux États-Unis après de longs mois de crise sanitaire, l’opinion publique s’en- flamme autour d’un article qui fait remarquer qu’un baiser donné sans consentement (puisque Blanche-Neige est endormie) ne serait plus acceptable aujourd’hui. La polémique prend des proportions inouà¯es –“ c’est ce qu’on appelle un buzz – et traverse les océans. Pourtant, note Titiou Lecoq sur son blog, aucun appel au boycott de la nouvelle attraction Disney chez les autrices de cet article, qui se contentaient de relever « qu’un vrai baiser d’amour (le titre de la dernière attraction Blanche Neige de Disneyland) peut difficilement être échangé quand l’une des deux personnes est dans le coma et n’a jamais laissé entendre qu’elle était d’accord ». N’est-ce pas la définition même du consentement, ce grand acquis de #metoo ? Ceci dit, personne n’a remis en ques- tion le fait que la première chose que Blanche Neige trouve utile de faire, quand elle découvre la maison des Sept Nains, c’est… le ménage de ces sept vieux garçons.
« J’ai beau chercher, poursuit Titiou Lecoq, je ne vois pas le problème. Mais visiblement il doit y en avoir un puisqu’on parle d’une « polémique– . Ou alors, simplement, je fais unehypothèse : on a remarqué que ce genre de sujet fait du clic. Que dès qu’on met polémique + féminisme + cancel culture, on est certain de faire du trafic et du buzz. Donc on se jette sur le moindre article américain, quitte à le déformer. Ce qui ne serait pas grave si ça ne donnait pas l’impression générale que des hordes de féministes décoloniales veulent interdire la moitié des oeuvres du patrimoine occidental. »
AGIR SUR LES SYMBOLES
L’image qui nous revient des États-Unis peut effrayer. On y parle de guerre des campus, de professeurs licenciés pour un défaut de langage, de terreur académique. « C’est vrai, commente Marie Peltier, les États-Unis se sont fortement polarisés pendant les années Trump, et les groupes militants minoritaires se sont organisés et sont devenus très vindicatifs. Ces groupes sont très présents dans des combats qui portent sur des symboles, avec des effets qui d’ici peuvent paraître disproportionnés : le refus d’une terminologie devenue insupportable, par exemple. C’est un militantisme qui ne se contente plus d’agir dans la vie réelle, mais veut lutter au niveau des symboles. » Ce clivage ne se cantonne pas qu’aux campus, il traverse toute la vie intellectuelle et médiatique américaine. Quant aux campus, n’ont-ils pas été de tout temps le lieu de la contestation intellectuelle ? « Mais que se passe-t-il, en réalité ? Les professeurs, dont on pense qu’ils ont été licenciés par leur hiérarchie sous la pression de minorités, ont en fait démissionné de leur propre chef. Je ne nie pas, cependant, que le débat soit extrêmement dur et virulent, surtout sous Trump ou dans une Amérique post-Trump. Principalement sur des questions fortement symboliques, comme celle du genre. Oui, des professeurs démissionnent. Mais on ne peut réduire cela à « des militants sèment la terreur– . » Marie Peltier, pessimiste, pense que ce climat de violence a déjà gagné l’Europe.
ON NE PEUT PLUS RIEN DIRE
En France, le débat est souvent présenté comme celui des valeurs universelles (républicaines) contre des revendications identitaires, communautaires. Éric Zemmour, comme la polémiste Caroline Fourest, s’en prennent aux wokes, les désignant tous les deux comme une menace majeure pour la République. « C’est vraiment intéressant de constater comme la pulsion réactionnaire les fait se rejoindre. On assiste vraiment à un glissement réactionnaire du débat. Il me semble, analyse Marie Peltier, que la ligne de démarcation se situe aujourd’hui entre réactionnaires et progressistes. Est-ce qu’on pense qu’on ne peut plus rien dire ? Que c’était mieux avant ? Ou pense-t-on qu’il faut aller plus loin dans la défense des droits des minorités ? Le problème est qu’on ne sait plus qui est qui. Les réactionnaires se disent victimes des progressistes et persécutés par eux. On est dans un noeud sémantique, dans une inversion des discours. Les gens par- leront de pensée unique, de politiquement correct… Il suffit d’ ouvrir les réseaux sociaux pour voir qu’ aujourd’ hui, au contraire, on peut dire beaucoup de choses. Par contre, chez nous aussi les minorités s’organisent et se défendent. Il y a des choses qu’on disait il y a vingt ans et qu’on ne peut plus dire maintenant, par exemple les blagues racistes, et je pense que c’est plutà´t bien ! » â–
WOKISME À LA BELGE ?
Le phénomène va-t-il prendre en Belgique, dont la société pilarisée cultive de longue date la culture du compromis ? « Il y a quelques années, j’aurais répondu non, assume la chercheuse belge Marie Peltier, mais je ne le pense plus. Pour plusieurs raisons : le contexte international et la montée des extrêmes droites autorisent la tenue d’un discours populiste décomplexé, chez des politiques comme Georges-Louis Bouchez, par exemple. On est aussi extrêmement contaminé par le débat public français sur des sujets comme la place de l’islam dans la société, cristallisé dans la question du voile. Notre rapport au multiconfessionalisme, qui était historiquement relativement apaisé, laisse place à l’islamophobie. »
Et à part le voile ? « En Belgique, on constate beaucoup de propos anti-écologistes. Il y a une espèce d’obsession à droite, dans un amalgame féminisme/ écologie/islamo-gauchisme. Ce discours est particulièrement virulent chez nous. C’est très destructeur, d’ autant qu’on est dans un petit pays, que tout le monde se connaît, et qu’on a toujours pratiqué la culture du compromis. » Un autre sujet spécifiquement belge est le décolonialisme, incarné par le déboulonnage des statues : « L’État belge, en effet, accuse à cet égard beaucoup de retard dans le travail mémo- riel, alors que les historiens ont fait le travail, et que la demande s’ exprime depuis une vingtaine d’ années. Même la France a reconnu les crimes de la colonisation. En Belgique, il reste un tabou autour de cette question. »
« Aujourd’hui, écrit le sociologue Alain Policar, tous ceux qui remettent en question l’ordre social et poli- tique, qui sont attentifs à la justice sociale, à la condition féminine et à celle des minorités racisées, sont susceptibles de subir l’accusation de wokisme. » Il faut constater que le wokisme, qui n’est pas un mouvement structuré, mais un phénomène, aura imposé un vocabulaire politique et les termes dans lesquels le débat s’inscrit. Son impact, considérable, est déjà comparé à celui de la pensée de Mai 68 en son temps. (D.C.)
Dominique COSTERMANS