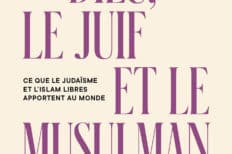Populaires ou élitaires?
Populaires ou élitaires?
Populaires ou élitaires?Septembre 2015. Dans les cours de récré des écoles publiques, il y a désormais un nouveau rang : celui des « ni-ni ». Les enfants qui ne suivent ni le cours de religion ni le cours de morale, en vertu de la déci sion de la Cour constitutionnelle du 12 mars, décrétant que…
Publié le
· Mis à jour le
Populaires ou élitaires?
Septembre 2015. Dans les cours de récré des écoles publiques, il y a désormais un nouveau rang : celui des « ni-ni ». Les enfants qui ne suivent ni le cours de religion ni le cours de morale, en vertu de la déci sion de la Cour constitutionnelle du 12 mars, décrétant que personne ne pouvait obliger les élèves à choisir entre cours philosophiques et de morale non confessionnelle. Les « ni-ni » obtiendront-ils une dispense ? Auront-ils « étude » quand les autres s’appliquent à suivre le programme d’un cours ? Pourront-ils simplement rentrer chez eux ? Le principe de liberté, qui empêche de contraindre au choix, est un des fondements des sociétés démocratiques. Mais ne risque-t-il pas de réduire la clientèle des cours philosophiques et de morale aux (enfants de) « convaincus », tandis que ceux qui le sont moins, ou qui se posent peu de questions, seront davantage tentés par le « ni-ni », moins invasif et impliquant ? Presque au même moment, voilà que l’Église catholique de Belgique remet sur le métier sa manière d’aborder la catéchèse (voir l’Éclairage de ce numéro). Dans un monde qui change, l’accès aux sacrements doit s’adapter, et ne plus être un acte automatique associé à l’arrivée des enfants à l’âge de la communion ou de la confirmation. D’autant que, dans de nombreux cas, l’acte était souvent sans lendemain : la fête passée, combien d’enfants (et de parents) retournaient encore à l’église ?
Dorénavant, les sacrements ne marqueront plus les passages de la vie comme autant d’étapes initiatiques.
Sur le fond, ce changement ne peut être que salué : il redonne du sens à la démarche sacramentelle, et dans une société en perte de repères sur les questions de sens et de spiritualité, il offre aux catéchumènes l’itinéraire qui leur permettra de poser des actes raisonnés.
Reste que le nouveau parcours sera plus long et plus exigeant que les préparations traditionnelles à ce qu’on a continué à appeler la « petite » et « grande » communion… À l’instar du choix entre « rien » et un cours philosophique ou de morale, la catéchèse revisitée continuera-t-elle à attirer ceux qui ne sont pas déjà convaincus ou solide- ment ancrés dans la foi de leurs parents ? Ne risque-t-elle pas d’être délaissée par ceux qui, enfants comme parents, ne sont pas, dès le départ, prêts à l’effort demandé ?
Les cours de l’enseignement officiel et le renouveau catéchétique posent une question à peu près semblable : celle du rapport entre la découverte d’une religion ou d’une démarche de foi et les conditions d’existence de la plupart de nos contemporains. À ne vouloir ou ne pouvoir s’adresser qu’aux « plus forts », les religions se rendent-elles compte qu’elles laissent en route une partie du peuple de Dieu ?
La graine doit-elle dès le départ être plantée dans une bonne terre, protégée du froid et couvée par une bonne serre ? Ou tombe-t-elle où elle veut, poussant et donnant des fruits à condition qu’on l’y aide là où elle se trouve ?
Frédéric ANTOINE