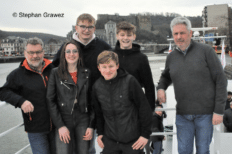Coûte que coûte, ne pas rater.
Coûte que coûte, ne pas rater.
Coûte que coûte, ne pas rater.CB : Révisez vos maths avec Le Soir. » « Aidez votre enfant à réussir ses examens de 6e primaire avec L’Avenir. » « Révise le CEB grâce à ton journal »… La presse quotidienne s’est récemment pliée en quatre pour soutenir ses lecteurs afin que leurs enfants ne ratent…
Publié le
· Mis à jour le
Coûte que coûte, ne pas rater.
CB : Révisez vos maths avec Le Soir. » « Aidez votre enfant à réussir ses examens de 6e primaire avec L’Avenir. » « Révise le CEB grâce à ton journal »… La presse quotidienne s’est récemment pliée en quatre pour soutenir ses lecteurs afin que leurs enfants ne ratent pas leur Certificat d’Études Primaires (CEB). En France, on se mobilise pour le Baccalauréat, qui clôture douze années d’études (cinq de primaire, sept de secondaire). En Belgique, on fait une montagne de la réussite des six années primaires. À un point tel que la presse se sent
« obligée » d’y consacrer de nombreuses pages (et même des suppléments), sûre que l’école n’aura pas été à même de bien préparer les enfants à l’épreuve.
L’an dernier, le taux de réussite à cet examen était de 93%. Aurait-il été moins élevé sans la mobilisation des parents et des médias ? Ou faudrait-il 100% de résultats positifs pour satisfaire tout le monde ?
En secondaire, le projet de « pacte d’excellence » prévoit d’empêcher tout redoublement avant la quatrième année. Le parcours ainsi tracé sera assurément plus cool pour les élèves. Mais comment gèrera-t-on ensuite des jeunes ayant accumulé trois années successives de lacunes dans diverses matières ? La question existe, mais ne paraît pas essen- tielle. Comme si le plus important était désormais, coûte que coûte, de « ne pas rater ». Le rabaissement à 10/20 au lieu de 12/20 de la moyenne de réussite dans l’enseignement supérieur et universitaire, entré en vigueur l’an dernier avec le Décret paysage, avait la même ambition. Les premières analyses des résultats obtenus semblent mon- trer que réduire le niveau de réussite et envisager les études sous forme d’unités capi- talisables a permis à un plus grand nombre d’étudiants de « ne pas rater ». La plupart des profs n’ont en effet pas adapté leur échelle de cotes à l’abaissement du niveau de réussite. Et de nombreux étudiants ont aussi consacré beaucoup de temps à calculer au plus juste le moyen d’éviter l’échec.
Réussir ses études est, parfois, devenu une question de stratégie, comme dans un jeu sur PC. L’essentiel est alors moins de maîtriser un domaine ou un champ de matières que de trouver le moyen d’atteindre le plus aisément le minimum requis. L’enseignement est ainsi, sinon une « école de la réussite », au moins celle du « non- échec ». Mais est-il pour autant devenu une meilleure « école de
la vie » ?
Permet-il réellement à tous ceux qui en sortent de trouver une place satisfaisante au sein d’une société exigeante en termes
d’emploi ?
Éviter l’échec est une bonne chose. Cela permet à l’enfant (et à ses parents) de ressentir face au parcours effectué fierté, satisfaction et valorisation personnelle.
Alors que se déroulent les sessions d’examens, on ne peut que souhaiter le meilleur aux étudiants. Mais il ne faut jamais perdre de vue que la vie n’est pas un long fleuve tranquille, sans écueil ni épreuve. Ne pas réussir à franchir une barrière peut aussi, de temps à autre, s’avérer une expérience, à terme, enrichissante.
Frédéric ANTOINE