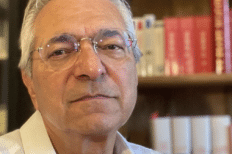En couple, chacun chez soi
En couple, chacun chez soi
Est-il possible de garder les avantages du célibat dans une vie de couple, en laissant de côté les inconvénients des deux situations ? C’est en tout cas le pari que tentent tous ceux qui choisissent de former un couple non cohabitant.
Publié le
· Mis à jour le

Est-il possible de garder les avantages du célibat dans une vie de couple, en laissant de côté les inconvénients des deux situations ? C’est en tout cas le pari que tentent tous ceux qui choisissent de former un couple non cohabitant.
À la quarantaine, après une vie familiale classique, Amandine a eu le coup de foudre pour un autre homme. Ils font le grand saut et entament une nouvelle aventure. Mais les cinquante kilomètres qui les séparent, les impératifs des gardes alternées et les soucis de la vie quotidienne rendent leur relation complexe. Ils choisissent néanmoins de rassembler leurs vies sous un même toit. « Mais la cohabitation, loin de nous unir, commençait à éroder doucement la magie de nos débuts. » Après plusieurs essais de combiner vie commune et indépendance, ils décident de former ce qu’Amandine a baptisé un « célicouple » : chacun son lieu de vie, avec des moments de rencontre le week-end ou un jour de la semaine, chez l’un ou chez l’autre.
Sans taire les difficultés, ils se disent aujourd’hui tous les deux enchantés. « Lorsque les partenaires ne se voient pas tous les jours, chaque rencontre devient un événement spécial. Cette attente peut amplifier le désir et rendre les moments partagés plus intenses et plus gratifiants. » Et ils ne se disputent pas sur des questions de tâches ménagères ou d’autres irritations nées de la routine quotidienne. Amandine Paoli a fait part de son expérience dans un livre à mi-chemin entre le témoignage et le guide pratique pour ceux et celles qui seraient tentés par la formule. Elle y fait également écho aux nombreux échanges et aux réactions recueillies via les réseaux sociaux.
Envie de lire la suite ?
Découvrez nos offres d’abonnement…
Vous aimez le contact du papier ? Vous aimez lire directement sur Internet ? Vous aimez les deux ? Composez votre panier comme bon vous semble !