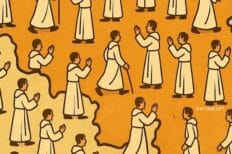BRICS+ : une alternative pour le Sud Global ?
BRICS+ : une alternative pour le Sud Global ?
Selon certains auteurs, cette alliance créée par le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud ne défend pas les pays les plus pauvres de l’ex-Tiers-monde, ou Sud global, qui n’ont guère bénéficié de la mondialisation. Même à la suite de son élargissement en 2014.
Publié le
· Mis à jour le

« Après trente ans d’éclipse liés à l’internationalisation du modèle libéral consécutive à la chute de l’URSS, les pays de l’ex-Tiers-monde s’affirment à nouveau sur la scène internationale. Ce Sud global, expression venue des campus universitaires des États-Unis et utilisée aujourd’hui pour désigner l’ex-Tiers-monde, entend s’affranchir d’un ordre international qu’il considère comme injuste », observe l’historien et sociologue Laurent Delcourt, chargé d’étude au centre tricontinental (CETRI). Et d’ajouter : « Les pays des désormais BRICS+ symbolisent – pour beaucoup – cette révolte du Sud contre cet ordre-là. Mais ils ne peuvent que difficilement s’inscrire dans la filiation du mouvement tiers-mondiste. Car leur alliance n’est pas née d’une volonté commune d’ébranler les fondements du système. D’ailleurs, le terme BRIC a été inventé en 2001 par un économiste de [la banque] Goldman Sachs pour désigner les quatre marchés économiquement les plus prometteurs (Brésil, Russie, Inde, Chine) dans le cadre de la mondialisation. Ce n’est qu’après que ces pays ont peu à peu formalisé leur rapprochement. Cependant, sans remettre en cause la mondialisation et forts de leurs poids démographique, économique et politique, ils militent plutôt pour un meilleur rééquilibrage des rapports internationaux, mais loin de l’ancienne revendication tiers-mondiste, et les nouveaux membres du groupe (Égypte, Éthiopie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et Iran) ne peuvent que difficilement être considérés comme des forces progressistes de changement. Quant à la Russie, difficile de la considérer comme faisant partie de ce Sud global. »
FRACTURES ET DIVISION
Tout comme les pays occidentaux, les BRICS+ ne sont pas toujours sur la même longueur d’onde et constituent une coalition fortement dépendante de la Chine, y compris dans le cas de la Russie. D’ailleurs, analyse encore Laurent Delcourt, « si la Russie et, dans une moindre mesure, la Chine veulent transformer l’alliance en un groupe de solidarité contre-hégémonique opposé à l’Occident, d’autres membres n’envisagent pas cette alliance comme un bloc anti-occidental. Car, bien qu’ils contestent aux pays occidentaux le monopole de la décision sur la marche du monde, le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud veulent garder de bonnes relations avec les États-Unis et l’Europe, qui sont des partenaires de premier plan ». À cela s’ajoutent les persistantes tensions indo-chinoises et les dissensions qui pourraient se développer entre pays autoritaires et pays démocratiques.
Se référant à divers auteurs, Laurent Delcourt explique que les BRICS+ mettent d’énormes moyens à la disposition des pays du Sud, mais selon les conditions qu’ils imposent et à travers une banque de développement aux pratiques pas très différentes de celles d’autres institutions financières internationales et régionales. Il constate ainsi qu’ils « font main basse sur les ressources locales, favorisent l’expansion de leurs champions économiques nationaux, dopent leur propre croissance et trouvent de nouveaux débouchés pour leurs exportations, au risque de compromettre l’industrialisation des autres pays en développement, avec de graves effets sociaux et environnementaux dus aux accaparements de terres et de ressources, à la spoliation des communautés locales, etc. Suscitant la résistance des communautés dépossédées, ils sont à l’origine d’une multiplication de conflits socio-environnementaux comme le montrent les investissements chinois en Amérique latine et ceux du Brésil au Mozambique. »
DÉFENSEURS DU LIBRE-ÉCHANGE
En réalité, « les BRICS n’ont eu de cesse de s’ériger en défenseurs du libre-échange. Dans le cas du Brésil, quel que soit le gouvernement, la libéralisation des échanges agricoles est au cœur des priorités internationales du pays et illustre le poids politique du complexe agro-industriel national à voir comme une composante du vaste réseau d’acteurs transnationaux. ». Et de citer le sociologue William Robinson, pour qui ces acteurs comprennent « des États et des institutions inter et intraétatiques, à travers lesquels les transnationales, les agents politiques et leurs alliés organisent le capitalisme mondial et les conditions de l’accumulation transnationale dans la poursuite de leurs intérêts de classe ou de groupe ». Outre la quasi-absence de critères sociaux et environnementaux encadrant les investissements des pays émergents ailleurs dans le Sud, les BRICS+ montrent peu d’empressement à lutter contre les inégalités chez eux et figurent parmi les principaux utilisateurs des paradis fiscaux, tout en accusant les pays occidentaux d’en faire de même.
En notant que de nombreux pays aspirent à un monde multipolaire qui ne soit plus impérialiste, Laurent Delcourt avance que les BRICS+ risquent d’aggraver les injustices structurelles découlant de la mondialisation. Il relève aussi que plusieurs d’entre eux ont été, ou sont toujours, dans des conflits armés et ont un piètre bilan en matière de démocratie et de droits humains. Voilà pourquoi, selon lui, la gauche du Nord comme du Sud ferait bien de « s’efforcer de bâtir des ponts solides entre les populations en lutte pour leurs droits, contre l’accaparement de leurs terres, l’avancée du modèle extractiviste et les grands projets d’infrastructures. Le salut de l’humanité ne repose pas sur les BRICS+, comme on l’a insinué. Il repose sur la capacité des forces progressistes à jeter des bases d’un nouvel internationalisme qui ne céderait pas aux lectures binaires du monde ».
François POLET, Du “Sud” au “Sud global”, Démocratie, novembre 2023 : revue-democratie.be
POINT DE VUE DU SUD
Prolongeant l’appui qu’il a apporté aux populations du Tiers-monde opposées à la bipolarisation Est-Ouest au temps de la Guerre froide, le CETRI publie depuis 1996, dans la collection Alternatives Sud, des contributions critiques d’auteurs de l’hémisphère sud. Elles portent sur la mondialisation et sur l’évolution des pays en développement ou émergents concernant des enjeux importants, comme la réforme agraire, l’urgence écologique et la militarisation. Chaque numéro s’ouvre par un éditorial de synthèse. Le numéro intitulé BRICKS+, une alternative pour le Sud Global ? paru en mars et introduit par Laurent Delcourt, contient des contributions d’enseignants au Brésil, en Afrique du Sud et en Argentine, d’un journaliste nigérian, d’un chercheur libano-palestinien, d’une militante féministe indienne et d’un militant de Hong Kong. Le numéro suivant sera consacré à l’Inde, dont on peut se demander si elle est encore une démocratie. (J.Bd.)