Dieu n’est pas partial : que ta joie demeure !
Dieu n’est pas partial : que ta joie demeure !
À la veille des élections belges et européennes, progressent dangereusement les populismes et idéologies identitaires qui confisquent la complexité du réel, de la pensée, de l’identité.
Publié le
· Mis à jour le

En juin, vont se tenir les élections européennes, fédérales et régionales, puis en octobre les communales. Dans une Europe que certains qualifient de “passoire”, d’autres de “forteresse”, mais qui demeure pour beaucoup une terre d’espérance, la montée des populismes et des idéologies qui pensent l’identité sur le mode de l’exclusion de l’autre doivent nous alerter. Ces dynamiques, toujours simplificatrices, se fondent sur la dichotomie entre “nous” et “eux”, sur le registre du pur et de l’impur. Elles proposent une conception de l’identité certes enracinée, mais aussi fermée, immobile, reposant sur un “avant” mythique qui serait valable de toute éternité.
UNE IDENTITÉ EN TENSION
Ces positions confisquent la complexité du réel, de la pensée, de l’identité. Or, s’il y a bien une chose que l’étude de la Bible nous enseigne, c’est que la pluralité des traditions qui la composent fait droit à l’élaboration d’une identité personnelle et croyante qui tient ensemble l’enracinement, la contestation et l’ouverture.
Comme l’écrit Antoine Nouis dans son ouvrage, Nos racines juives, la structure du Premier Testament témoigne d’une compréhension de soi qui repose sur « l’assurance de sa tradition » (la Torah, ou les cinq premiers livres de la Bible), la contestation (c’est la tradition prophétique qui déconstruit la fondation quand elle s’enferme sur elle-même et oublie ce qui la fonde) et les “autres écrits”, tels les Psaumes, Proverbes ou le livre de Job qui correspondent à une « identité d’universalisation qui entre en dialogue avec les autres cultures et s’enrichit de leurs apports ».
Dans l’Évangile de Jean (15,9), Jésus demande à ses disciples de « demeurer dans son amour ». Cela signifie que nous n’avons pas à susciter ou conquérir cet amour, mais à l’accueillir, à l’habiter. Face aux dilemmes de l’existence, aux choix personnels, sociaux ou politiques auxquels nous sommes confrontés, il s’agit de toujours se demander : quelle est la solution qui fait grandir la vie chez ceux et celles qu’elle touche ? Quel est le choix juste, respectueux, non discriminant qui témoigne de cet amour dont Dieu nous aime et qu’il nous appelle à transmettre ? L’appel de Jésus à demeurer dans son amour est enraciné dans une tradition plus ancienne que l’on trouve dans le livre du Deutéronome (6,5) : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. »
PAS DE “DÉLIT DE FACIÈS”
Dans le livre des Actes (10, 34), Pierre déclare : « Maintenant, je comprends vraiment que Dieu n’avantage personne : tout être humain, quelle que soit sa nationalité, qui le respecte et fait ce qui est juste, lui est agréable. » Le terme utilisé en grec, prosopolemptes, est construit à partir du terme prosopon qui désigne le visage ou le masque que portaient les acteurs de théâtre, et qui se traduit par « personne », et le verbe lambano qui signifie « prendre ». Littéralement, Dieu « ne regarde pas à la face ». Cette expression particulière vient de la Septante, la plus ancienne traduction grecque de la Bible hébraïque. Elle signifie l’impartialité et l’incorruptibilité de Dieu. Dieu ne regarde ni aux origines ni aux apparences ; pas de “délit de faciès” – si j’ose dire – pour Dieu !
À travers ces deux exemples, et peut-être particulièrement la figure de Pierre, se jouent la complexité et la richesse de l’identité croyante : la capacité d’habiter l’amour de Dieu avec persévérance dans les diverses situations de nos existences. Et celle, aussi, de laisser bouleverser nos constructions humaines et nos tentations de replis par l’inattendu de l’Esprit qui déploie au large nos cœurs et nos intelligences.
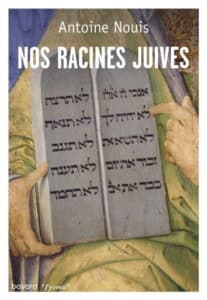
Antoine NOUIS, Nos racines juives, Paris, Bayard, 2018. Prix : 16,70€. Via L’appel : – 5% = 15,87€.
Laurence FLACHON, Pasteure de l’Église protestante de Bruxelles-Musée (Chapelle royale)



