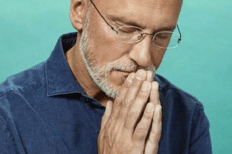Encore des pratiques cléricales
Encore des pratiques cléricales
À quasi un an du synode des évêques qui traitera des pratiques de gouvernance des communautés chrétiennes pour l’avenir de l’Église catholique, des pratiques d’un autre temps font réagir. Comme à Cour-sur-Heure, dans le diocèse tournaisien.
Publié le
· Mis à jour le

Le pape François a présenté le cléricalisme comme une maladie qui affecte toute l’Église catholique. Pourtant, des manifestations de celui-ci sont relevées dans différents pays, dont la Belgique. Par exemple, les mesures prises en mai dans le diocèse de Tournai par le nouveau prêtre référent des clochers de l’entité communale Ham-sur-Heure et Nalinnes, « en étroite collaboration avec le chanoine doyen » et dans le cadre de l’Unité pastorale Sambre et Heure, ne vont pas dans le sens de la synodalité. Au sein de plusieurs paroisses, et bien au-delà, elles sont au contraire apparues comme un retour au cléricalisme.
MATINÉES DE FORMATION
Ces mesures ont spécialement touché les membres d’un groupe se réunissant à Cour-sur-Heure. Cette communauté attire depuis plusieurs années de nombreuses personnes de la région de Charleroi voulant réfléchir à la manière de vivre et d’annoncer la Bonne Nouvelle au sein de la société actuelle. Elle a été créée à l’époque où le prêtre référent dans cette localité était le père dominicain Bruno Delavie, proche du regretté théologien Jacques Valléry. En compagnie de laïcs, il avait mis sur pied, de manière autonome, de riches matinées de formation avec des conférences sur l’humanisation de la société et des débats réunissant des intervenants aux multiples compétences et parcours. Ces rencontres attiraient de nombreuses personnes venant des communes avoisinantes et aussi d’ailleurs.
Sont venues se greffer des célébrations eucharistiques qui se sont poursuivies avec l’abbé Jean-Marie Georgery, après le décès du père Delavie en 2018. Des assemblées dominicales en l’absence de prêtre (ADAP) se sont tenues, avec des partages d’Évangile et de textes divers. Alors que, selon l’équipe presbytérale de l’Unité pastorale, « le diocèse ne réserve ce type de célébration que pour des raisons exceptionnelles, puisque l’hospitalité eucharistique entre clochers doit être privilégiée ». Et lors des périodes de confinements, le groupe avait proposé des célébrations en ligne vues au-delà des frontières. Il avait aussi relayé celles du Prieuré de Malèves-Sainte-Marie.
POUR DES “MESSES CATHOLIQUES”
Après avoir, au nom du doyen, remercié pour son service l’abbé Georgery, le nouveau prêtre référent a mis fin à la mission de ce dernier à Cour-sur-Heure. Il a ensuite immédiatement annoncé que, « à partir du 14 mai 2022, aucune célébration eucharistique ou aucun événement d’aucun genre (répétition, conférence, prière, projection, récital, expositions…) ne doit avoir lieu dans l’église ou en son nom sans ma connaissance et ma permission ou celles de mes supérieurs [le doyen, l’évêque et ceux qu’ils délèguent]. »
Suivaient des précisions sur le déroulement de la “messe catholique” : l’imposition des trois lectures proposées par l’Église, le choix entre le symbole des apôtres ou celui de Nicée-Constantinople pour le Credo et l’introduction et la conclusion de l’homélie par le célébrant. Et aussi une des quatre prières eucharistiques complètes, l’usage d’un calice, d’une patène et d’un ciboire incassables, ainsi que la distribution de la communion. Tandis que des modalités pouvaient être discutées pour la prière universelle, les offrandes, l’introduction du Notre Père, le geste de paix et la prière d’Action de grâces.
REPROCHES ET SOUTIENS
Peu après, l’équipe presbytérale a communiqué que « deux prêtres seulement portent la responsabilité des vingt-trois clochers de trois entités communales », aidés par deux prêtres retraités et deux étudiants. Elle a en même temps reproché au groupe de Cour-sur-Heure de célébrer « non pas des ADAP, mais bien des ‘messes’ en absence de prêtre » et expliqué que, selon elle, ce groupe avait décidé de s’en aller. « Personne ne peut répandre le bruit qu’il a été mis à la porte », affirme-t-elle, ajoutant « qu’il est étonnant et paradoxal qu’un groupe de baptisés refuse énergiquement l’eucharistie qui leur est proposée, en communion avec toute l’Église ».Cependant, lors d’un des rares contacts tenu avant les confinements sanitaires, le doyen avait dit à ce groupe considéré comme expérimental, et qui devait être évalué : « Je ne peux pas vous empêcher de faire ce que l’on vous demandera de faire dans cinq ans ».
De son côté, l’évêque de Tournai, Mgr Harpigny, a félicité les acteurs de l’Unité pastorale pour leur souci de faire connaître de multiples aspects de la vie et de la mission de l’Église, tout en ajoutant : « Nous ne sommes pas là pour renforcer un club qui essaie de survivre. » Ces propos d’un évêque connu pour prôner le dialogue avec les musulmans ont suscité des réactions supplémentaires parmi les membres dudit “club”, mais aussi dans la région et bien au-delà. Tout en se donnant un temps de réflexion, ils ont reçu un grand nombre de soutiens et d’invitations à continuer leurs activités.
POUR UNE AUTRE FAÇON DE FAIRE ÉGLISE
Alerté par son confrère Ignace Berten, le frère dominicain Mark Butaye a écrit de Bruxelles qu’à un moment où le pape François appelle tous les fidèles à s’exprimer et à s’engager dans un processus synodal, « il est incompréhensible qu’une initiative construite pendant des années soit supprimée d’un seul trait de crayon, sans concertation, sans dialogue et sans la moindre ouverture pour chercher une solution humaine et religieusement valable. De telles interventions autoritaires et cléricales se présentent malheureusement partout. Certaines autorités ecclésiales ne savent apparemment pas vivre une certaine diversité de rites, les fruits de la nouvelle théologie et d’expressions personnelles de la foi. L’universalité de l’Église est encore trop souvent comprise comme uniformité. Le dialogue reste un instrument certes difficile, mais valable. Il mérite d’être exploité aussi loin que possible. Car l’Église ne gagne rien si elle crée des oppositions et, pire, des exclusions ».
Le bulletin de Pour un autre visage de l’Église et de la société (Pavés) a indiqué dans le même sens que le père jésuite Paul Mayence avait, lui aussi, fait le lien entre l’événement vécu douloureusement par le groupe de Cour-sur-Heure, qu’il appréciait, et la préparation du synode sur la gouvernance dans les communautés chrétiennes. En souhaitant voir grandir les germes qui annoncent une nouvelle façon de faire Église. Il rejoignait ainsi les propos tenus par feu son confrère Paul Tihon dans sa contribution Synodalité : renverser la perspective, disponible sur le site internet de L’appel.
Jacques BRIARD