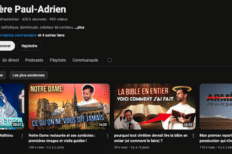Grandeur et petitesse
Grandeur et petitesse
“Pris les doigts dans le pot de confiture”, “Pris la main dans le sac”, “Pris en flagrant délit”… Ces expressions évoquent le fait d’être surpris au moment même où l’on s’adonne à une activité plus ou moins coupable…
Publié le
· Mis à jour le

C’est ce qui arrive aux disciples quand Jésus leur pose la question : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » (Marc 10, 33-34) Ils se taisent parce qu’ils étaient en train de « discuter entre eux pour savoir lequel était le plus grand ». Ils se sont tus, déjà, quand Jésus a annoncé sa mort pour la deuxième fois. Ils ne comprennent pas parce qu’ils reconnaissent en Jésus le Messie et qu’un Messie ne peut tout simplement pas être mis à mort dans leur univers de pensée. Peut-être aussi qu’ils ne veulent pas comprendre, qu’ils ne veulent pas envisager la possibilité de perdre celui auquel ils sont attachés. Le poète Ovide écrivait : « Nous sommes lents à croire ce qui fait mal à croire. » Bien que “en chemin” physiquement, les disciples sont “à l’arrêt” intérieurement. Ils ne veulent pas entendre et ils se concentrent sur leur propre aspiration à la grandeur.
UN AVEU D’INSÉCURITÉ
Mais se poser la question « qui est le plus grand », n’est-ce pas un aveu de faiblesse ? Ou, en tout cas, un aveu d’insécurité ? Car si l’on accepte nos forces et nos faiblesses, on a peut-être moins besoin de se comparer avec d’autres. Mais qu’est-ce que la grandeur, qu’est-ce que la petitesse ? Le fort, est-ce celui qui a besoin d’écraser les autres ou celui qui sait retenir l’usage de sa force pour faire une place à l’autre ? Est-ce celui qui éblouit par son intelligence et sa culture sans cesse mises en avant ou celui qui sait reconnaître les talents de l’autre et choisit de se taire pour l’encourager à les exprimer ? Et le “petit” ne doit-il être que protégé ? N’est-il pas destiné à grandir ?
Jésus prend en compte l’aspiration des disciples à devenir “grands” : « Si quelqu’un veut être le premier… » Ces questions un peu gênantes qui témoignent d’un ego bien (trop) développé, qu’elles soient posées ! Jésus ne nie pas les aspirations et les désirs humains. Mais il réoriente radicalement les critères et les objectifs de la grandeur : être le premier s’exprime dans le service de tous, pas dans la domination, pas dans le nombre de like ou de followers. Et le service est une catégorie dynamique qui met en œuvre la foi et l’espérance, ce n’est pas la serviabilité servile ni la simulation de la petitesse. Ce n’est pas non plus le fait de rendre service jusqu’à se plier sans cesse aux désirs des autres, jusqu’à en oublier ses propres désirs, besoins et limites.
L’ÉGLISE COMME LIEU DE DÉPLOIEMENT
L’Église ne pourrait-elle pas être ce lieu où l’on s’exerce à devenir grand en devenant serviable et non égocentrique ? Ce lieu qui donne l’opportunité de développer des talents et de se sentir utile ? Un espace « où il doit être donné à chacun la chance d’interpréter la gratitude d’exister et l’occasion de montrer “qui” il ou elle est, de quoi il ou elle est capable », comme l’écrit Olivier Abel, dans son Commentaire du texte de l’Évangile de Marc (site de l’Oratoire du Louvre) ? Se développer, oui, mais se développer autrement.
Et, en même temps, l’Église peut être un lieu qui, comme le dit Olivier Abel, nous autorise à diminuer. Car si tout est pensé dans notre société pour que nous soyons toujours plus grand et plus fort, la chute quand vient l’échec, la maladie, la retraite, la vieillesse est très dure. « L’arc de nos existences complètes doit être pensé tour à tour comme désir de grandir et de se montrer, et comme désir de diminuer et de s’effacer. Faire place aux autres, aux nouveaux venus, aux générations montantes, les approuver d’exister, les autoriser à leur tour à se montrer, quoi de plus beau ? », écrit encore le philosophe.
Grandir et faire grandir, accepter de diminuer et embrasser la vulnérabilité, recevoir le Christ et être son envoyé…
Laurence FLACHON