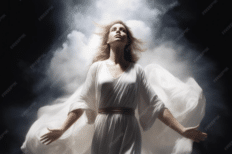Inaction féconde : une riche vie intérieure
Inaction féconde : une riche vie intérieure
Dans un monde du travail stressant et ultra connecté, faire place à des temps d’intériorité devient difficile, mais nécessaire. Expériences et réflexions.
Publié le
· Mis à jour le

Au monastère des Bénédictines d’Hurtebise, près de Saint-Hubert, les personnes souhaitant y faire un séjour sont nombreuses et bienvenues. Elles ne viennent pas pour du tourisme dans la région, mais bien pour une retraite ou une expérience de retour sur soi, de ressourcement spirituel, sans nécessairement partager la foi des religieuses. Selon Sœur Marie-Raphaël, responsable de l’accueil depuis plus de vingt ans, la plupart ressortent heureuses de ces quelques jours d’éloignement de la vie ordinaire. « Au bout parfois seulement de 48 heures, beaucoup nous disent qu’ils en sortent requinqués, apaisés », confie-t-elle.
Durant ces journées, place est faite à la prière, aux offices religieux pour ceux qui le désirent, dans le contact avec la belle et vaste nature environnante. Toutefois, quelques-uns décrochent et abandonnent rapidement et repartent. Se retrouver face à soi-même peut être angoissant. Certains retraitants ont des difficultés aussi à se déconnecter d’internet, des écrans, de leur smartphone dont l’usage est devenu pour beaucoup largement addictif. « L’intériorité, c’est parfois le lieu d’un combat, également pour moi, reconnaît la religieuse. Quand j’ai une demi-heure de libre, la première chose que je me demande, c’est ce que je vais faire. Mais je me dis alors : “Non, ne fais rien, sois juste là.” Même moi, moniale, je trouve que c’est difficile. On essaye d’éviter de se retrouver face à soi-même, de fuir les questionnements qui pourraient surgir. »
UN CERTAIN ART DE VIVRE
Cette existence a ceci d’original que, cinq fois par jour, les religieuses se retrouvent à la chapelle pour des offices religieux, soit deux heures et demie par jour. S’y ajoutent trente à soixante minutes de lecture et de méditation individuelle des Écritures saintes. Le temps, ici, est bien structuré dans un équilibre entre le travail, les prières communautaires et la méditation personnelle. « La vie monastique a peut-être pour mission de rendre compte d’un certain art de vivre et que chaque chose vient en son temps, souligneSœur Marie-Raphaël. Si ce mode de vie ne peut être adopté tel quel dans la vie ordinaire, il peut être source d’inspiration.
Les penseurs, depuis l’antiquité, ont réfléchi à la place du travail et à celle de l’inactivité pour arriver à une certaine sagesse. Blaise Pascal (1623-1662) écrivait : « Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » Il notait aussi que l’homme a besoin de divertissement pour échapper à l’idée qu’il est mortel. Les artistes ont également illustré les dérives du travail abrutissant. Charly Chaplin, dans Les temps modernes (1936), a remarquablement illustré celui en usine à la chaine, Charlot passant ses journées avec comme unique mission de serrer les boulons d’une machine. Si, aujourd’hui, le travail a changé, il reste problématique dans le système capitaliste. Celui-ci produit quantité de biens dans une incitation permanente à la consommation, combinée à un recours addictif à la communication numérique et à l’information à portée de main.
UNE VIE CONTEMPLATIVE
Cette révolution anthropologique alarme nombre de penseurs contemporains. Ils s’inquiètent de cet activisme sans garde-fou où le cerveau est sans cesse sollicité. Certains, même dans la simple marche de détente, en font une affaire de performance, sans lâcher prise, mesurant avec un podomètre les distances qu’ils parcourent quotidiennement. Le philosophe allemand d’origine coréenne Byung-Chul Han est devenu une figure majeure reconnue dans son pays et, de manière plus large, en Europe. Professeur dans plusieurs universités, auteur d’une vingtaine d’ouvrages traduits en une dizaine de langues, il est très critique sur les dérives de nos sociétés.
Après Société de la fatigue et Société de la transparence, il vient de publier Vita contemplativa ou de l’inactivité où il relève que, pour beaucoup, l’existence humaine n’est vécue que sous l’angle du travail et de la performance. L’individu perd le sens et la valeur du temps libre, de la vie contemplative. Le penseur distille tout au long de l’ouvrage ses fines observations paradoxales, telles celles-ci, à goûter lentement : « Le mutisme approfondit la parole. Sans silence, il n’y a pas de musique. La vraie vie commence au moment où cesse le souci de la survie. Le vrai bonheur nait de ce qui n’a ni but ni utilité. Le sommeil et le rêve sont des lieux privilégiés de vérité. Nous n’avons pas la patience de l’attente au fil de laquelle quelque chose pourrait murir lentement. Seule l‘inactivité nous initie au mystère de la vie. »
ODE A LA PARESSE
Certains auteurs louent même les mérites de la paresse, mère de tous les vices selon la morale traditionnelle. Dans le film Alexandre le bienheureux, Philippe Noiret a campé de manière savoureuse un paysan qui, après la mort de sa femme, décide de se la couler douce et reste dans son lit. Il profite du temps qui passe, joue de la trompette et trouble l’ordre social du village. Plus sérieusement, Paul Lafargue (1842-1911), journaliste, économiste, homme politique socialiste, et gendre de Karl Marx, s’est rendu célèbre en écrivant, en 1880, un essai intitulé Le droit à la paresse. Il y fustige les conditions de travail épouvantables des ouvriers en usine, notamment des enfants. Son contemporain, l’écrivain Jules Renard (1864-1910), note, dans un registre plus poétique : « Il ne faut pas croire que la paresse soit inféconde. On y vit intensément comme un lièvre qui écoute. On y nage dans l’eau mais on y sent le frôlement des herbes du remords. Il y a dans la paresse un état d’inquiétude qui n’est pas vulgaire et auquel l’esprit doit peut-être ses plus fines trouvailles. »
Sur un mode ironique, mordant et plein de saveur, l’écrivaine Lydie Salvayre, Prix Goncourt 2014 pour Pas pleurer, propose dans son nouveau livre, Depuis toujours, nous aimons les dimanches, une ode au bonheur de ce jour de repos, et plus largement à l’art de vivre. « Après le confinement, explique-t-elle au téléphone, il m’a semblé qu’il y avait de la part de sérieux chercheurs en sciences sociales une réflexion sur le mal être dans le travail qui est une vraie question. Il y a une surdité à ce sujet de l’appareil politique qui chante plus que jamais la valeur du travail des… autres. Je me souviens de mon père qui était maçon, qui est mort très tôt. Il revenait le soir. Il était exténué. Il y a des travaux qui vous brisent prématurément et c’est toujours d’actualité. »
Une certaine paresse peut offrir le temps de regarder le monde, de méditer, et surtout de penser. Les meilleures idées viennent quand on lâche prise, notamment lorsque l’on se promène. Les propositions de Lydie Salvayre sont multiples : marcher, admirer un tableau, écouter de la musique, faire la fête, danser, rire, toutes ces choses qui ne répondent en rien aux lois du marché, de la rentabilité, de l’efficacité et qui font le sel de la vie. « Nous aimons nous vouer, relève-t-elle, à ce qui nous console, fortifie, nous répare et parfois nous fait mal, à ce qui nous questionne et parfois nous meurtrit, à ce qui nous intrigue, nous élève, nous ravit, nous rassemble et nous rend pleinement présents aux autres et à nous-mêmes. »
À la manière des moralistes des XVIIe et XVIIIe siècles, la romancière s’amuse à écrire : « La paresse d’être méchants fait de nous des êtres tolérants, la paresse de se battre fait de nous des cléments, la paresse de riposter à la bêtise nous évite les aigreurs stomacales, bref la paresse est l’autre nom de la sagesse. »
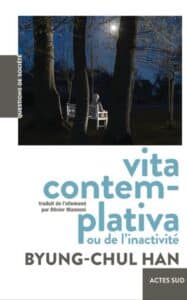
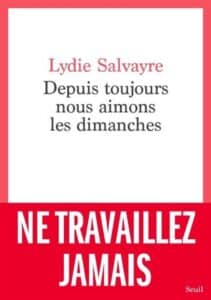
Byung-Chul HAN, Vita contemplativa ou de l’inactivité, Arles, Actes Sud, 2023. Prix : 17€. Via L’appel : – 5% = 16,15€.
Lydie SALVAYRE, Depuis toujours nous aimons les dimanches, Paris, Seuil, 2024. Prix : 16,50€. Via L’appel:-5%=15,68€.
Gérald HAYOIS