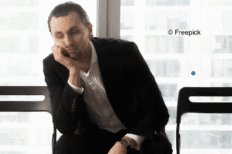Jeanne Benameur : « Chaque jour, je tisse des liens avec le monde»
Jeanne Benameur : « Chaque jour, je tisse des liens avec le monde»
Née en 1952 en Algérie, d’un père tunisien musulman et d’une mère italienne catholique, l’écrivaine Jeanne Benameur a passé son enfance à La Rochelle où son père organisait des rencontres œcuméniques. Elle a publié de nombreux recueils poétiques, pièces de théâtre et romans, parmi lesquels « Profanes », « Ceux qui partent » ou, l’an dernier, « La patience des traces », qui ont conquis un cercle de lecteurs touchés par sa grande sensibilité humaine et spirituelle.
Publié le
· Mis à jour le

— Depuis quelque temps, vous séjournez souvent en Crète. Un besoin de recul par rapport à la France ou de retrouver l’ambiance méditerranéenne de votre prime enfance ?
— Il y a les deux. C’est un endroit où je me mets un peu en retrait. J’y passe environ cinq mois par an. J’y trouve une grande paix dont j’ai besoin pour écrire.Je découvre aussi la culture crétoise, j’apprends le grec pour pouvoir parler avec mes voisins du village. Mais ce n’est pas par hasard que j’ai choisi de séjourner ici. La première fois où je suis arrivée, j’ai vraiment ressenti un profond bien-être, comme si je rentrais chez moi. C’est dû à la lumière, à la terre un peu aride, aux montagnes, à la mer, aux gens. Je retrouve une manière d’être au monde très ancienne, comme lorsque j’étais petite fille en Algérie. Le corps ne ment pas. J’ai retrouvé tout de suite une énergie physique qui me porte beaucoup ici. Je tisse des liens avec le monde. C’est comme cela que je vis chaque jour.
— Quelques mots sur votre milieu familial, dans les années 50 en Algérie, avec des parents très contrastés.
— Oui, vraiment. Mon père était d’origine tunisienne et ma mère, une blonde aux yeux bleus originaire du nord de l’Italie, dans la région de Vicence, à côté de Venise. Mes parents, en plus, n’étaient pas de la même religion : l’un était musulman, l’autre catholique. Cela ne les a pas empêchés de fonder une famille de cinq enfants.
— À 5 ans, en 1957, vous quittez précipitamment l’Algérie. Vous découvrez la France, La Rochelle, près de l’océan, où vous passez votre jeunesse. Comment s’est déroulée votre intégration dans ce monde nouveau ?
— Cela s’est fait presque tout seul. Mon père avait un poste de directeur de prison, nous n’avons donc pas connu de difficultés sociales ou économiques. Suite à la guerre d’Algérie, aux violences, aux menaces, il avait demandé sa mutation d’urgence, et il l’a obtenue. Je suis allée à l’école pour la première fois en France, mais ma mère m’avait déjà appris à lire et à écrire, et je me suis trouvée avec des petites camarades françaises. L’intégration s’est faite par l’école. Je pense que ça a été plus difficile pour mon frère qui avait 14 ans en arrivant et ma sœur 18. Pour eux, il y avait vraiment un nouveau pays à intégrer. L’école a été mon viatique, j’ai plongé dans les études avec bonheur. J’aimais et j’aime encore étudier. À 13 ans, je suis entrée au Conservatoire d’art dramatique et cela a aussi facilité mon intégration. Les textes de théâtre qu’on devait étudier à l’école me transportaient.
« J’ai la passion d’être au service de quelque chose qui me dépasse, me tient, mais que je ne nomme pas. »
— Quelle langue parlait-on à la maison ?
— On était dans les années soixante, le souhait de mon père était l’intégration totale. Il fallait qu’on parle français à la maison. Ma mère n’avait pas le droit de nous parler italien. Elle le faisait quand même lorsqu’on était très petit. Elle chantait les chansons italiennes qui me restent dans l’oreille. Seule exception : mes parents parlaient arabe entre eux quand ils ne voulaient pas qu’on les comprenne et qu’ils avaient des discussions qui ne regardaient pas les enfants. L’arabe a été la langue dans laquelle j’ai baigné toute petite enfant. Dans la ville algérienne où nous habitions, les gens le parlaient majoritairement. Tous ces sons sont entrés en moi, et les rythmes, la musique, la sonorité de ces langues différentes me portent encore aujourd’hui. Mes parents avaient des cultures très différentes et cela a donné cette famille très singulière.
— Vos parents ont essayé de vous transmettre une religion particulière ?
— Ils avaient une grande ouverture d’esprit, ce dont je les remercie immensément. Par exemple, mon père faisait venir à la maison le prêtre catholique du quartier de La Rochelle où nous habitions, le pasteur protestant, le rabbin qui était son meilleur ami et ils discutaient ensemble des textes sacrés. Ces réunions œcuméniques étaient initiées par lui. J’y ai assisté enfant. On a du mal à imaginer cela aujourd’hui. Il nous apprenait des prières musulmanes et ma mère les catholiques, mais je n’ai pas eu d’éducation religieuse, de catéchisme. J’entends encore la voix de mon père qui disait : « Peu importe qu’on l’appelle Allah ou Dieu, ça n’a aucune importance. L’essentiel, c’est de croire. » C’était un homme de foi. De temps en temps, parce qu’ils ne pouvaient pas s’en empêcher, lui ou elle me demandait : « Tu fais bien ta prière le soir… ? » Sous-entendu : celle que je t’ai apprise… Je récitais toutes celles qu’on m’avait apprises avant de m’endormir, et c’était long. J’ai mis beaucoup de temps à m’autoriser à être libre à ce propos.
— La question du rapport à la spiritualité est largement évoquée dans vos livres. Dans Profanes, l’un de vos protagonistes dit : « J’ai la passion d’être au service de quelque chose qui me dépasse, qui me tient, mais que je ne nomme pas. »
— Oui, je peux le dire moi-même. C’est souvent vrai dans la nature, face à certains paysages. Cette sensation me bouleverse quelquefois. Je n’appartiens à aucune religion, mais je me donne le droit au sacré, à adhérer à quelque chose de plus grand que moi, qui me porte et que j’essaie d’atteindre. Dans mon dernier livre, La patience des traces, je tente aussi de faire sentir ces instants d’âme.
— Vous êtes en lien avec une communauté particulière ?
— Non, mais en Crète, je vis dans un pays où la religion orthodoxe est très importante, présente dans le quotidien. Les gens ici sont extrêmement religieux. À Pâques, j’ai assisté à la messe des ténèbres et des lumières. J’étais très émue par cette ferveur.
— Vous écrivez aussi dans Profanes : « Trop de réponses dans les religions. »
— Ce qui me dérange, pas seulement dans la religion, mais aussi en économie, en philosophie, en politique, ce sont les gens bardés de certitudes, de dogmes. Je suis une femme de doutes et de recherches. J’ai plus des convictions que de certitudes. Par exemple, j’ai la conviction qu’il se passe quelque chose de mystérieux dans ces moments où le corps, l’âme et l’esprit vibrent ensemble. Je sais reconnaître alors une joie intime que j’éprouve et qui me porte. Je sais ce qu’est cette expérience, sans en faire un dogme pour les autres.
« La vie est pleine de hauts et de bas, mais il n’y a pas de tragédie inscrite pour toujours. »
— Une autre citation : « Il n’y a pas de maître, pas de fils de Dieu, pas de prophète, rien que des hommes et des femmes, des profanes. Mais le sacré, le vif de la vie, il est bon, il est bien au cœur du profane et moi, j’ai besoin d’y aller. »
— J’assume ces phrases que j’ai écrites. Je voudrais souhaiter aux gens de sentir le vif de la vie. Ceci dit, je vous dirai aussi que les Évangiles font partie de mes lectures récurrentes. C’est là aussi que je retrouve généralement la plus grande simplicité avec la vie.
— Vous avez aussi suivi une psychanalyse. Que vous a-t-elle appris ?
— Que j’étais une personne semblable aux autres ! Au début, suite à mon histoire au tout début de ma vie, où j’ai connu la violence et la guerre, j’étais convaincue que je n’étais pas, que je ne pouvais pas être comme les autres. La psychanalyse m’a appris à sortir d’une espèce de tragédie personnelle pour aller vers quelque chose de plus universel. J’ai compris à la longue que la vie est pleine de hauts et de bas, mais qu’il n’y a pas de tragédie inscrite pour toujours. On peut avoir connu des drames et jouer néanmoins sa partie, à condition d’être entouré d’autres personnes, nos semblables. Je me suis débarrassée du poids de la tragédie, quand même très lourde, et de la violence historique vécue dans ma famille et qui nous a pénétrés. Mes parents ont été aussi très marqués par cela.
— En lien avec la guerre d’Algérie… ?
— Ils ont connu la guerre 40-45 et ensuite celle d’Algérie. Ce fut très difficile pour mon père qui était vraiment entre deux camps. On a subi des attaques violentes. Mon père était alors jeune et je pense qu’il ne s’est jamais remis de tout cela. Il est mort quand j’avais dix-neuf ans. Il y a eu ce deuil-là aussi. Il fallait que je m’en sorte et que je retisse des liens avec le monde. J’ai aimé ces séances chez le psychanalyste, cette aventure tellement merveilleuse de pouvoir être ce qu’on est avec quelqu’un qui en est témoin, qui ne juge pas, qui entend, et on n’en meurt pas. Cette écoute m’a beaucoup aidée.On y va parce que notre vie en dépend. Quand on arrive à tisser ce lien avec un psychanalyste, cela permet effectivement de voir les choses avec une distance que l’on n’a pas lorsqu’on est collé à l’événement. Je crois beaucoup aussi au temps long qui permet petit à petit de changer de regard. Cela ne modifie pas ce qu’on a vécu, ce que nous sommes, mais permet de mieux “faire avec”. Ceci dit, la psychanalyse n’est pas une baguette magique.
— Vous avez suivi des études de lettres et été enseignante, avant de devenir écrivaine. Écrire, c’est votre manière majeure d’être au monde ?
— Écrire, c’est ma colonne vertébrale, ma façon de nouer des liens avec le monde et les autres. Pour y arriver, j’ai besoin d’un temps de retrait intérieur, de silence, de solitude. Je ferme les écoutilles. Quelque chose se passe alors. J’essaie d’aller le plus loin possible à l’intérieur pour atteindre ce qu’il y a de plus universel pour tous les hommes et femmes, les uns avec les autres. Il faut traverser les strates de l’ego. C’est avec cela que j’écris. Il serait bien prétentieux de dire que j’y arrive, mais j’essaie.
— Dans vos romans, on découvre souvent des personnages qui sont dans des moments de changement de cap. Vous aimez creuser ces situations où des personnes sont à des périodes charnières ?
— J’aime bien creuser la situation de crise au sens premier du terme grec, qu’on peut traduire par le mot décision. C’est à dire l’heure où quelque chose va ou doit changer dans nos vies. J’aime bien m’arrêter à ces moments-là, même s’ils semblent très douloureux. C’est de là que viennent nos belles métamorphoses.
— Vous avez aussi animé des ateliers d’écriture en prison…
— Il m’arrive encore d’y aller, mais moins qu’avant. Je demande alors que ces ateliers soient également ouverts aux gardiens qui en ont autant besoin que les détenus. Leur métier est très difficile, et si on veut humaniser le milieu carcéral, cela passe aussi par eux. Je me suis beaucoup intéressée à cette façon qu’avaient les sociétés de se débarrasser de personnes qui avaient commis des délits en les mettant entre quatre murs. Ce n’est sans doute pas la meilleure des choses qu’on puisse faire. Il y a bien sûr des gens qu’il faut isoler, mais mettre le tout-venant dans des promiscuités épouvantables, cela n’aide pas à reconstruire qui que ce soit.
— Qu’est-ce qui vous semble navrant et, à l’inverse, vous met en joie au quotidien ?
— Ce qui est navrant pour moi, c’est de voir des ignorants qui ne cherchent pas à sortir de leur méconnaissance. J’entends parfois de leur part des propos très réducteurs sur d’autres personnes et, la plupart du temps, cela vient d’une ignorance profonde de ce que vivent celles dont ils parlent. Cette ignorance est bien assise sur sa chaise et ne veut pas en bouger. Cela m’énerve beaucoup et fait des ravages dans la société. Ce qui me meten joie au quotidien,ce sontdes petites choses extrêmement simples. Ce matin, je m’occupais des plantes dans le patio et le jasmin exhalait un parfum merveilleux. Un paysage peut me mettre en joie, une conversation, simplement regarder les gens. Quelquefois, je me mets à une terrasse de café et je regarde le monde qui passe près du port. Ce sont des choses très, très simples.
— Une page, un visage, un paysage… ?
— Oui, on peut dire cela… Et la voix de mon fils si je l’ai au téléphone. Ah oui, cela me met en joie.
Propos recueillis par Gérald HAYOIS