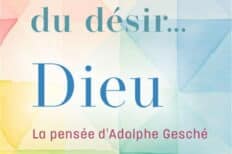Jeunes en hôpital psychiatrique
Jeunes en hôpital psychiatrique
L’augmentation du nombre de jeunes atteints de troubles psychiques suite à la covid a attiré l’attention sur une réalité qui reste souvent dans l’ombre. Que vivent ces jeunes et leurs parents ?
Publié le
· Mis à jour le
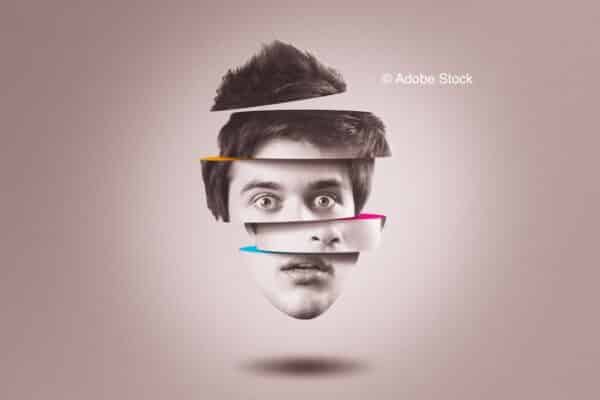
Troubles de la personnalité, dépressions, tendances suicidaires, automutilations, décrochage scolaire ou social… : les jeunes ne sont pas à l’abri d’une maladie mentale et des problèmes psychiatriques. Cette réalité souvent occultée provoque un certain malaise parce qu’elle reste associée aux représentations de la folie diversement acceptée ou gérée socialement selon les époques. Pourtant, d’après UNICEF Belgique, 16,3% des adolescents de dix à dix-neuf ans en Belgique sont atteints d’un trouble mental, bien sûr d’une intensité et d’une gravité variables. Pour traiter ces difficultés psychiques, il est parfois nécessaire de recourir à une hospitalisation dans une unité psychiatrique, dans le meilleur des cas spécialisée en psychiatrie infanto-juvénile.
L’IMPACT DE LA COVID
Au début de la pandémie, les préoccupations se sont orientées vers le traitement des personnes atteintes de la covid et vers les mesures de prévention des contaminations. C’est ainsi que les écoles ont été fermées pendant plusieurs semaines, puis ont fonctionné selon des régimes mêlant cours à distance et présence dans les murs. Ce n’est que petit à petit que les services de santé mentale ont constaté les dégâts provoqués chez les jeunes et ont sonné l’alarme. Les demandes d’admission en service psychiatrique étaient en effet en train d’exploser.
La pédopsychiatre Sophie Maes, responsable du Centre hospitalier de l’ULB Le Domaine, à Braine l’Alleud, évoque cette augmentation : « Au sein de l’unité que je dirige, nous avons quinze lits pédopsychiatriques dévolus aux thérapies institutionnelles pour adolescents. Les hospitalisations durent en général deux à trois mois. Au sein d’une unité de quinze lits, le turnover est en général de cinq nouveaux patients par mois. Or, en janvier 2021, avec cinq nouvelles admissions mensuelles disponibles, l’unité a dû faire face à quatre-vingts nouvelles demandes d’hospitalisation ! Par la suite, la demande de soins continuera d’être extrêmement soutenue pendant des mois. Cette situation est générale sur tout le territoire belge et européen. »
Toutes ces demandes d’hospitalisation recouvrent selon les cas des difficultés, soit préexistantes qui ont pris une dimension critique, soit provoquée par les mesures de distanciation sociale. Pour les adolescents et les jeunes, en effet, l’échange avec leurs pairs est essentiel à leur développement et une ressource importante pour réagir aux aléas de l’existence.
ET LES PARENTS ?
Si la santé mentale des jeunes mérite toute l’attention de la société, le vécu de leurs parents est lui aussi souvent très difficile. Éva Kavian, autrice belge d’origine namuroise, évoque leur quotidien dans son dernier roman L’Engravement. Elle compare les jeunes qui échouent dans les unités psychiatriques à ces baleines qui sont capables de se suicider en s’échouant sur une plage. « Mais il semblerait plutôt que ce soit le bruit du monde, le bruit de notre monde moderne, qui perturbe leur outil de navigation, de communication, puis pousse leur stress à un paroxysme ingérable », pense-t-elle. Belle image pour décrire les jeunes en mal-être psychique.
Quant à leurs parents, qui viennent leur rendre visite selon des horaires stricts, elle les décrit comme un troupeau se dirigeant en silence vers l’entrée : « C’est la première fois que tu rejoins le troupeau, tu ne regardes pas ceux qui t’entourent, tu es la seule à souffrir. Tu arrives devant la terrasse. Mira n’y est pas. Tu ne regardes pas non plus les baleines, rien ne te concerne que ton enfant, ta petite, qui a voulu mourir. »
Les parents d’enfants admis en unité psychiatrique ont à gérer pas mal d’émotions et de sentiments. La honte d’avoir un enfant “chez les fous”. La difficulté parfois de trouver un service adéquat ou qui accepte de l’accepter. La culpabilité de se sentir peut-être responsable de ce qui lui arrive. Le poids du regard des autres. Les sentiments contradictoires lorsque l’enfant manifeste vis-à-vis d’eux une violence verbale ou physique. Les questions ou la révolte face aux traitements administrés : un jeune assommé de calmants parce qu’il a frappé sa mère lors de la dernière visite, un autre placé en isolement parce qu’il a fait une tentative de suicide. « Nous avons une approche comportementale. Nous ne pouvons accepter les passages à l’acte. Si un patient dépasse les limites acceptables, il va en section fermée. S’il met sa vie en danger, il va en isolement. En isolement, les contacts avec l’extérieur sont exclus », écrit Éva Kavian.
Le parent reçoit le message du psychiatre et n’a alors qu’à rentrer chez lui sans avoir pu voir son enfant, emmenant le linge sale, qui sent peut-être l’urine, dans le bus qui le ramène vers le reste de la famille qu’il a bien fallu délaisser… Et puis il y a toutes les questions pour l’avenir. L’avenir immédiat quand un enfant peut rentrer à la maison après une hospitalisation et que ses parents sont inquiets et se demandent si cela va bien se passer. Mais aussi, à plus long terme, lorsque l’on annonce par exemple qu’un jeune de vingt ans pourrait peut-être se stabiliser vers ses trente-cinq ans et avoir une vie « à peu près normale ».
DES RECOMMANDATIONS
Unicef Belgique s’est préoccupé de la situation de ces jeunes et a recueilli leurs témoignages. Près de cent cinquante enfants et adolescents entre six et dix-sept ans hospitalisés en unités pédopsychiatriques de jour ou résidentielles ont décrit leur quotidien, leurs blessures, leurs espoirs. Ils ont très souvent derrière eux « un parcours de vie difficile qui les a déjà mis en contact avec de nombreux intervenants. Les hôpitaux pédopsychiatriques ne sont qu’un maillon de la longue chaîne qui comprend les secteurs de la santé mentale, de l’aide à la jeunesse, de la police et de la justice, et aussi, au plus proche de l’enfant, des secteurs de l’éducation, de la jeunesse et des loisirs, de l’aide sociale. Les enfants et les jeunes qui se retrouvent à l’hôpital pédopsychiatrique souffrent de détresse psychologique, de dépression, de difficultés familiales, de décrochage scolaire, de mises en danger, de dépendance, de manifestations psychotiques, d’obésité, etc. Certains jeunes cumulent aussi des mesures judiciaires ordonnées par un tribunal de la jeunesse et des troubles psychiatriques plus sévères. »
S’ils sont dans leur grande majorité reconnaissants envers les soignants, ils souffrent de la représentation de l’institution psychiatrique : « Je n’aime pas l’image de l’hôpital à l’extérieur. J’ai l’impression de ne pas être normale. Je n’ose pas en parler, je ne dis pas que je suis ici », confie une fille de quinze ans. Ils aimeraient que leur parole soit davantage entendue, dans le monde extérieur d’abord, mais aussi à l’hôpital : « Si on nous écoutait, cela permettrait aussi que les internements soient plus chouettes. » Ils regrettent par exemple de ne pas avoir assez de temps pour eux, pour jouer. Ils souffrent du peu de contacts avec l’extérieur et avec la famille. Ils se plaignent aussi de la rigidité de certaines règles à l’intérieur de l’institution. Ils pensent aussi à la prévention. Ils aimeraient des lieux sûrs près de chez eux pour partager leurs sentiments et leurs pensées avec d’autres jeunes ou avec des adultes de confiance. Cela éviterait selon eux certaines crises.
UNICEF Belgique reconnait qu’un important travail de réforme des soins de santé mentale a été fait depuis dix ans. Néanmoins, le coup de projecteur sur la problématique provoqué par la crise sanitaire devrait être l’occasion de rediscuter des moyens accordés à ce secteur et d’écouter les points de vue de tous les acteurs, afin d’améliorer les prises en charge.
José Gérard
Eva KAVIAN, L’engravement, Lille, La Contre Allée, 2022. Prix : 18€. Via L’appel : – 5% = 17,10€.