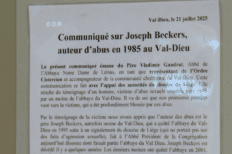La fabrique des saints : une prérogative papale
La fabrique des saints : une prérogative papale
La “saintologie” est très loin d’être une science exacte. Le Vatican ne publie pas de bottin des saints. Il y aurait aujourd’hui entre deux mille et deux mille cinq cents candidats en attente de béatification, dix fois plus qu’il y a un siècle. À y regarder de plus près, la sanctification apparait comme étant (aussi) un enjeu politique et économique.
Publié le
· Mis à jour le

Les lecteurs assidus des romans policiers de l’autrice britannique Ellis Peeters connaissent fort bien le Frère Cadfaël, ce moine bénédictin gallois, ancien croisé vivant au Moyen Âge. Il est herboriste, cultive son jardin de simples, tout en accompagnant le shérif du comté local dans ses enquêtes. Au cours de l’une de ses aventures, il a été amené à élucider un crime dans une affaire de trafic de reliques. Depuis toujours, la possession de ces objets représente une immense source de prestige et draine la générosité des croyants. Les reliques enrichissent considérablement les églises, et les monastères et monarques ont intérêt à en posséder de prestigieuses. C’est, par exemple, le cas de Conques, étape particulièrement appréciée sur le chemin de Compostelle.
Déjà, avant le Moyen âge, la vénération d’un saint qui semble proche et complice, avec lequel on peut s’entretenir et exposer ses tourments, semble être la meilleure des consolations. « Ainsi, en fabriquant certains saints, en en “recyclant” d’autres, et en valorisant, en authentifiant les reliques, les églises sont devenues fabuleusement riches », relate Augustin Mohrer dans un ouvrage récent, La fabrique des saints.
MÉDIATEURS PROCHES
Afin de comprendre cette évolution, il est nécessaire de revenir aux débuts de la chrétienté. Le christianisme n’a connu son essor que dans les premières décennies du IVe siècle, soit près de trois cents ans après la mort du Christ. La Palestine est alors sous domination romaine et l’Empire romain possède ses propres dieux. Cependant, le père Robert Godding, jésuite bollandiste – un groupe d’érudits qui se livrent à une étude critique et historique des saints du monde entier – nuance ce propos. Selon lui, dès le IIe siècle, les martyrs sont honorés à la date de l’anniversaire de leur mort. Le premier d’entre eux est saint Polycarpe. « Les saints, explique-t-il, sont centraux dans le christianisme. Ils sont des médiateurs proches pouvant intercéder pour chacun. Ils assurent à chaque génération que le message de l’Évangile est reçu et annoncé dans une société en constante évolution. »
Vers la fin du IIIesiècle, Constantin I procède à de nombreuses réformes politiques, économiques et religieuses. Il établit notamment, au moins de manière théorique, la liberté de culte individuel. Le christianisme, dès lors, peut se développer et ainsi remplacer les croyances anciennes. En 312, l’empereur décide d’en faire une religion d’État et convoque le premier concile à Nicée. À la suite de cette assemblée, le christianisme devient une religion d’obédience politique ne faisant qu’un avec le pouvoir. Il lui faudra faire évoluer son dogme et ses pratiques au fil des changements économiques et sociétaux, ou, du moins, tenter de le faire. Conserver des éléments du passé en les rendant compatibles avec le dogme chrétien.
INITIATIVE PAPALE
Après Nicée, aux IV° et V° siècles, il revient à l’Église, avec l’aide des moyens financiers de l’État, de remodeler la spiritualité de l’empire afin de faire accepter à l’ensemble de la population ses nouvelles conditions d’existence. Ainsi, au fil de l’histoire, les saints vont occuper une place importante dans la vie des chrétiens. Progressivement, leur culte s’élargira à d’autres catégories : les ascètes, les ermites, les vierges, les veuves, les évêques, les pasteurs de communautés chrétiennes, etc.
La canonisation, au sens moderne du terme, apparaît autour de l’an mil. Ce n’est plus seulement la dévotion des fidèles régulée par l’évêque du lieu qui est à l’origine du culte rendu à certains chrétiens. Le pape, déjà consulté dans les siècles précédents, se réserve la responsabilité de déclarer qui est saint et peut être vénéré comme tel. Et, précise le père Godding, « la première canonisation papale surviendra lors du concile de Rome pour consacrer saint Ulric d’Augsburg. Ensuite, le pouvoir pontifical se renforcera aux XIIe et XIIIe siècles. Le pape sera le seul à canoniser vu son caractère (devenu) universel. De plus, une cause n’est pas l’autre et certaines, d’ailleurs n’arrivent pas au bout. »
TROIS CRITÈRES
Trois critères sont pris en compte : l’orthodoxie, l’exercice héroïque des vertus évangéliques, les miracles accordés par l’intercession du saint. En fait, le Vatican détient le pouvoir absolu pour faire aboutir ou non les causes en béatification et canonisation. Le temps de l’automaticité des “élévations”, qui a été longtemps la règle, est définitivement caduc. Outre une politique de pression sur le long terme pour mettre en place le dossier – et surtout assurer son suivi-, plaider la cause d’un saint nécessite dès lors des coûts importants. Arrive donc le temps de la diplomatie et des groupes d’influence. Du lobbying, autrement dit. Il faudra attendre le concile Vatican II pour voir édictées de nouvelles procédures concernant le déroulement des raisons de béatification et canonisation. Imposant des équilibrages subtils pour respecter la sensibilité des nombreux groupes de personnes “concernées” : fidèles, congrégations et ordres religieux, prélatures diverses, etc.
Cette équation a gagné en complexité car elle a été accompagnée d’une volonté constante d’ouvrir de nouveaux espaces d’influence. Plus problématique encore s’est révélée être la tendance à intégrer davantage de laïcs dans les candidats aux béatifications et canonisations, notamment en raison de difficultés procédurales et financières. « Même si, précise le père bollandiste, le pape François a pris des mesures très concrètes afin de fixer un plafonnement des coûts de procédure. »
BESOIN ET NÉCESSITÉ
On peut malgré tout, estimer, par exemple, que l’étude d’une cause pourrait avoisiner les cent mille, voire cent cinquante mille euros. Deux mille dossiers sont actuellement en cours d’analyse.« Ces opérations, note Augustin Mohrer, pourraient engendrer une dépense de l’ordre de deux à trois cents millions d’euros. »
Le travail du “postulateur” chargé de la “positio”qui sera étudiée par les théologiens de la congrégation des causes des saints est d’une grande complexité. Son dossier peut, parfois, atteindre quelque quinze mille pages, pour aboutir à une analyse finale, en latin, qui pourrait en comporter au maximum cinq cents, et prendre jusqu’à une douzaine d’années. « La forte dépendance des saints aux éléments économiques, politiques et sociaux semble donc être le reflet d’un besoin, d’une nécessité. Le besoin, la nécessité créent le saint », conclut Augustin Mohrer.
Michel LEGROS
Augustin MOHRER, La fabrique des saints, Neuilly, Atlande, 2021. Prix : 19€. Via L’appel : – 5% = 18,05€.