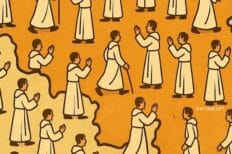L’exorciste de la synagogue
L’exorciste de la synagogue
Pressé, Marc ? Peut-être est-il poussé par les questions qui traversent son Évangile de part en part : « Qu’est-ce que c’est ? », « Qu’est-ce que cela veut dire ? », « Qui est-il ? »
Publié le
· Mis à jour le

Oui, tout va vite chez saint Marc qui apparaît comme le plus pressé des quatre évangélistes. Rien qu’au premier chapitre, si on serre le texte de près comme le fait la traduction de Chouraqui, les “vite” se succèdent à cinq reprises en l’espace de quelques versets : « Vite, ils laissent leurs filets et le suivent. » (18) ; « Vite, il les appelle. » (20) ; « Vite, il entre dans la synagogue. » (21) ; « Vite, il y a dans leur synagogue un homme au souffle contaminé. » (23) ; « Vite, sa renommée sort partout dans le pays. » (28)
Et dans ce texte rapide et plein d’interrogation, du début à la fin, des réponses surgissent sur les lèvres les plus étranges, du démon de la synagogue au centurion romain : « Tu es le Saint de Dieu. » (1,24), « Vraiment, cet homme était le fils de Dieu. » (15,39)
L’AUTORITÉ DU SILENCE
Quel brouhaha dans la synagogue de Capharnaüm, tendue entre le silence et le cri. Un homme, soudain, se met à vociférer. Un“possédé”, parce qu’il n’est plus en possession de lui-même, colonisé, occupé depuis que quelqu’un s’est installé de force dans son territoire intérieur. Son propre souffle lui échappe. Alors, il crie comme tous ceux qui sont exclus de leur parole originelle : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? De quoi te mêles-tu ? Tu es venu pour nous perdre, c’est cela ? »
Nous perdre. C’est que l’homme parle au nom de beaucoup, comme plus loin, au chapitre 5, quand un autre possédé sorti des tombeaux répond : « Mon nom est Légion, car nous sommes en grand nombre. » (5,9) C’est une constante chez Marc, dès la Tentation au désert : Jésus est appelé à combattre l’aliénation représentée par Satan, celui qui décrète comment adorer.
Que le jeune Nazaréen se lance dans une séance d’exorcisme en pleine synagogue n’a rien d’étonnant ni d’exceptionnel. Cela faisait partie du “métier” de rabbi, comme en atteste largement la littérature hébraïque. Mais ici, il y a la manière. Face aux cris, Jésus ne crie pas. Il impose et il s’impose : « Tais-toi ! » « Et le démon sort en vociférant. » L’autorité du silence entre deux grands cris.
REPRENDRE POSSESSION DE SOI
Ainsi, dès le tout premier chapitre de son Évangile, Marc, dans un texte très construit, esquisse déjà une réponse qu’il ne va cesser d’explorer à partir de sa grande question initiale : « Qu’est-ce que cela veut dire ? » Réponse où les versets 22 et 27 dialoguent autour d’un seul mot : autorité. Oui, mais laquelle ? Le passage en question n’en donne qu’une définition négative : « Pas comme les scribes. » Pas une autorité de répétition, mais d’invention, d’imagination. Car c’est bien cela chasser le démon : reprendre possession de soi, oser dire “je”, s’élargir, s’agrandir, comme le laisse si bien entendre l’étymologie du verbe augere : augmenter, autoriser, inaugurer.
Éternelle question de si brûlante actualité, et dont parlait un jour, à la radio de Berlin, le théologien protestant allemand Dietrich Bonhoeffer, le 1er février 1933. Il y était question de l’homme devant Dieu, « libre et responsable à la fois », et de « l’autorité dernière ». Une autorité « détruite », commente Bonhoeffer, « là où l’autorité du chef (Führer) ou de la charge sont vues comme les autorités dernières ». L’émission fut brusquement interrompue et Bonhoeffer pendu par les démons du nazisme quelques années plus tard. Qu’est-ce que cela veut dire ? « Un enseignement neuf ! », où chacun, ose devenir auctor, auteur de sa propre parole.
Gabriel RINGLET