Luc de Brabandere : la philo, une vraie joie de penser
Luc de Brabandere : la philo, une vraie joie de penser
« Je suis un prof de gym des idées », déclarait Luc de Brabandere dans une interview donnée à L’appel en octobre 2008. Ce que ce philosophe d’entreprise de 77 ans, passionné par la pensée et la créativité, n’a jamais cessé de confirmer, notamment à travers son cycle d’ouvrages “Petite philosophie de…”. Après les histoires drôles, les erreurs quotidiennes, les mots espiègles, les arguments fallacieux ou les algorithmes sournois, il s’intéresse aujourd’hui aux catégories inévitables.
Publié le
· Mis à jour le
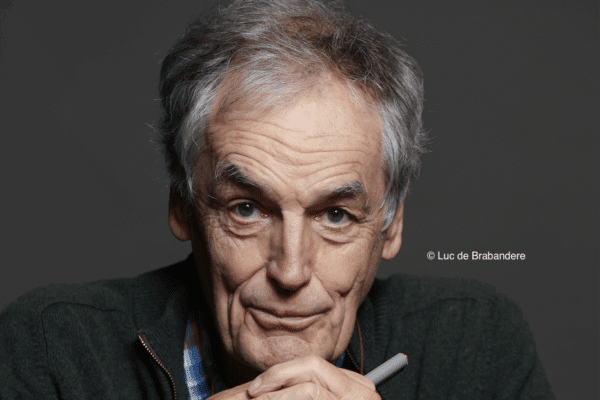
— En 1989, vous publiez Le Latéroscope, un ouvrage dont vous dites qu’il a changé votre vie. En quoi ?
— Il s’agit de mon deuxième livre et c’est à ce moment-là que j’ai transformé ma passion en métier. J’ai toujours aimé la créativité, et quelqu’un m’a dit un jour : « Au fond, Luc, tu n’es pas un ingénieur créatif, tu es quelqu’un de créatif qui a fait des études d’ingénieur. » Cela m’a marqué. Si, d’un côté, c’était une bonne nouvelle car je voyais clairement ce que je voulais faire, et je le fais encore aujourd’hui, d’autre part, je n’étais nulle part dans le métier de la créativité. Alors, je suis retourné à l’école et j’ai fait neuf ans de philosophie. Le Latéroscope est le moment où je me suis dit : voilà, je ne mets plus la technologie en avant, mais la manière de penser, et cela ne m’a plus jamais quitté.
— En quoi penser pourrait changer le monde ?
— Il faut bien distinguer deux choses : changer le monde et changer la façon de voir le monde. Copernic n’a pas changé le système solaire, mais notre manière de le regarder, et il s’agit d’une révolution. Ce sont deux métiers différents : le premier est dans la pensée, la perception ; le second est dans l’action, le changement des choses. Un de mes crédos est : changer, c’est changer deux fois. Par exemple, pour quelqu’un toujours en retard, qu’est-ce que changer ? Devenir exact. Et pour y arriver, un double changement est nécessaire : dans son organisation – moins de réunions, mieux prévoir… – et modifier sa perception de l’exactitude et ainsi découvrir qu’être à l’heure est très agréable. Penser est l’outil pour changer sa perception des choses, mais, en tant que tel, penser ne change pas le monde.
— Vous avez beaucoup écrit sur l’intelligence artificielle (IA). Que pensez-vous de son développement exponentiel et sans doute incontrôlé ?
— Je pense qu’il s’agit du sujet le plus important de notre temps puisque l’IA intervient dans la guerre, l’économie, l’éducation, la santé ou chez les enfants. La première chose à faire est de remettre le mot intelligence au pluriel. Il y a deux cents ans, au moment où l’on a inventé le quotient intellectuel, il était au singulier. Être intelligent, c’était être bon en mathématique. Après la guerre, un mouvement important est né : les intelligences multiples. Il est alors question d’intelligences relationnelle, émotionnelle, artistique, spatiale… Plus il y en a, mieux c’est. Aujourd’hui, à cause de la technologie, le mot est remis au singulier. Or il faut parler des intelligences artificielles ou d’une parmi d’autres.
Envie de lire la suite ?
Découvrez nos offres d’abonnement…
Vous aimez le contact du papier ? Vous aimez lire directement sur Internet ? Vous aimez les deux ? Composez votre panier comme bon vous semble !




