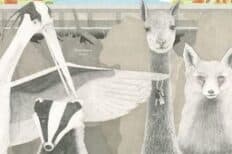Pour une approche historico-critique de l’islam
Pour une approche historico-critique de l’islam
Comment enseigner une approche “historico-critique” de l’islam aux jeunes musulmans qui ont trop souvent une lecture littéraliste du Coran ? Par une pédagogie fondée sur la science historique que détaille Hicham Abdel Gawad dans son nouvel essai, L’islam entre foi et rationalité.
Publié le
· Mis à jour le

Les jeunes, Hicham Abdel Gawad (chroniqueur à L’appel) les connaît bien. Né en banlieue parisienne, il est arrivé en Belgique en 2006 pour suivre un master en Sciences des religions à l’UCL et, pendant des années, il a été professeur de religion islamique en collège. En 2016, il a publié un premier livre, Les questions que se posent les jeunes sur l’islam (La Boîte de Pandore). Devenu chargé de recherche en prévention du radicalisme à la Fédération Wallonie-Bruxelles, il est conscient que cette population est de plus en plus perméable aux discours fondamentalistes. C’est pourquoi, dans sa thèse de doctorat de troisième cycle, il envisage des outils pédagogiques et didactiques permettant de mettre en œuvre une approche historico-critique de l’islam à destination des jeunes. Le livre qu’il vient de publier, L’islam entre foi et réalité, en est une version « allégée » destinée à un plus large public.
OUTILS DE L’HISTORIEN
Son intérêt pour ce type d’approche vient de sa propre histoire. « Comme beaucoup de jeunes musulmans des années 1990-2000, j’avais ingurgité du salafisme sans savoir que c’en était. Dans cette approche littéraliste du Coran, certaines choses me gênaient, notamment des textes qui me semblaient invraisemblables sur un certain nombre de points. Et j’ai eu la chance de rencontrer quelqu’un qui m’a convaincu que, en tant que musulman, on n’était pas obligé d’adhérer à l’ensemble du corpus de textes de la tradition, que certains d’entre eux étaient apocryphes. J’ai eu l’impression que c’était un peu une question d’opinions, et j’étais à la recherche de quelque chose de plus objectif. C’est alors que j’ai découvert les outils de l’historien qui m’ont semblé tout de suite beaucoup plus solides. »
Dans son livre, le chercheur donne la parole à sept garçons et filles entre 19 et 23 ans, nés ou ayant grandi à Bruxelles ou en Wallonie. Il les a interrogés sur leurs projets de vie et leurs rapports au Coran et à Muhammad, avant de confronter leurs croyances à une approche historico-critique. « Pour la plupart des musulmans, cette approche peut sembler être une montagne à gravir parce qu’elle perturbe beaucoup de choses chez eux, remet en question énormément d’éléments qui ont fini par être acceptés sous l’effet du salafisme et du frérisme. Or je suis convaincu que cette tranche d’âge peut se différencier entre ceux qui vont rester dans une approche littéraliste et ceux qui, graduellement, seront plus rationnels, plus compatibles avec la citoyenneté et les valeurs que l’on appelle de nos vœux. »
PROJET DE VIE
« Je me suis par exemple rendu compte que mon hypothèse de départ, selon laquelle plus les jeunes sont croyants et pratiquants, moins ils vont être ouverts à cette approche, était fausse. J’en ai rencontré de très croyants et pratiquants qui n’y étaient pas défavorables. Et, à l’inverse, d’autres qui étaient croyants, mais sans plus, se montraient totalement fermés. En réalité, l’élément central n’est pas la pratique religieuse ou l’intensité de la croyance, mais ce qui nourrit leur projet de vie. Un jeune qui part du principe que l’on vit dans une société soumise à un système d’aliénation va considérer que l’approche historico-critique est un agent de cette aliénation et la repousser. Pour un autre qui considère le prophète comme un exemple à suivre à condition qu’il soit adapté à notre époque, cette approche sera douloureuse, car elle ne va pas forcément dans le sens du dogme, mais il peut l’accepter, parce qu’elle lui permet d’avoir une meilleure compréhension du contexte historique. »
Comment concilier foi et science ? « C’est d’autant plus compliqué que les jeunes musulmans considèrent que leur religion fonctionne comme une science. Ils ne vont pas parler de théologiens, mais de savants. Le texte devient une preuve. Dès lors, pour eux, ce n’est pas la foi qui s’oppose à la science, mais c’est la science divine révélée dans les textes islamiques qui s’oppose à la science humaine. La théorie de l’évolution ne peut donc qu’avoir tort face au récit coranique d’Adam et Ève enseigné par Dieu à partir de sa science, si j’ose dire. C’est ce que j’appelle le scientisme religieux, où la science dit la vérité au lieu de la chercher. C’est pourquoi, à côté du travail d’édification historique, il faut développer une philosophie du doute, une capacité de désabsolutiser le pouvoir de la science en la ramenant à ce qu’elle est, une démarche de connaissance et non un discours de vérité indiscutable. »
QUATRE BLOCAGES
L’approche historico-critique se heurte à quatre “espèces” de blocages détectés au cours de ces entretiens. « Celui de la première espèce est une stratégie de “conciliation” : la personne accepte la contradiction et essaie de construire une nouvelle vision. Il s’efforce de concilier l’élément déstabilisant avec sa croyance. Le deuxième blocage donne lieu à des stratégies de “contournement”. Plutôt que revisiter ses représentations, il revisite l’élément perturbateur en le remettant en question, en niant sa véracité, etc. Le troisième type est une stratégie de “rejet”, des attaques ad hominem contre la compétence ou les intentions de l’historien. Le dernier blocage, enfin, est un peu à part, car ce qui est proposé passe complètement au-dessus la tête du jeune qui ne comprend pas de quoi on parle. » Le chercheur a ainsi élaboré un programme pédagogique en plusieurs phases. « Dans celle de dépassement, par exemple, l’idée n’est pas de contredire de but en blanc le littéralisme, d’affirmer qu’il a tort, mais de faire en sorte qu’il devienne intellectuellement insuffisant. De créer les conditions pour que l’apprenant, au vu de la complexité du sujet, concernant tout ce qui se joue autour des questions sur le Coran, le prophète, etc., se dise que l’approche littéraliste ne lui fait voir qu’un seul aspect et pas les autres. Il va alors s’en désintéresser et s’en détacher. »
Parmi les éléments de cet outil pédagogique, constatant l’importance de la place d’internet chez les jeunes, Hicham Abdel Gawad propose notamment d’alimenter les plateformes d’émissions historico-critiques. « Les sources de transmission de la religion se sont complexifiées avec le temps. À la famille et la mosquée du quartier, sont venus s’ajouter les cours de religion à l’école, puis internet. Et face à ces différents discours qui ne disent pas tous la même chose, le jeune ne sait plus comment se positionner. Puisque la religion est omniprésente dans sa vie, il faut donc fonder une nouvelle pédagogie très réactive. Sur internet, ce peuvent être une adresse mail partagée, une page sur un réseau social, un groupe WhatsApp où l’on peut échanger en temps réel, de façon à ne pas être dans une sorte de trou noir d’une semaine à l’autre où l’on ne sait pas trop ce qui se passe. Dans le cadre scolaire, l’approche que je préconise est centrée sur l’apprenant. L’enseignant, devenu un facilitateur d’apprentissage, est là pour le pousser, accoucher ses doutes, ses idées, ses questionnements, en lui précisant que cela peut donner naissance à des discussions, des débats, des réflexions, y compris pour son projet de vie, une donnée à toujours avoir en tête. »
Propos recueillis par Michel PAQUOT
Hicham ABDEL GAWAD, L’islam entre foi et rationalité. Une pédagogie par la science historique, Paris, Le Cerf, 2025. Prix : 35€. Via L’appel : -5% = 33,25€.