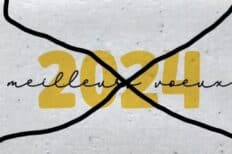Tribalisation et ressentiment : des ferments de conflits
Tribalisation et ressentiment : des ferments de conflits
L’invasion de l’Ukraine par la Russie a créé un traumatisme violent en Europe. Ce retour de la guerre sur son sol, tout comme d’autres conflits et révolutions à travers le monde, s’explique d’abord par des raisons psychologiques selon l’analyste belge Koert Debeuf. Il développe cette thèse dans son nouveau livre, Pourquoi ce n’est pas la dernière guerre.
Publié le
· Mis à jour le

« Perplexe » face à l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, qui ne peut s’expliquer rationnellement, l’expert belge en géopolitique Koert Debeuf émet la thèse que les motivations des révolutions et des guerres sont à aller chercher non dans l’économie, mais dans la psychologie. « Tant que nous ne comprendrons pas celle des personnes, des pays et même des continents entiers, nous serons surpris chaque fois qu’un confit éclatera », pronostique-t-il dans son essai Pourquoi ce n’est pas la dernière guerre. Pour comprendre cette guerre – ce qui ne signifie évidemment pas l’excuser – il faut donc se mettre à la place de la Russie. Mais, penser comme l’autre, ce n’est pas facile, et certainement pas dans
les habitudes des dirigeants mondiaux.
« Ce manque de connaissance des autres, on le voit un peu partout, constate-t-il : on ne comprend pas la Russie, la Chine ne comprend pas l’Europe, et même l’Europe ne comprend pas les Américains. Or, si on n’essaie pas de comprendre les traumatismes des autres, il ne peut y avoir de dialogue. Je crois que la majorité des guerres sont nées de cette absence de compréhension qui provoque des ressentiments, de la rancœur. » Il met ainsi en avant deux causes de guerre qui répondent l’une et l’autre à ces ressorts psychologiques : la tribalisation et le ressentiment.
ANTI-MONDIALISATION
La tribalisation, comme « processus de décomposition des sociétés », l’ancien conseiller du Premier ministre Guy Verhofstadt l’oppose à la mondialisation. « Interaction, interconnexion et intégration croissantes du monde », celle-ci, qu’il fait remonter aux premiers échanges entre les différentes civilisations antiques, dépasse le cadre de l’économie et du commerce, pour s’étendre à la culture, la politique, les connaissances, l’éducation ou la communication. « Alors que les années 70 ont été marquées par plus de démocratie, de liberté, de mondialisation, depuis 2006, la situation mondiale empire, déplore-t-il. Les discours deviennent plus nationalistes, plus tribaux. On commence par construire des murs au lieu de les détruire, c’est une spirale qui mène à la guerre. » Il rappelle qu’en 1989, le monde comptait douze murs ou clôtures. En 2022, il y en a près de quatre-vingts, dont plusieurs en Europe centrale et de l’Est.
« Cette guerre ne sera pas la dernière et d’autres conflits majeurs suivront si rien ne change. »
À ses yeux, plus que l’économie, la tribalisation est un facteur de guerres et de révolutions, comme il a pu s’en rendre compte lors du printemps arabe. Ces nouvelles tribus développent en effet une vision du monde en noir et blanc, véhiculée par des discours tribalistes et populistes qui se sont multipliés partout dans le monde. De leur point de vue, tout qui ne fait pas partie de la tribu est un ennemi et toute voix critique en son sein est un traitre. Cette tribalisation débouche dès lors sur un nationalisme souvent autoritaire ou sur un fondamentalisme religieux. « Dans certaines régions du monde, cet extrémisme atteint des proportions effrayantes. L’Inde est secouée par des conflits interreligieux, dans le Sahel, Boko Aram est plus fort que jamais, Daech pourrait revenir en Irak et dans d’autres pays. Émerge aussi un fondamentalisme chrétien, aux États-Unis ou en Amérique du Sud où les évangélistes remplacent à grande vitesse les catholiques. »
UNE TENDANCE PSYCHOLOGIQUE
Pour cet ancien rédacteur en chef du journal en ligne EUobserver, la tribalisation est « avant tout une tendance psychologique » née d’« une crise d’identité collective, résultat d’un traumatisme grave ». Et c’est ce traumatisme qui génère des conflits. « Ce qui rend les événements traumatisants, c’est la façon dont ils ébranlent nos croyances et nos valeurs et dont ils provoquent une fissure dans nos identités. » Et, depuis les attentats 11 septembre 2001, suivis par la guerre menée en Irak par les États-Unis, ces événements se sont multipliés « entraînant le monde dans une spirale descendante de tribalisation ». De ce traumatisme collectif a germé un profond ressentiment qui, aujourd’hui, prend de l’ampleur partout sur la planète. C’est pourquoi, se désole l’observateur belge, « cette guerre ne sera pas la dernière et d’autres conflits majeurs suivront si rien ne change ».
DES GUERRES « POSSIBLES »
Tribalisation, traumatisme, ressentiment. Ces mots peuvent donc expliquer l’entrée en guerre de la Russie contre son voisin ukrainien, ce qui a provoqué un choc profond dans une Europe qui n’imaginait plus connaître ça. Même si, depuis l’occupation de la Crimée et des provinces orientales de l’Ukraine par l’armée russe en 2014 et les menaces de plus en plus inquiétantes de la Chine sur Taïwan, l’idée d’un retour de la guerre sur le vieux continent avait commencé à s’imposer. En 2021, dans un livre qui porte ce titre, le conseiller en recherche stratégique François Heisbourg envisageait comme « possible » une guerre entre grandes puissances ou puissances régionales. « Pour nous, observe Koert Debeuf, la guerre concernait nos grands-parents. De plus, après la chute du mur de Berlin, elle nous semblait une chose qui appartenait définitivement au passé. » Pour les Européens, peut-être, mais certainement pas dans d’autres régions du monde – Syrie, Kurdistan, Haut-Karabagh, Sud-Soudan, Yémen – incessants théâtres de conflits meurtriers.
DISCOURS ANTI-EUROPÉEN
Et c’est aussi oublier que l’Europe a été secouée, au milieu des années 90, par la guerre des Balkans suite à l’éclatement de la Yougoslavie. « En Europe occidentale, on l’a un peu considérée comme une guerre civile, alors que, dans ce cas-ci, le traumatisme est provoqué par le fait que l’agresseur soit la Russie, analyse-t-il. L’Ukraine a été attaquée car elle voulait intégrer l’Union européenne et le discours de Poutine est profondément anti-européen, tant au niveau politique qu’à celui des valeurs. »
« Les premières images de la guerre en Ukraine qui nous sont arrivées avaient l’allure de guerres du passé, souligne de son côté le philosophe français Frédéric Gros : des quais de gare bondés, des avances de chars, de squelettes d’immeubles déchiquetés, des lignes de front mouvantes… Ces images-là étaient éloignées des grandes violences collectives représentées par le terrorisme, avec des scènes de panique dans des espaces publics suite à l’explosion de bombes. C’était comme si revenait une ancienne forme de guerre, un conflit purement territorial comme on l’apprenait dans nos livres d’histoire. Or on avait au contraire beaucoup glosé sur le fait que les nouveaux conflits seraient entièrement déterminés par le renseignement numérique. Ce conflit réveille en Europe la conscience de la possibilité de la guerre. Dans tous les pays, les budgets militaires ont augmenté. L’évidence de la paix qui faisait notre quotidien, malgré les attentats terroristes, a été ébranlée. »
COHÉSION NATIONALE
Le premier effet de cette guerre a été de renforcer le sentiment de cohésion nationale de l’Ukraine, ce que Poutine n’avait pas anticipé. Car, à ses yeux, son voisin n’est ni un peuple ni un État, mais, note François Heisbourg, « une erreur fabriquée par les bolchéviques ». Tout au long de son histoire, l’Ukraine a subi des dominations diverses et n’est devenue indépendante qu’au début des années 90. Le géographe Michel Foucher précise que « son existence est niée par les élites russes – politiques, militaires, religieuses – qui n’ont de cesse de vouloir rassembler “le monde russe” sous un seul toit. » « L’idée que l’État fait la guerre et que la guerre fait l’État a été très importante dans l’histoire jusqu’au XXe siècle, résume Frédéric Gros. Elle avait comme défaut majeur d’instaurer la vision d’une certaine normalité de la guerre pour régler un différend. Mais, avec les progrès techniques et la montée en puissance des armes de destruction massive, ce n’était plus acceptable. Le scandale de ces morts par millions était trop grand. Le XXe siècle a ainsi été celui de l’“anormalisation” de la guerre. »
« C’était comme si revenait une ancienne forme de guerre, un conflit purement territorial comme on l’apprenait dans nos livres d’histoire. »
Quelle issue à ce conflit ? François Gros s’inquiète d’une trop grande moralisation. « Présenter le bien contre le mal, la démocratie contre le despotisme, la justice contre l’iniquité est un manichéisme dangereux car, si toute guerre se juge par la morale, elle se construit par le droit. À un moment, on va avoir un choc frontal entre la perception morale de la guerre et une grille de lecture juridique selon laquelle les négociations imposent qu’on fasse comme si les belligérants étaient à égalité. On ne peut pas faire autrement, à moins d’exiger une capitulation sans conditions de Poutine. Or, à force de moraliser la guerre, on n’envisage plus que cette seule solution. Or est-ce vraiment cela que l’on recherche ? Et est-ce souhaitable et réaliste avec un minimum de conscience historique ? »
Et comment prévenir d’autres guerres ? Koert Debeuf défend une consolidation du modèle européen. « L’idée de la construction européenne est d’oublier les traumatismes de l’histoire entre les différents pays », rappelle-t-il. Il plaide aussi pour une mondialisation de l’éducation, toujours pour parfaire la connaissance de l’autre, et pour un renforcement du centre contre les extrêmes. Celui-ci est en effet en difficulté partout en Europe, ce qui rend de plus en plus compliqué et long la formation de gouvernements, engendrant une baisse de confiance dans la démocratie. Mais, ce fin analyste n’oublie pas de préciser que « chaque individu est essentiel pour mettre fin à la tribalisation et à la polarisation ».
D’AUTRES GUERRES À VENIR ?
« Nous traversons une période de chaos, et cette période n’est pas encore terminée. Elle apportera inévitablement des frictions, alimentées par des traumatismes et des ressentiments », redoute Koert Debeuf qui, comme d’autres analystes, n’est guère optimiste. « Une troisième guerre mondiale n’est pas impossible, les pires scénarios sont toujours envisageables. Si Poutine a l’impression de tout perdre en Ukraine et dans son pays, pourrait-il se dire : après moi le déluge ? Je ne sais pas. » Selon François Heisbourg, la transformation de ce conflit en troisième guerre mondiale « n’est certes pas inévitable, mais elle est imaginable. Si même le recours aux armes nucléaires n’est pas une fatalité, dès le premier jour, le fait nucléaire est partie intégrante de son univers conceptuel ».
Le discours de la Chine face à Taïwan est pour le moins inquiétant et plusieurs régions du globe, tels le Sahel ou les Balkans, sont à haut risque. « Le tribalisme est en expansion partout dans le monde, insiste Koert Debeuf : en Chine, en Inde, au Moyen-Orient, en Afrique et même aux États-Unis où la société est totalement polarisée, tout comme l’opposition entre démocrates et républicains entre qui le dialogue est rompu. C’est une situation inflammable qu’une étincelle pourrait faire exploser. Des militaires américains m’ont d’ailleurs récemment dit que, dans l’armée, ils craignent des combats de rue. Ce qui serait catastrophique pour l’ordre mondial. » Une guerre civile dans ce pays qui a totalement changé de physionomie depuis la présidence de Trump, inimaginable il y a quelques années, est en effet une hypothèse non exclue par de nombreux observateurs. (M.P.)
Koert DEBEUF, Pourquoi ce n’est pas la dernière guerre, Bruxelles, Racine, 2023. Prix : 24,99€. Via L’appel -5% = 23,74€.
Michel PAQUOT