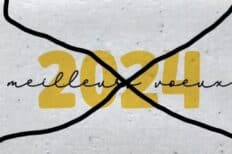Un aveuglement nommé déni
Un aveuglement nommé déni
« Le déni est un bras de fer avec la réalité », constate le psychiatre Serge Tisseron qui lui consacre un essai qui tombe à point nommé. Le réchauffement climatique, la pandémie et les vaccins, jusqu’à l’agressivité guerrière de Poutine : face à la violence du monde, on a trop souvent tendance à faire l’autruche.
Publié le
· Mis à jour le
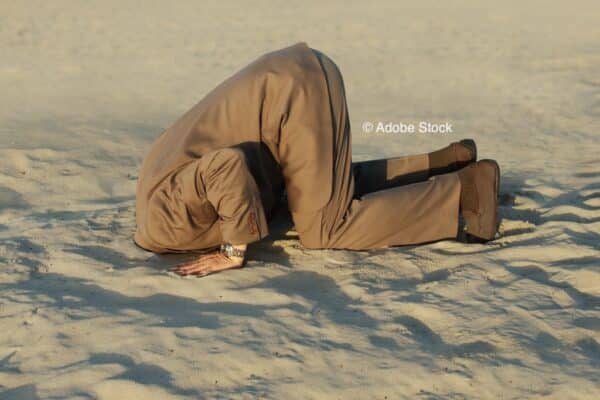
« Nous sommes tous menacés de basculer dans le déni. Parce que nous désirons un autre monde, d’autres partenaires, une autre vie, et que nous sommes pour cette raison prêts à nous aveugler. Et il n’est pas nécessaire de chercher bien loin pour découvrir que nous y avons tous plongé un jour ou l’autre et que nous sommes prêts à la faire encore. Tout simplement parce que le déni est un processus psychique normal. Il est en effet destiné d’abord à ne pas nous sentir submergés par des bouleversements brutaux qui nous obligent à faire face à trop de changements de front. »
DÉNI CLIMATIQUE
Serge Tisseron ne pourrait mieux dire. Depuis des années, le GIEC, les collapsologues et tant d’autres chercheurs, scientifiques ou simples observateurs s’alarment, et alarment, sur les dangers du réchauffement climatique. Un dérèglement confirmé mois après mois, par la sécheresse de cet été, annoncée comme l’ébauche d’un futur pas si lointain, les inondations récurrentes, les risques d’incendies, les ouragans et tornades qui se multiplient… « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », lançait Jacques Chirac au Sommet de la Terre il y a tout juste vingt ans. Et pourtant, pour une large part, on continue à vivre comme avant. Refusant de voir l’avenir en face, se cantinant dans une forme de déni plus ou moins assumé. « Ce qui est intéressant avec le déni sur le réchauffement climatique, remarque le psychiatre, ce sont tous les efforts faits pour se le cacher. Une forte proportion de la population reste convaincue que l’activité humaine n’y est pour rien, parce que ça la rassure. Elle se dit qu’il est inutile de modifier ses comportements, renforcée par la société qui incite à consommer. Être dans le déni de la finitude de la planète c’est être dans celui de sa propre finitude. »
« Le déni est un bras de fer avec la réalité. Il ne s’agit pas d’une erreur de jugement, mais d’un aveuglement au sens où ce n’est pas seulement une façon d’ignorer un fait, mais bien la valeur et l’importance de celui-ci. C’est une posture active. Dans l’ignorance, on ferme les yeux et les oreilles. Dans le déni, on devient un militant d’une cause alternative. » Il distingue ainsi le déni des “biais cognitifs”, ceux du moindre effort, de confirmation, de normalité, de conformisme… qui sont des erreurs d’appréciation maintenant l’individu dans sa “zone de confort”, sans l’obliger à revoir ses habitudes de pensée.
POSTURE PSYCHIQUE
« Si, dans un biais cognitif, je me trompe, c’est par facilité. Et je suis tout prêt à le reconnaitre parce que ce qui est en jeu, c’est mon appréciation de la réalité. J’ai cru comprendre une chose, j’admets avoir fait une erreur. Dans le déni, ce n’est pas mon jugement sur un événement qui importe, mais ma place au monde, mon identité. Ce n’est pas une paresse de l’esprit, mais un effort pour soutenir une vérité alternative. Le déni est une posture psychique qui ne se mesure pas seulement à ce que je dis, mais à ce que je pense, éprouve, à la place que cela occupe dans mon organisation du monde. Celui qui est dans le déni est sincère, c’est pour cela qu’on doit le prendre au sérieux. »
« Il faut vraiment comprendre la dynamique du déni. On ne s’y engage pas pour rien, il repose toujours sur une logique. Ce peut être une souffrance qui n’a pas été reconnue. Par exemple les parents qui se sont enfermés dans le déni des sévices sexuels qu’ils ont pu subir enfants de la part de leurs parents ou d’autorités religieuses. Ils s’y sont enfermés car il n’y avait personne pour les écouter. Ils se trouvent alors dans le déni de ce que peuvent subir à leur tour leurs propres enfants. C’est, pour eux, la seule manière de faire entendre le fait qu’on ne les a pas reconnus, qu’on n’a pas pris en compte leurs préoccupations, leur douleur, leur déniant le droit d’exister. C’est une logique de déni contre déni. »
AMERTUME ET COLÈRE
Ainsi qu’on a pu s’en rendre compte face à la covid, dont le risque a été largement sous-estimé et la gravité minorée par certains, et aux vaccins considérés comme dangereux parfois par les mêmes, il est très difficile, voire impossible, de convaincre quelqu’un qui se trouve dans le déni. Il ne faut ni le brusquer, ce serait contre-productif, il se braquerait davantage, ni le sermonner ou tenter de le convaincre qu’il a tort. Sans pour autant se comporter comme s’il n’y avait pas de déni. Serge Tisseron préconise la démarche du care : s’intéresser à son cheminement intérieur, à ce qui l’inquiète. « Il faut lui parler de la vie, de toute une série de choses sans rapport avec ce qu’il dénie. On s’aperçoit souvent que, derrière, il y a une amertume, une colère apparemment éloignée de son déni, sinon psychologique. »
Pourtant, nier une maladie grave ou la mort, n’est-ce pas un moyen de se protéger ? « Le déni vient du vocabulaire psychiatrique où il signifie la capacité de l’être humain à se masquer provisoirement une situation gravement traumatique, comme l’annonce d’un mal incurable. C’est un mécanisme protecteur qui va permettre d’assimiler la réalité à son rythme. En la refusant d’abord entièrement, puis en en admettant une petite partie, puis une autre, et une autre encore, jusqu’à l’accepter dans sa totalité. Le problème se pose lorsque le déni s’installe. Et, aujourd’hui, c’est d’autant plus le cas que, quel qu’il soit, vous trouverez toujours sur internet des gens qui sont d’accord. Avec les algorithmes, vos relations se sont réduites au noyau de personnes qui partagent vos convictions. Petit à petit, vous vous coupez de la réalité. Le danger est colossal. »
Selon Tisseron, « internet ajoute une menace pour la démocratie ». « Les dénis de l’inceste ou de la pédophilie dans l’Église ont provoqué des souffrances gigantesques, sans pour autant menacer la démocratie, observe-t-il. Mais le déni d’humanité relayé par internet, oui. Considérer, par exemple, une partie de la population comme des chiens, va les marginaliser, voire pire. » Ce déni d’humanité a notamment débouché, en 1994, sur le génocide rwandais, véhiculé non par la Toile, embryonnaire à l’époque, mais par la radio nationale.
THÉORIE DU COMPLOT
Le psychiatre dresse un lien entre le déni et le complotisme qui a profité d’internet pour se répandre. Il en décortique le mécanisme insidieux. « Le déni n’a pas besoin de la théorie du complot, mais celle-ci le renforce considérablement. Elle est très importante pour cimenter les dénis individuels. Comme je n’accepte pas une partie de la réalité, je l’ignore. Mais je n’y parviens pas car elle revient toujours. Je cherche alors les arguments qui vont dans mon sens pour me convaincre que j’ai raison. Sur internet, je tombe sur des personnes qui pensent comme moi. Et au bout du compte, je trouve quelqu’un, souvent cultivé et qui s’exprimer bien, qui propose une théorie intégrant mon déni, tout en allant bien au-delà. Par exemple, je suis dans le déni du vaccin. Je découvre que des gens sont persuadés que des labos pharmaceutiques liés aux GAFAM veulent dominer le monde grâce à la 5G, etc. Tout d’un coup, mon petit déni qui ne portait que sur l’utilité des vaccins est pris dans une théorie expliquant le monde entier. Je n’avais qu’un élément du problème et je comprends maintenant que j’étais dans le vrai. La théorie du complot est totalitaire au sens où elle englobe l’ensemble des événements incompréhensibles du monde. »
Comme le rappelle Serge Tisseron dans son livre, le déni ne concerne pas que les autres. On est confronté à tellement de bouleversements rapides et violents difficiles à assimiler et à comprendre qu’il nous menace beaucoup plus que par le passé. On est tous potentiellement enclins à refuser certaines choses parce que tout va trop vite. Il faut apprendre à se protéger contre le risque de basculer dans le déni.
Michel PAQUOT
Serge TISSERON, Le déni ou la fabrique de l’aveuglement, Paris, Albin Mi- chel, 2022. Prix : 22€. Via L’appel : – 5% = 20,90€.