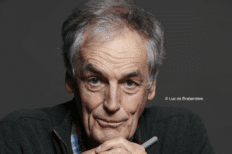Etienne Davodeau : le monde comme il va
Etienne Davodeau : le monde comme il va
Alternant fiction et documentaire, noir et blanc et couleur, Étienne Davodeau est, à 60 ans, l’auteur d’une quarantaine de bandes dessinées et romans graphiques ancrés dans le réel. Avec tact, lucidité et tendresse, il raconte son époque à travers des personnages issus du quotidien. Comme, dans son nouvel album, Là où tu vas, ces hommes et ces femmes atteints de troubles de la mémoire que sa compagne suit depuis de nombreuses années.
Publié le
· Mis à jour le

— À travers vos albums, vous parlez de « ce qui nous fait et nous défait », comme vous le précisez dans l’un deux. C’est pour cela que vous faites de la bande dessinée ?
— Je dessine depuis l’enfance et je rêvais d’en faire, mais sans avoir réfléchi à ce que la BD pouvait être. D’ailleurs, mes premiers livres étaient des fictions assez conventionnelles. Le récit du réel, le reportage, le documentaire, ce n’est venu que progressivement. J’y parle du monde d’aujourd’hui, là où je vis, parce que je me dis que, plus mes sujets sont proches de moi, plus je suis légitime pour les traiter. Mais même dans mes fictions, je raconte la vie quotidienne, le banal. Mes personnages sont des gens comme vous et moi qui se débrouillent dans la vie comme ils peuvent.
— Cet intérêt pour les humains vient-il de votre enfance ? Comme vous le racontez dans Les Mauvaises Gens, vos parents se sont rencontrés lorsqu’ils étaient tous deux militants à la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne).
— J’ai eu une enfance très sociale, mais avec un solide fondement catholique. L’endroit d’où je viens, les Mauges, un morceau de l’Anjou, étaient – et l’est encore dans une grande mesure aujourd’hui – complètement imprégnées de catholicisme. Toutes les activités avaient cette dimension. Mais il est vrai que mes souvenirs d’enfance sont marqués par les réunions syndicales chez mes parents. Des débats assez vifs dans la cuisine, du café toute la soirée, la fumée des cigarettes qui sature l’espace. C’était très vivant, très chaleureux, très tonique, parce que c’étaient des débats forts, politiques. J’adorais ça, sans rien y comprendre, évidemment, j’avais 5, 6, 7 ans. Tout en sentant que ces gens croyaient en quelque chose, qu’ils étaient ensemble, créant un cadre pour grandir très chaleureux et rassurant. Je dessinais sur un coin de la table, me concentrant sur ce que je faisais, comme dans un cocon au milieu du tumulte.
—De cet intérêt pour le collectif, on trouve des traces dans vos albums où vous mettez souvent des groupes en scène…
— Oui, je pense que cela vient de là. Et pour un auteur BD, la réunion d’humains en un même lieu est un moteur narratif extrêmement efficace. Le récit se tisse presque tout seul, on n’a plus qu’à regarder ce qui se passe et à écrire. Si les personnages sont suffisamment antagonistes avec des histoires, des personnalités, des visions différentes, la friction entre eux va générer du récit.
— Que vous reste-t-il de votre enfance catholique ?
— En commençant Les Mauvaises Gens, j’avais des intentions bien plus agressives que le résultat final ne le laisse paraître. Je voulais régler son sort à l’éducation catholique que j’ai reçue, et dont je me suis débarrassé à l’adolescence, en tout cas de ce qui m’en encombrait le plus. Tout en ayant bien conscience que c’était une version du catholicisme plus accueillante que celle que l’on voit maintenant se déployer un peu partout. Je viens de là. C’est une époque dont les paramètres ont largement disparu, la JOC en France, aujourd’hui, n’a plus la puissance qu’elle avait dans les années 50 et 60. Mes parents ont été ouvriers à 14 ans, ils n’ont pas été au lycée, à peine au collège. La JOC, c’était leur université, ce qui leur a permis de s’émanciper, de se cultiver. De se rencontrer, aussi. Pour eux, c’était vachement important. Quand j’ai grandi, mes parents étaient à l’ACO, l’Action catholique ouvrière. Et moi, j’ai pu aller à l’université, j’ai eu accès à la culture et à un monde plus large.
— Et le versant militant de votre enfance ?
— Grâce à lui, que je continue à m’intéresser aux militants, non plus catholiques, mais plutôt écolos. Des gens qui, collectivement, refusent l’imposition des modèles dominants. Là d’où je viens est un endroit où on disait volontiers “nous”, assez peu “je”. C’est pourquoi le collectif m’intéresse beaucoup, ce qui est paradoxal puisque je fais un métier extrêmement individualiste.
—Cette dimension, on la retrouve dans Le droit du sol. Votre traversée à pied de la France entre la grotte préhistorique de Pech Merle, dans le Lot, et le site d’enfouissement des déchets nucléaires à Bure, dans la Meuse, est jalonnée de témoignages de militants et de scientifiques.
— Je donnais déjà la parole à des militants dans Rural, des agriculteurs convertis en bio luttant contre la construction d’une autoroute à travers leurs terres, et dans Les Ignorants, via le vigneron Richard Leroy. Lors d’un album collectif, Rupestres, j’ai découvert Pech Merle dont le mammouth m’a tapé dans l’œil. En fait, j’avais déjà le projet de faire quelque chose autour de Bure, dont les médias ne parlent pas alors qu’il s’y passe des tas de choses, mais je ne savais pas comment. Et après avoir vu Pech Merle et sa beauté, face aux immondices de Bure sous terre, je me suis dit relier par le sol ces deux lieux souterrains était une bonne façon de mettre tout cela en résonance. Il se trouve que j’aime la randonnée et la montagne. Et comme j’ai le pouvoir de m’adresser à quelques dizaines de milliers de personnes avec mes livres, j’en use en conscience, donnant la parole à des militants dont la trajectoire m’intéresse.
« Mes personnages sont des gens comme vous et moi qui se débrouillent dans la vie comme ils peuvent »
— Dans cet album, vous nommez les humains “sapiens”. Comment les regardez-vous aujourd’hui ?
— Ceux qui ont vécu il y a 25 000 ou 30 000 ans à Pech Merl nous ont laissé de magnifiques dessins et nous, sapiens contemporains, on s’apprête à laisser sous terre de vraies saloperies que sont les déchets nucléaires. Ce qui nous est commun est donc d’être capable du meilleur comme du pire, et c’est cela qui m’intéresse. Alors évidemment, si on regarde le journal télévisé, on va surtout voir le pire. Mais si on va dans un musée ou dans une librairie, on voit le meilleur. Je ne veux pas accabler ce pauvre sapiens qui est tout seul dans l’univers sur sa petite boule bleue, mais il fait énormément de conneries. On est de plus en plus nombreux, on épuise la planète. Heureusement, plein de gens proposent des contre-discours et mon job est de mettre en valeur ce qu’ils racontent. C’est comme cela que j’envisage mon travail.
— Ce trajet solitaire n’a pas toujours été facile…
— Marcher longtemps, sentir son corps en mouvement, traverser des endroits magnifiques, procure quelque chose qui relève presque de l’extase ou de la joie pure. Mais on traverse aussi des moments d’accablement, parce qu’on est crevé, que cela ne se passe pas bien, qu’on souffre, qu’on est tout seul. Quand on est sur un sentier avec un sac à dos, dans l’effort permanent, ces deux aspects sont extrapolés. Il y a heureusement plus de joie que l’inverse, sinon j’arrêterais de marcher. Et la marche permet, en plus, de savoir là où on est. Lorsqu’on passe des journées en ville, on est toujours un peu coupé du monde naturel, sur des sols artificiels, dans des environnements bruyants. C’est pourquoi j’ai besoin de temps en temps de m’immerger dans la nature, et la meilleure façon de le faire est de marcher. Si, les premiers jours, je souffre, une fois réadapté, j’ai le sentiment d’être à ma place. Marcher plusieurs semaines me recentre, me réinitialise. Et me permet de revenir ensuite dans le monde de la vie quotidienne, du travail, etc.
« Marcher longtemps, sentir son corps en mouvement, procure quelque chose qui relève presque de l’extase ou de la joie pure »
— Votre nouvel album, Là, où tu vas, est, comme beaucoup d’autres, ancré dans le monde du travail. Votre compagne témoigne de son action auprès de personnes souffrant de déficits de mémoire.
— Cela fait quinze ans que, le soir, avec Françoise, on se raconte nos journées, c’est très banal. Ce qu’elle me dit m’intéresse au plus haut point et, au bout d’un temps, je lui ai dit que j’y voyais la piste d’un récit. Mais elle qui a vu naître tous mes livres, qui sait comment je travaille, a d’abord refusé. M’expliquant notamment que, si ces personnes me donnent leur accord un jour, ils pourront le retirer le lendemain, sans y voir de contradiction. Il a fallu que je trouve des astuces pour la convaincre et lui prouver qu’en bande dessinée, on peut respecter l’anonymat et l’intimité des gens. Elle a fini par accepter. Rentrer dans le détail des mots, des gestes, du quotidien, de chaque minute passée avec ces personnes, m’a fait découvrir des tonnes de choses que j’ignorais. Et d’autre part, la création d’un livre au sein d’un couple a été une expérience assez troublante, émouvante.
— Comment avez-vous procédé ?
— Françoise ne voulait pas que je l’accompagne car créer une relation intime avec quelqu’un atteint de la maladie d’Alzheimer ou de troubles de mémoire a été un long travail pour elle et elle ne voulait pas que je le gâche. Je lui ai alors proposé de la questionner pour raconter à la virgule près ce qu’elle vit, en changeant les visages et les noms. L’idée est de rappeler que ces personnes ne se réduisent pas à leur maladie. Elles ont encore une identité, une famille, un parcours et des capacités. Face à des gens souffrant de la maladie d’Alzheimer, on se focalise sur ce qui leur manque, sur leur mémoire perdue, les encourageant à essayer de se souvenir. Mais cela ne sert à rien. Il faut plutôt se concentrer sur les capacités restantes car cette maladie ne se soigne pas, il n’existe pas de traitement. La seule chose qui importe est la qualité de l’accompagnement humain dans le moment présent. Quelque chose de très subtil et fin qui passe intégralement par la relation entre deux personnes. C’est ce que j’ai essayé de rappeler.
— À la lecture de vos albums, on se pose la question du pouvoir d’une BD, d’un livre et de l’art en général. Dans l’un d’eux, Un homme est mort, l’histoire de la réalisation d’un film sur la mort d’un ouvrier lors d’une manifestation ouvrière à Brest en 1950, un personnage affirme qu’un film ne sert pas leur lutte.
— Au contraire, dans cette histoire qui est celle du réalisateur René Vautier, le film témoigne d’un mouvement social et ensuite l’alimente parce que, lors de sa projection, les spectateurs payent avec des légumes et de la viande pour soutenir les grévistes. L’art n’est pas juste un truc pour distraire. Que l’on écrive, filme ou dessine, il faut que les histoires soient bruyantes, intéressantes, émouvantes, pas forcément distrayantes. Et d’ailleurs, nous distraire de quoi ? Nous faire oublier quoi ? Je pense que l’art a la vertu de raconter le monde comme il va, de montrer des expériences humaines singulières, collectives ou pas. Il donne à voir autre chose que ce que nous montre le pouvoir dominant. Il constitue ainsi un pouvoir agissant, qui ne suffit pas, mais qui est nécessaire. Quand je lis un roman ou que je vois un film, et que j’ai passé un bon moment et qu’en plus, cela m’a questionné sur la vie qu’on mène et le monde dans lequel on vit, je suis d’autant plus satisfait. Et si j’arrive à faire cela avec mes livres, je serai ravi.
— Vous y parvenez avec vos documentaires, mais aussi dans vos fictions. Le héros de La gloire d’Albert publié en 1999, par exemple, est un militant d’extrême droite à une époque où celle-ci n’a pas l’audience qu’elle connait aujourd’hui.
— Cette parodie vaguement inspirée d’un homme politique, Philippe de Villiers, et de son spectacle historique au Puy du fou est en train de s’incarner avec la progression de l’extrême droite partout dans le monde. C’est hyper flippant, je n’imaginais pas que, de mon vivant, je verrais cela. Mais si je pense qu’un livre peut être utile pour parler de ces choses-là, il ne faut pas non plus surestimer son pouvoir. Je crois que, dans ce type de situations, ce qui compte est l’action politique, qui peut être nourrie par des lectures, des films, des débats, des rencontres, des confrontations d’idées. Un livre ou une bande dessinée est un lieu où peuvent être confrontées des idées antagonistes, ce dont on manque aujourd’hui. On se focalise sur des choses dérisoires, on oublie l’essentiel, les réseaux sociaux sont complètement polarisés. Il n’y a plus vraiment d’espace pour la nuance et la contradiction un peu fines.
Propos recueillis par Michel PAQUOT
Étienne DAVODEAU, Là où tu vas, Paris, Futuropolis, 2025. Prix : 24€. Via L’appel : -5% = 22,80€.