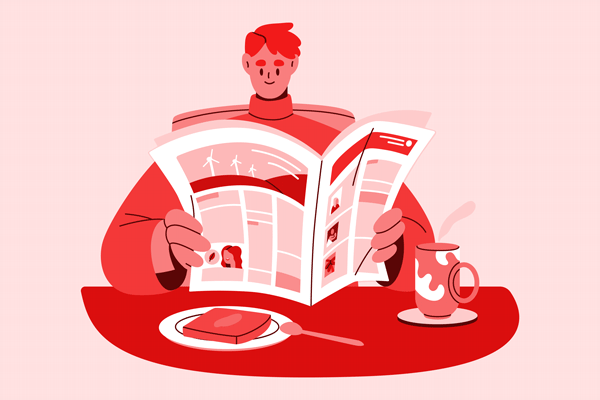Isabelle Le Bourgeois: « Le Dieu des abîmes a pris chair en moi »
Isabelle Le Bourgeois: « Le Dieu des abîmes a pris chair en moi »
Après avoir abandonné ses responsabilités de chef d’entreprise et quitté le monde des affaires, Isabelle Le Bourgeois est devenue religieuse auxiliatrice et psychanalyste. Pendant quatorze ans, elle a été aumônier à la prison de Fleury-Mérogis, où elle a accompagné de nombreuses personnes détenues. Son parcours lui a permis de découvrir « le Dieu des abîmes ».
Publié le
· Mis à jour le

— Après des études de lettres et de droit, vous vous lancez dans les assurances au milieu des années septante. La vie semble vous sourire…
—Oui, j’ai vingt-deux ans, je sors des études et j’accepte le premier boulot qui se présente à moi dans le monde des assurances. Ça marchait très bien et j’étais très motivée par ce que je faisais. J’avais même réussi à m’acheter un appartement à Paris.
—Et le dimanche de Pâques 1981, votre vie est transformée…
—J’ai alors trente-quatre ans. M’étant levée tôt pour aller chercher les croissants pour le petit déjeuner de ma famille, je passe devant une église. Une pulsion subite me pousse à y entrer pour la visiter. Or, bien qu’issue d’une famille catholique, j’avais déserté Dieu depuis longtemps. Il était devenu un concept qui ne nourrissait pas l’âme. C’était l’heure de la messe, le moment de l’homélie. J’entends alors l’officiant dire : « Dieu vous aime et vous ne le savez pas ! » Ça a été pour moi un véritable choc. Pas tout à fait immédiat, mais qui a bouleversé en profondeur des choses en moi. Une véritable conversion impossible à raconter. Au départ, je n’osais pas y croire : c’était tellement différent de ce que je vivais. Je sentais aussi qu’afin de concrétiser cet appel si neuf et vigoureux, il me fallait entrer dans la vie religieuse pour continuer de chercher, comprendre, aller au fond de moi-même. Un hasard m’a alors fait rencontrer quelqu’un qui m’a parlé des religieuses auxiliatrices que je ne connaissais pas. « Vas-y, me dit-on. Que risques-tu à essayer, c’est comme cela que tu sauras si c’est bon ou pas comme chemin pour toi. »
— De qui s’agit-il ?
— D’une congrégation internationale à la spiritualité ignacienne dont les membres sont au service de l’espérance là où elles travaillent. Elles mettent en commun le fruit de leur travail, de leurs missions. Ce partage est spirituel dans le soutien mutuel et fraternel, et aussi financier. Je suis donc partie à leur rencontre… et ça a marché ! Elles ont tout de suite cru en mon histoire. J’en ai été tout interloquée. Je n’étais pas vraiment prête à ça, mais elles m’ont beaucoup aidée. En 1983, j’ai tout quitté pour entrer au noviciat. Bien entendu, autour de moi, c’était l’incompréhension. Je devais faire confiance à l’élan du cœur qui était le mien. Pour moi, il n’y avait aucune hésitation à avoir. Ils ont fini par comprendre. Ces deux années de noviciat ont été comme une démarche d’initiation à la vie commune en Dieu, à la prière et à un mode vie simple et fraternel. Ensuite, il m’a fallu retourner à l’université. J’étais en effet très ignorante. Je ne fréquentais plus l’église, je ne connaissais rien de la religion, du catéchisme… J’ai donc suivi trois années de théologie.
— Vous êtes ensuite envoyée au Mexique…
— Oui,dans la communauté du noviciat pour être auprès des coupeurs de canne à sucre et de leurs familles pendant la saison de coupe. Il s’agissait de vivre avec eux et d’ainsi partager quelque chose de leur quotidien. C’était un vrai défi pour tout l’être que j’étais, encore façonnée de vie confortable et loin de la brutale réalité des plus humbles de cette terre. Ma première nuit, après quelques heures difficiles à méditer sur l’absurdité d’une telle situation, à ruminer une certaine colère et à regretter ma couette douillette, j’ai fini par entendre, un peu désorientée dans ce noir épais de la nuit mexicaine, que le Dieu qui se donnait à voir était le “Dieu des abîmes”. Je ne m’étais pas dit à l’époque qu’il s’agissait de ce Dieu, mais aujourd’hui, c’est bien ce nom-là que je lui donne, je persiste et signe.
— Vous entamez alors une psychanalyse pour devenir psychanalyste ?
— Ce type de démarche, bien sûr, est très personnel. Mais le bouleversement que je vivais – avoir tout quitté,le monde des affaires, ma famille, mes amis, et avoir été hors de l’Église et de la religion pendant de très nombreuses années – ce n’était pas rien. Il fallait travailler tout ça. J’ai donc entamé une psychanalytique et appris à découvrir la langue particulière qui est celle de l’inconscient. Je me suis rendu compte au bout de quelques années que je pouvais écouter avec une oreille branchée sur l’inconscient. J’ai donc ouvert un cabinet pour tenter de vivre auprès de ceux qui ont soif d’être écoutés, pour qui l’écoute est de nouveau un lieu de vie possible. Entendre ce qu’une de mes patientes me disait : « J’ai mal d’un mal que je ne sais pas articuler, un mal qui n’a pas encore de mots. Y a-t-il seulement quelqu’un pour écouter ? Quelqu’un de fiable ? Quelqu’un qui va recevoir mes cris et nous aider à les nommer ? »
— C’est aussi pour cette raison que vous êtes allée à la rencontre des personnes détenues ?
— Tout d’abord, vous avez raison de parler de “personnes détenues”. En effet, je n’emploie jamais le vocable de “détenu” ou “prisonnier” parce que toute personne est une personne, quelle que soit sa situation. Un aumônier de prison m’avait approchée pour aller à leur rencontre, mais j’ai d’abord refusé. Cela ne m’intéressait pas. J’écoutais toute la journée des personnes victimes, je ne sentais pas l’intérêt d’aller écouter des “coupables” en prison. Il a insisté, m’a demandé d’y aller « une fois, pour voir ». De fil en aiguille, j’ai été convaincue. J’y suis restée quatorze ans. Je n’ai écouté que des hommes, des histoires souvent sordides. Assez vite, leurs regards m’ont bouleversée. Rencontrer ces personnes, en fait, c’est retrouver la trace du Dieu des abîmes. Le Dieu le plus intime, le plus profond, le plus noir, le plus carcéral en nous où sa lumière va se faire. Quand une personne détenue m’interpelle : « Vous croyez que Dieu peut m’aimer, moi qui suis un assassin ? », c’est quelqu’un qui attend de moi que je lui parle du Dieu auquel je crois, quelqu’un qui attend que je lui dise que Dieu l’aime malgré tout ce qu’il est et ce qu’il a fait. Je sais que Dieu aime sans condition, qu’un être humain est et reste un être humain à ses yeux, y compris le pire d’entre nous. Moi, je suis là, extérieure à tout cela. Je peux lui dire que Dieu ne l’a pas abandonné. On ne peut pas réduire une personne à son seul geste, il y a quelqu’un d’autre au-delà.
— Vous avez donc eu deux métiers : celui de psychanalyste dans votre cabinet et celui d’aumônier de prison que vous n’exercez plus ?
— Tout à fait. Ce sont deux choses différentes, mais tout à fait complémentaires, et non antinomiques. Le spirituel et le psychanalytique travaillent à des degrés de profondeur qui se rejoignent, les deux approches se complètent. Bien entendu, en prison, on ne savait pas que j’étais psychanalyste, j’étais l’aumônier qui écoute. Il y est l’une des rares personnes fiables à qui l’on peut se confier. C’est une denrée rare que de pouvoir parler à des gens à qui l’on peut tout dire sans risquer que cela se retourne contre soi.
— Dans votre livre, vous mettez l’accent sur la première parole échangée entre Dieu et l’humain, et c’est Dieu qui la prononce : « Où es-tu ? ».
— Dieu ne dit pas : « Je sais où tu es. Reste où tu es, ça m’est égal. » Il pose une question qui semble attendre une réponse. Elle est forcément essentielle et constitutive de la relation qu’il entretient avec l’humain. Cela lui donne de la consistance et au fait exister, offrant une possibilité de répondre, mais aussi de ne pas répondre. Cette question renvoie à une autre : « Où es-tu en toi ? Qu’as-tu fait de toi ? Où se trouve ce qui te constitue, ce qui fait de toi un être original, unique ? » Il est aussi important qu’elle puisse être posée à des personnes détenues, comme elle m’a été posée à moi-même.
— Ce « Où es-tu ? », ne dites-vous pas que c’est un Dieu caché, comme celui du Samedi saint, celui qui ne se donne plus à voir pour mieux se donner à entendre ?
— Pour moi, aujourd’hui, le Dieu des abîmes est le seul que je connaisse finalement. Il ne descend pas dans les entrailles du mal pour faire de l’effet sur une carte de visite. Où est-il donc passé ? Il n’est plus là où on l’attendait : ni devant ni derrière ni à côté. Il est en dessous. En dessous, comme une pierre de soutènement, comme le soubassement nécessaire à toute édification, mais aussi comme un berceau qui accueille l’enfant. Une main qui soutient le bras défaillant de la personne vulnérable. Le Dieu des abîmes est un Dieu qui ne se voit pas puisque, ayant choisi d’être en dessous, il reste caché. Ce Dieu-là, personne ne me l’avait enseigné ni au catéchisme ni dans les discours où tant de clercs privilégient encore un Dieu fort et exigeant en attente de notre repentance, faisant peser sur nos âmes généreuses un poids dont elles ne savent que faire. C’est lui le Dieu du Samedi saint, malheureusement trop souvent escamoté dans la liturgie catholique tant il nous presse de fêter la résurrection. Le Samedi saint, à mon sens, est le point de jonction, le pont, le passage obligé entre la mort et la résurrection de Jésus. Sans ce temps suspendu, ce moment où Jésus a disparu du regard des hommes, où les espoirs mis sur lui, les projections diverses et variées dont il a été gratifié disparaissent, s’effondrent, rien ne peut exister.
Propos recueillis par Michel LEGROS
Isabelle LE BOURGEOIS, Le Dieu des abîmes. À l’écoute des âmes brisées, Paris, Albin Michel, 2020. Prix : 17,75€. Via L’appel : -5% = 16,86€.