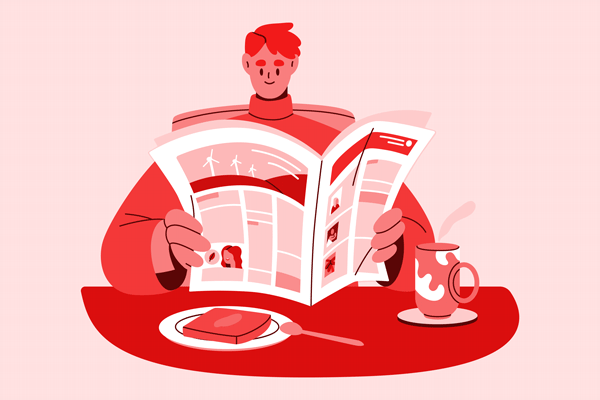Olivier De Schutter : « Changer le monde me met en mouvement »
Olivier De Schutter : « Changer le monde me met en mouvement »
Professeur en droit à l’UCLouvain, Olivier De Schutter (né en 1968) termine en mai son mandat de rapporteur de l’ONU pour les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, à un moment où ceux-ci, tout comme la coopération internationale et le rôle de l’organisation mondiale, sont lourdement remis en question et menacés.
Publié le
· Mis à jour le

— Quelques mots d’abord sur le début de votre parcours…
— Mon père était diplomate. Les premières années de mon enfance se sont passées en Inde, à Bombay, aujourd’hui appelée Mumbai. Mon plus ancien souvenir est d’avoir vu un enfant mendier à un feu rouge dans la ville et mon désir alors de lui donner de l’argent pour qu’il puisse se nourrir. Ce fut un moment décisif, une expérience fondatrice pour moi. Je me suis dit ce jour-là : « Je ne veux pas être complice de cela. Cette pauvreté est intolérable. » Ensuite, nous avons vécu dans d’autres pays, dont le Rwanda, qui m’a beaucoup marqué pendant mon adolescence. Je suis arrivé en Belgique à 15 ans, à la fin de mes études secondaires, pour la cinquième et la sixième. Avoir vécu ainsi dans ces pays en développement a beaucoup influencé tout mon parcours par la suite. À 18 ans, je n’ai pas hésité sur les études que j’allais suivre. J’ai choisi le droit comme un outil utile pour promouvoir la justice. J’avais un attrait dès le départ pour le droit public et les droits de l’homme, mais pas pour être avocat ou magistrat. Je suis devenu professeur dans ces matières.
— Qu’est-ce qui vous motive dans ce métier à la fois de transmission d’un savoir à des jeunes, de recherche et de publication ?
— La poursuite d’un idéal, sans doute un peu fantasmé, de justice sociale. La militance en ce sens est mon fil conducteur, ma boussole. J’espère susciter chez les étudiant·es cette étincelle qui les incite à s’investir pour le bien commun. Ce qui me met en mouvement est vraiment l’idée qu’il y a un monde à changer. S’il n’y avait pas cette dimension militante dans mon travail, si je ne le pratiquais que pour la science juridique, je serais beaucoup moins motivé.
Envie de lire la suite ?
Découvrez nos offres d’abonnement…
Vous aimez le contact du papier ? Vous aimez lire directement sur Internet ? Vous aimez les deux ? Composez votre panier comme bon vous semble !