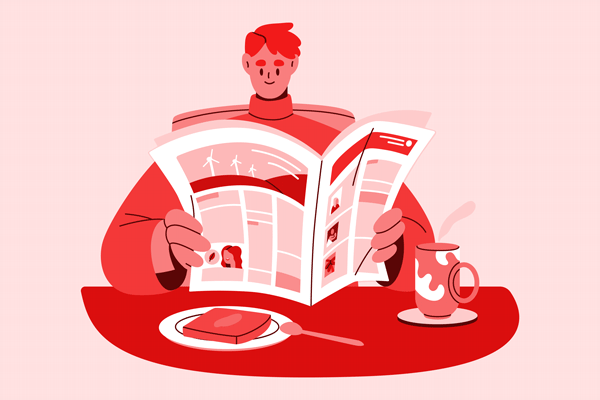Florence Aubenas : « J’ai trouvé mon identité en étant journaliste »
Florence Aubenas : « J’ai trouvé mon identité en étant journaliste »
Née à Bruxelles en 1961, mais de nationalité française, journaliste au Monde après avoir travaillé à Libération et au Nouvel Observateur, Florence Aubenas a prouvé ses talents de reporter, tant en France que sur des terrains de guerre, comme aujourd’hui en Ukraine. Avec les risques encourus : en 2005, elle a été retenue en otage pendant cinq mois en Irak. Dans « Ici et ailleurs », elle a réuni une cinquantaine de ses articles publiés depuis 2013.
Publié le
· Mis à jour le
–” Depuis le début de la guerre en Ukraine, en février 2022, vous y êtes allée à de nombreuses reprises. En quoi ce conflit est-il différent de ceux que vous avez couverts ?
–” C’est une guerre sortie d’un livre d’histoire. On est dans des tranchées, dans la boue, comme dans une guerre conventionnelle, principalement d’artillerie. Une guerre de front comme celle-ci, je ne connaissais pas. Mais si elle n’est pas pour autant plus violente que les autres.
–” Votre livre reprend plusieurs de vos reportages en Ukraine, mais aussi en France, avec les Gilets jaunes, notamment, ou dans des maisons de retraite pendant le confinement. Quelle est, selon vous, la différence entre les deux ?
–” Pour moi, honnêtement, il n’y en a pas. Pour peu que vous aimiez le reportage, la matière est toute autour de vous. J’aime autant les deux et je me force à alterner. J’ai commencé à faire du reportage en France et puis j’ai été envoyée à l’étranger. Tout ce qu’on me disait de faire, je le faisais, j’enchaînais sans jamais arrêter. Mais au bout d’un moment, c’était très nocif pour soi, pour les autres, rien ne ressemble plus à un conflit qu’à un autre conflit. Et petit à petit, on oublie le pays où l’on est. Je me suis dit que j’allais finir par faire du reportage hors sol, c’est-à -dire traiter la guerre et plus le pays en guerre. Or notre métier est de le montrer. Mais aussi celui où l’on vit.
–” Vos reportages sont, le plus souvent, construits autour de personnes. Ce goût des gens, vous l’aviez enfant ?
–” Non, je suis devenue qui je suis parce que je suis journaliste. J’ai trouvé ma vocation, presque mon identité en étant journaliste et pas l’inverse.
–” Le journalisme n’était pas pour vous une vocation ?
–” Pas du tout. Jamais, enfant je n’en ai rêvé. J’ai passé mon enfance à Bruxelles et, à 18 ans, j’avais envie d’avoir mon indépendance et je suis allée à Paris faire des études de lettres, sans trop savoir pourquoi, sans doute parce que j’aimais bien lire. Au bout de deux ans, mon père m’a demandé ce que je voulais faire. Comme il n’était pas question que je sois prof, je n’avais pas la vocation, j’ai regardé ce que je pouvais faire avec un bout d’études de lettres. Il y avait notamment journalisme et j’ai intégré une école. C’est donc un peu par défaut que je suis devenue journaliste. Maintenant, j’adore ça, je ne changerai pour rien au monde.
–” Vous êtes allée d’emblée sur le terrain ?
–” Non, j’ai commencé au Nouvel Économiste comme secrétaire de rédaction, un métier de nuit à l’époque. Je vivais dans une grande maison en colocation avec des amis, j’aimais cette vie empreinte d’une espèce de romantisme. Mais je ne me disais pas que j’allais faire Tintin reporter, je ne me posais pas ces questions-là . Travailler dans un journal me plaisait, je trouvais extraordinaire la vie d’une rédaction, cela me suffisait. Et c’est au quotidien Libération, où je suis arrivée en 1986, qu’on m’a proposé de passer au service Société. Je me suis dit pourquoi pas ? Quand j’ai commencé à rencontrer des gens, à les interviewer, et à écrire ensuite des articles, j’ai compris que c’était vraiment mon truc. J’étais fasciné par le fait que les personnes vous répondent très sérieusement.
–” Vous vous sentiez légitime ?
–” Oui. Non pas parce que je suis formidable ou je ne sais quoi, mais parce que les questions qui me venaient étaient sincères. Je me suis d’ailleurs peu fait envoyer balader. Le journalisme est une espèce de loupe sur les humains et cet effet zoom est réversible : si vous n’êtes pas sincère, cela se voit, on ne peut pas jouer. Mais si, en rentrant dans l’école de journalisme, on m’avait demandé ce que je voulais faire, si je me voyais interroger des gens dans une manifestation, partir dans un pays en guerre…, je ne me serais pas du tout projetée là -dedans. J’ai découvert ce que j’aimais faire et ce que je savais faire en le faisant. Vous pouvez avoir une vocation très très forte, ce qui est mon cas, en le sachant tard et par hasard.
–” Vous aviez aussi un goût pour l’écriture…
–” à‡a vient de mes études de lettres. C’est vrai que, quand on parle de journalisme, les gens se rendent peu compte qu’entre la radio, la télé ou la presse écrite, c’est très différent. C’est comme jouer d’un instrument différent dans un orchestre.
–” Et c’est aussi par hasard que vous êtes devenue reporter de guerre…
–” À un moment donné, on devient réellement professionnel. On se dit, ce reportage, j’aimerais bien le faire, je le ferais comme ci, comme ça. On commence à lire les journaux en pensant tiens, un tel est allé là … Notre regard s’affûte progressivement, ce qui a été mon cas. Au lendemain du génocide, à Libération, ils cherchaient quelqu’un pour partir au Rwanda, le journaliste qui le faisait devant être remplacé. Et je me suis portée volontaire.
–” Dans quel état d’esprit êtes-vous partie ?
–” J’étais Bécassine à la guerre. Aucune école de journalisme ne vous forme à cela, même aux gestes de base. Quand je me suis retrouvée sur place, j’étais estomaquée, je ne savais pas comment me comporter. à‡a a commencé à tirer assez vite, je suis monté sur une butte car je ne voyais rien, et c’est un confrère qui m’a couchée par terre, me sauvant la vie. Ce n’est que petit à petit que vous avez peur. Elle arrive avec la conscience de ce qui se passe. Vous vous rendez compte de ce qu’il faut faire ou pas, de ce qui est dangereux.
–” Comment se débrouille-t-on sur place ?
–” Il y a un cà´té très logisticien, ce métier exige beaucoup de débrouillardise car tout est problème. Vous devez trouver à manger quand il n’y a pas à manger, un endroit pour dormir quand il n’y en a pas. Si vous n’avez plus de bloc-notes, vous devez en trouver un. J’aime bien ce cà´té-là . Vous êtes dans un état de conscience extrême, vous n’avez jamais été aussi réveillé de votre vie. Vous êtes à 100 % dans ce que vous êtes en train de faire, vous ne pouvez pas rêvasser. Et finalement, vous devez vous asseoir quelque part pour écrire votre papier, l’envoyer, parfois pendant plusieurs mois, comme cela a été le cas lors de mon premier grand reportage. Si vous avez fait vos preuves, on vous sollicite pour la suite. C’est ainsi que j’ai été envoyée au Congo, au Burundi, et plus tard en Algérie, en ex-Yougoslavie.
–” Pour rendre compte de la complexité des situations, comment faites-vous ?
–” Toute la difficulté de la presse est là . Il faut comprendre la situation le plus rapidement possible car tout va très vite. De quel « poste d’observation– , si j’ose dire, allez-vous avoir la meilleure vue de ce qui est en train de se passer ? Sachant que, dans une guerre, il est très compliqué de couvrir les deux cà´tés. Par exemple, aujourd’hui, vous êtes soit cà´té russe, soit ukrainien, et la chose la plus dangereuse est de traverser la ligne de front.
–” Pour les contacts avec les gens sur place, le reportage de proximité vous a servi ?
–” J’ai toujours travaillé un peu de la même façon. à‡a m’a toujours davantage intéressé d’interviewer un manifestant qu’un président de la République. Spontanément, ce qui me plaisait, c’était d’aller traîner mes chaussures dans les ruisseaux. Et comme, un terrain de guerre est un vrai travail de terrain, ça aide.
–” Être une femme, est-ce un avantage ou un désavantage quand on est reporter de guerre ?
–” En Ukraine, cela n’a pas grande importance. Sur les terrains de violences, des guerres civiles, des tremblements de terre, pour moi, c’est plutà´t une chance. Je pense que la guerre étant quelque chose de très masculin, estampillée virile, pour aller vite, si vous ne faites pas dans la surenchère, vous avez beaucoup à y gagner. Si vous arrivez à un checkpoint et négociez plutà´t que de dire, j’y vais parce que je suis journaliste, vous passez plus facilement. Mais j’ai aussi couvert les manifestations en Égypte, au moment des printemps arabes, et là , c’est le contraire, parce qu’il y avait des viols, etc.
–” En France, vous avez suivi l’affaire du pseudo-réseau pédophile d’Outreau dont vous avez tiré un livre. En quoi ce procès vous a-t-il marqué ?
–” À la fin des années 1990 et au début des années 2000, suite notamment à Marc Dutroux, la lutte contre la pédophilie prend de l’ampleur, la vigilance est accrue. Ce procès, où treize personnes sont mises en examen, est prévu pour durer un mois et demi à Saint-Omer, dans le nord de la France, au printemps 2004. Il y a peu de volontaires au journal pour le suivre. Je le suis. Et ça m’a pris aux tripes. C’est une histoire incestueuse horrible, avec un couple de parents, les quatre enfants et deux voisins, ce ne sont pas des inventions. En revanche, les autres personnes autour, ça oui, s’en sont. Nous, les journalistes, on pense qu’on va être face à un énorme réseau. Mais, au fur et à mesure des audiences, on se rend compte que, s’il y a bien un inceste familial, le reste du dossier est en train de partir en lambeaux. Des gens qui voulaient faire le bien, un juge d’instruction qui entendait protéger des gosses, des psychologues, tout ce monde qui était vraiment décidé à aider des enfants ont en provoqué une catastrophe. Je me suis demandé comment toute cette mécanique s’était mise en place. C’est de là qu’est née l’idée d’en faire un livre.
–” En Irak, où vous êtes partie fin 2004, vous allez être retenue cinq mois comme otage. En France, votre journal de l’époque, Libération, fait une grande campagne pour votre libération. Cela sert-il à quelque chose ?
–” J’en suis persuadée. Cela vous sert de bouclier par rapport à vos agresseurs, ça vous protège. Les prises d’otages, pendant longtemps, étaient une manière de faire connaître sa cause. L’idée n’était pas de tuer, mais d’échanger. Mais, après le 11 septembre et la reconfiguration du monde et des conflits, ça a vraiment changé. Pour Al-Qaà¯da puis Daech, un otage n’est plus simplement quelqu’un qui va permettre de faire parler de vous. On le garde justement pour l’exécuter en cas de défaite : je sors le prisonnier de sa cache, de sa cave, je l’habille en orange et je l’égorge sur internet. Je filme ça, je vous l’envoie, pour dire qu’on est quand même les plus forts.
–” Dans quels états physique et moral étiez-vous à votre retour ?
–” J’avais perdu quinze kilos, je voyais très mal parce que j’étais restée tout le temps dans le noir et, vu qu’on ne bouge absolument pas, j’avais perdu tous mes muscles. Je traversais la rue comme une personne âgée, j’avais du mal à courir, je n’avais plus de force. Et pourtant, l’explosais de joie, j’allais extrêmement bien, c’était les plus beaux jours de ma vie tant j’étais contente d’être là . Être sortie de cette cave était pour moi une telle renaissance que, quand des copains me téléphonaient pour me demander comment j’allais, je leur disais avec enthousiasme : « Très très bien. » Et je sentais comme une déception au bout du fil, il y avait une sorte d’incompréhension.
–” Vous avez repris rapidement le travail ?
–” Assez, oui. En partant en décembre, j’étais en train d’écrire ce livre sur l’affaire d’Outreau. Et le dernier procès, qui aurait dû avoir lieu pendant que j’étais otage, avait été ajourné. Je me suis donc replongé dans mon bouquin. Cela m’a aidé de me remettre tout de suite dans le circuit.
–” Vous y pensez toujours aujourd’hui ?
–” Oui, bien évidemment, très souvent, je n’ai pas envie de tourner la page, c’est une expression qui me semble absurde quand on vit ce genre de choses. Mais si ça m’accompagne, et m’accompagnera toujours, cela ne m’empêche pas de vivre, ce n’est pas traumatique. Ce n’est pas quelque chose qui a modifié ma façon de vivre.
–” Après cette expérience, vous n’avez pas peur de retourner sur des terrains de guerre ?
–” Quand, deux ans plus tard, je suis repartie en Afghanistan, je ne faisais pas la fière, je ne la ramenais pas. Je me suis dit : je vais arriver là -bas, je vais entendre tirer, je vais faire un bond en l’air et je vais être comme ces gens qui ne parviennent plus à sortir de l’hà´tel. Si cela avait été le cas, j’aurais été bien embêtée parce que c’est ma vie quand même.
–” Et pour cette vie, vous avez renoncé à une vie ne famille ?
–” Non, je n’ai pas du tout renoncé, j’ai travaillé et cela s’est trouvé comme ça. Mais, à aucun moment, je me suis dit que je ne fondrais pas de famille. J’ai mis mon travail en avant, sans me poser de questions, et cela ma va très bien, je n’ai pas eu l’impression de faire des sacrifices. Je ne le regrette pas une seconde. Pour moi, l’important, et je crois que c’est propre à ma génération, surtout quand vous étiez une femme, c’était de travailler, d’y arriver. On voulait prouver qu’on était capable de le faire. Et me battre pour ce boulot de grand reporter était important pour moi. C’est aussi le fruit d’une tradition familiale. Mes parents avaient divorcé et ma mère, qui était féministe, nous disait, à ma soeur et à moi, qu’il était important de vivre par son travail, sans dépendre de personne. S’il nous arrivait quoique ce soit, il fallait compter sur soi-même.
–” Pour vous, l’essence du journalisme, c’est le terrain ?
–” Oui, tel que je le pratique, c’est le terrain et l’information de première main. Et on en a besoin. Pour moi, le journalisme est loin d’être mort, c’est un faux débat total. On va sûrement le pratiquer autrement, aujourd’hui, aucun journaliste ne peut rivaliser avec l’info immédiate en cent quarante signes ou je ne sais quoi. Dès lors que ce type d’informations existe, les journaux sont obligés de faire davantage de terrain, de longs formats.
–” Vous vous sentez utile ?
–” Plus jeune, j’ai cru qu’un article pouvait changer les choses, provoquer une réaction. Évidemment, je suis largement revenue de tout ça, ça ne se passe pas ainsi. Je pense néanmoins que la presse est une condition nécessaire au changement. Elle est une petite pierre dans un mur à construire. Donc oui, je me sens utile en ce sens-là . Mais dire qu’on est les seuls, sûrement pas.
–” Vous vivez en France depuis plus de quarante ans. Quels souvenirs gardez-vous de la Belgique ?
–” C’est un pays que j’adore et dont je continue à me sentir très proche. Quand je rentre à Bruxelles, je rentre à la maison. Il y a une gentillesse, une simplicité ici que je n’ai pas rencontrée ailleurs. Et puis, la Belgique, c’est un certain nombre de mots que je continue à dire, une certaine lumière. Elle est très importante pour moi. J’ai en permanence l’impression d’être une envoyée spéciale en France, je suis chez moi, mais pas tout à fait.
Propos recueillis par Michel PAQUOT
Florence AUBENAS, Ici et ailleurs, Paris, L’Olivier, 2023. Prix : 21,50€. Via L’appel : -5%= 20,43€.