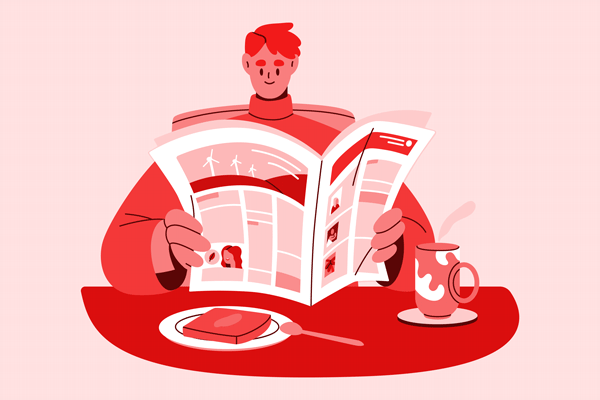Isabelle Ferreras: « Je ne suis pas une self-made-woman »
Isabelle Ferreras: « Je ne suis pas une self-made-woman »
Petite-fille d’André Oleffe, président du Mouvement Ouvrier Chrétien, Isabelle Ferreras porte haut les valeurs de justice sociale qu’elle a reçues en héritage. Née en 1975, cette professeure de sociologie du travail à l’UCLouvain, chercheuse FNRS et chercheuse senior associée à Harvard, est devenue en 2017 la plus jeune académicienne de Belgique. Quatre ans plus tard, c’est en tant que présidente de la vénérable institution qu’elle décide d’en bouleverser les statuts en faveur d’une totale parité hommes-femmes.
Publié le
· Mis à jour le

— À l’époque de votre entrée à l’Académie royale de Belgique, vous disiez ne pas être là pour un sprint, mais pour un marathon. Devenue présidente, vous vous êtes attelée à la réforme de ses statuts afin de la dépoussiérer de son image vieillissante et masculine. Sa composition la desservait-elle dans son rôle de service et de conseil à la société ?
— Penser que, dans une société comme la Belgique, une institution censée représenter l’excellence n’était composée qu’à 20% de femmes, ça ne pouvait que choquer. On allait droit vers un problème de légitimité, étant donné ce biais en faveur d’hommes âgés venant d’un milieu homogène. Mais, pour moi, c’était surtout important de penser qu’on perpétuait des mécanismes de domination des femmes : en devenant présidente, j’ai constaté avec effarement que leur place était en régression. Bien sûr, la covid n’a rien arrangé à l’avancement de l’égalité. Mais en laissant de telles disparités s’installer, on ne crée pas les conditions pour changer l’ordre des choses. La question est structurelle, notamment à cause des logiques de cooptation. Il fallait donc une réforme structurelle.
— Cela a été difficile ?
— Au début, beaucoup de personnes me trouvaient très radicale dans mes attentes. Mais j’ai bénéficié d’une série d’allié·es, dont Françoise Tulkens, qui avaient pris la mesure du problème. Nous avons mis en place un double mécanisme qui permettra d’à la fois féminiser et rajeunir l’Académie. D’une part, l’augmentation du nombre de fauteuils permettra l’entrée de huit femmes par an pendant cinq ans. Et, d’autre part, quand deux fauteuils se libèreront, l’un d’eux ira automatiquement au genre le moins bien représenté, jusqu’à ce que la parité soit atteinte.
— Il était important de continuer à pouvoir élire des hommes ?
— Oui, il est hors de question de les pénaliser, d’autant qu’aujourd’hui, beaucoup d’hommes sont les alliés des femmes, en tout cas dans ma génération. Il aurait été injuste qu’ils soient punis au nom du passé.
— Ce nouveau modèle va-t-il faire avancer la parité dans les autres académies, ou dans les universités ?
— Les choses ne changeront pas sans réformes institutionnelles et statutaires. On le voit en politique, notamment via la mise en place de la tirette sur les listes électorales, ou dans les conseils d’administration des grandes entreprises. Dans les grands groupes sociaux, on fonctionne toujours dans des logiques de cooptation, en choisissant des gens qui nous ressemblent, parce que ça nous rassure. Il faut se donner des règles communes pour que ce ne soient pas nos petites faiblesses individuelles qui soient aux commandes, mais les principes ambitieux auxquels nos institutions se réfèrent. Il faut que ça avance, c’est évident ; c’est compliqué, c’est évident ! Dans le milieu académique, il y a autant de femmes doctorantes que d’hommes, mais, hélas, les conditions pratiques de la carrière marginalisent les femmes, et notre vision de l’excellence, notre conception du génie, sont toujours masculines.
— Votre féminisme ne s’agite pas comme un fer de lance, mais trame tous vos engagements. Votre dernier ouvrage, Le Manifeste travail, réunit, autour des questions de la démocratisation de l’entreprise, de la démarchandisation du travail et de la dépollution de la planète, dix autrices d’envergure sans que leur genre soit mis en avant. Et il est rédigé en écriture inclusive. Celle-ci va changer le monde ?
— C’est fondamental ! Les aveuglements qui sont les nôtres se transmettent naturellement par le langage. Et tant qu’on ne les visibilise pas, ils perdureront. Les hommes, ça ne veut pas dire les hommes et les femmes, ça veut dire les hommes. Pour parler de l’ensemble de l’humanité, on peut parler des humains. Il faut dire aux filles qu’elles ont leur place en tant que telles, et qu’elles n’ont pas à devenir comme un homme pour pouvoir occuper telle ou telle fonction.
— De l’enquête de terrain à l’analyse socio-politique, votre travail de chercheuse vous a conduit à considérer l’entreprise comme un espace politique à démocratiser. Votre thèse, déjà, portait sur les caissières, vues comme les nouvelles ouvrières d’un monde de plus en plus automatisé. Trente ans plus tard, cette automatisation a investi le monde des services jusqu’à celui du soin. Aujourd’hui, des soignant·es en maisons de retraite disposent de neuf minutes pour faire la toilette d’une vieille personne. Par ailleurs, on assiste à une uberisation de plus en plus grand du monde du service. On sous-traite, et donc on précarise. Vous prônez l’installation d’une double chambre de décision dans l’entreprise, où les travailleur·euses (les investisseur·euses en travail) seraient à pied d’égalité avec les actionnaires (les investisseur·euses en capital). Mais comment installer ce bicamérisme dans des entreprises qui sous-traitent de plus en plus le travail ?
— C’est une énorme question. Ces tendances sont de plus en plus massives. Est-ce complètement fou, voire ridicule, de réfléchir à la démocratisation du travail ? Toutes les études démontrent que les individus veulent peser sur leurs conditions de travail et sur ses finalités. Ils ne renoncent jamais à avoir un avis sur leur propre vie. Heureusement ! Qu’est-ce que la société va faire de cette attente ? Est-ce qu’on laisse les logiques de domination se développer ? Ou bien va-t-on chercher à soutenir ce que j’appelle « l’intuition critique de la justice démocratique » au travail ? Aujourd’hui, le rapport de force est contraire au déploiement de cette intuition critique. Mais, en s’appuyant sur elle, on peut chercher à équiper la société et ses acteur·trices, de sorte que les travailleur·euses puissent choisir un futur qui corresponde à leurs aspirations. C’est une question autant éthique que politique. Personnellement, j’ai ce privilège inouï de ne pas être soumise à ces logiques de domination. Et je me sens hyper-responsable de cette chance que j’ai de pouvoir penser librement à ces enjeux et d’en faire avancer la compréhension. Il faut réfléchir à l’équipement institutionnel qui va soutenir cette intuition critique. C’est ce que j’appelle la démocratisation de l’entreprise.
— Comment en vient-on à s’intéresser au travail, à l’entreprise, à la gouvernance économique et à en faire son métier ?
— Il y a plusieurs sources à cette « vocation » – car je la vis comme ça, comme un engagement au service de la connaissance. L’une d’elles est ma personnalité : j’ai toujours voulu faire sens du monde, comprendre où je vivais. Il y a sans doute aussi un engagement d’ordre familial. Mon grand-père paternel était le seul homme lettré de son petit village castillan, à la fois maire, juge et écrivain public. Il a pris part toute sa vie à la vie collective. Ma mère vient d’une famille très engagée dans le milieu social-chrétien. Mon histoire a été intimement liée à celle de mon grand-père, André Oleffe : son cancer a correspondu à la grossesse de ma mère et je suis née le jour de son enterrement. C’est une personnalité qui m’a marquée. Fils d’ouvrier typographe imprimeur à Court-Saint-Étienne, doué dans son parcours scolaire, il a bénéficié d’une bourse pour étudier à Solvay. Mon grand-père a toujours été au carrefour de plusieurs mondes. C’est quelque chose que j’ai reçu de lui et que, visiblement, je perpétue : il a fait une carrière au service du bien public, il est devenu directeur de la Commission bancaire et financière ; en même temps, il était engagé dans le Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC). Il était au carrefour du monde du capital et du monde du travail, du monde de la libre pensée – car en tant qu’ulbiste, il se définissait comme libre penseur – et du monde chrétien – le MOC, et, à la fin de sa vie, le conseil d’administration de l’Université Catholique de Louvain dont il était président. Ces ponts n’étaient pas évidents à l’époque.
— Votre mère, Jeanne-Marie Ferreras-Oleffe, est toujours conseillère communale à Ottignies-Louvain-la-Neuve, et s’est illustrée récemment par son refus de trahir l’accord de majorité conclu après les dernières élections. Elle a aussi été échevine des affaires sociales et présidente du CPAS. Une maman engagée, c’est un modèle ?
— Ma mère est une de mes figures inspirantes. Elle a toujours conçu son passage de la vie sur terre comme une épreuve qui devait servir à quelque chose. Elle a été la plus jeune conseillère communale à Ottignies, élue dès avant ma naissance, et s’est toujours engagée pour la cité. La figure de son père était très importante, mais aussi celle de sa propre mère. Ma grand-mère était très engagée dans Vie Féminine : féministe sans le dire – c’est un mot que je n’ai jamais entendu prononcer chez elle. Chaque mois, elle allait apporter le journal de Vie Féminine à toutes les femmes de la région d’Ottignies et de Mont-Saint-Guibert qu’elle couvrait bénévolement. Elle prenait des nouvelles de chacune et tissait ainsi tout un réseau de solidarité très important. Les femmes de ma famille étaient des figures fortes. Mais n’est-ce pas une banalité de dire cela ? Dans toutes les familles, les femmes sont des figures fortes. Ma mère m’a toujours transmis, sans nécessairement le dire, qu’il fallait faire du mieux qu’on pouvait, que si on avait la possibilité d’être utile, il fallait le faire, qu’il fallait s’engager… au nom de la solidarité avec les humains.
— Avez-vous reçu une éducation catholique ? Sur ces trois générations, voire une quatrième, on sent très fort la transmission de certaines valeurs…
— Des valeurs personnalistes chrétiennes, clairement. J’ai été élevée dans un milieu de chrétiens de gauche. Ceux-ci font peut-être partie des plus radicaux : les valeurs priment. On ne fait pas semblant d’être progressiste au prix de certains accommodements. Oui, j’ai reçu cette éducation. Mais c’est aussi une culture d’un grand respect pour la différence, ce que j’apprécie. Son socle articule fortement liberté et égalité. Dans la perspective personnaliste chrétienne, il y a cette idée que chaque individu a une valeur infinie aux yeux de Dieu et qu’au-delà des différences, nous sommes tous égaux. Chaque individualité a une valeur inestimable. C’est une synthèse très particulière entre le libéralisme et le socialisme. Voilà qui dit d’où je viens : avec modestie, je suis le produit d’une histoire et pas une self-made-woman.
— En ce qui vous concerne, cela implique une grande responsabilité, notamment sociétale. Mais aussi environnementale. La transition écologique est également une préoccupation majeure pour vous…
— Si on a la chance d’être éduqués comme nous le sommes, informés comme nous le sommes, en contact avec les milieux scientifiques de toutes disciplines qui alertent sur l’état de destruction de la planète, le périmètre de notre responsabilité ne peut pas s’arrêter à la question de l’égalité entre humains. Il faut intégrer cette dimension qui est comme la borne dans laquelle nous devons vivre : nous n’avons qu’une planète, elle est magnifique et nous sommes en train de la détruire. En travaillant sur le système extractif de l’entreprise, je constate que, comme elle épuise les individus, elle épuise la planète. La logique est la même. Il faut agir à la racine de ce problème et sortir de cet extractivisme.
— Ne faudrait-il pas un quatrième terme à la devise Liberté-Égalité-Fraternité (ou solidarité)? Qui serait “Vivant” ?
— Oui ! Certains diront que la fraternité inclut solidarité et peut inclure le vivant. D‘autres pensent qu’il n’y aura pas de liberté sans le cadre habilitant du respect de notre planète Terre.
— Vous avez deux filles de treize et neuf ans. La relève est assurée ?
— Elles lisent déjà Les culottées de Pénélope Bagieu. C’est bien parti !
Propos recueillis par Dominique COSTERMANS