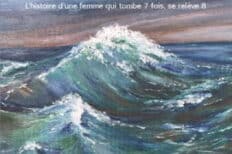La prière qui cuirasse les soignants
La prière qui cuirasse les soignants
Chaque année, les statistiques d’actes de violence envers les soignants atteignent de nouveaux sommets. Avant le dépassement de la ligne rouge qui impose au soignant de s’en protéger, il y a un espace pour l’éthique dans la relation de soin. Qu’apprend-on aux médecins pour passer d’une attitude de jugement à celle de compréhension ?
Publié le
· Mis à jour le

Chaque année, les statistiques d’actes de violence envers les soignants atteignent de nouveaux sommets. Avant le dépassement de la ligne rouge qui impose au soignant de s’en protéger, il y a un espace pour l’éthique dans la relation de soin. Qu’apprend-on aux médecins pour passer d’une attitude de jugement à celle de compréhension ?
Les récentes agressions d’infirmières dans des hôpitaux bruxellois remettent régulièrement le sujet des violences dans les soins en haut de l’actualité. Encore au début du mois d’octobre, une toute jeune stagiaire infirmière se faisait poignarder dans le dos par un patient. « La violence n’est pas une exception, mais une expérience partagée », rappelle l’Institut Vias dans sa dernière enquête menée au printemps 2024 auprès de 1711 professionnels belges des soins et des services d’urgence. Plus de neuf répondants sur dix disent avoir été confrontés, au moins une fois dans l’année, à un acte de violence ou d’agression.
Dans les hôpitaux, Vias relève que 88% du personnel interrogé a subi des cris, 78% des insultes, et plus d’un soignant sur deux des poussées ou des coups de pied. Près de 29% déclarent même avoir été blessés. Les auteurs de ces violences sont le plus souvent des patients, parfois des proches. Les procédures formelles de signalement restent peu utilisées. Ces données, précise l’institut, ne représentent donc que la partie émergée du phénomène.
APPROCHE ÉTHIQUE
Dans ce paysage de statistiques affolantes, où la violence s’invite quotidiennement dans le travail des équipes soignantes, le philosophe et éthicien Jean-Michel Longneaux propose une approche résolument clinique et éthique de la relation soignant-patient lorsque celle-ci déraille. Il constate une pente spontanée qui consiste à juger et à individualiser : « Le plus souvent, ce thème va être abordé à travers le prisme de la responsabilisation, avec, à la clef, l’idée d’empêcher les patients d’être violents. »
Envie de lire la suite ?
Découvrez nos offres d’abonnement…
Vous aimez le contact du papier ? Vous aimez lire directement sur Internet ? Vous aimez les deux ? Composez votre panier comme bon vous semble !