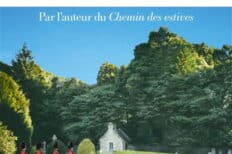La spiritualité en prison, pourquoi pas ?
La spiritualité en prison, pourquoi pas ?
Il existe une aumônerie catholique dans tous les établissements pénitentiaires. C’est une vocation pour des prêtres envoyés par l’évêque dans l’un d’eux. Jadis réservée aux ecclésiastiques, la fonction s’est laïcisée et féminisée. Claude Decocq est l’une de ces bénévoles.
Publié le
· Mis à jour le

Claude Decocq, mère de famille, grand-mère et anciennement collaboratrice au Jesuit European Social Centre est, depuis cinq ans et demi, aumônier (elle tient au masculin) à la prison d’Ittre, un établissement de haute sécurité qui compte quatre cent vingt détenus. Les mardis et vendredis, accompagnée par trois collègues, dont un prêtre, elle y rencontre ceux qui en ont fait la demande. Être aumônier, ce n’est pas sortir d’un moule : le background de ceux et celles qui le deviennent est très varié, d’assistant social à agriculteur, d’enseignante à juriste ou entrepreneur. Une diversité qui constitue une richesse pour cette vocation n’exigeant pas de formation de départ type. L’aumônier est simplement censé avoir une bonne expérience de la vie. Et un enracinement dans l’Église est également nécessaire. Si un master en théologie n’est pas requis, il nécessite en effet des bases et une inscription dans une vie paroissiale. Claude Decocq a effectué un stage de quatre mois dans une prison avant de rencontrer son évêque qui l’a envoyée en mission, d’abord à Tournai, aujourd’hui à Ittre.
SOUTIEN MORAL
Au quotidien, ces hommes et ces femmes assurent l’eucharistie ou un partage d’Évangile hebdomadaire en prison. Auprès des personnes détenues qui le souhaitent, elles font un travail d’accompagnement. Il leur faut comprendre que, derrière des demandes matérielles, se dissimule parfois un besoin de soutien moral, tel que : « la prison est difficile pour moi et je voudrais parler à quelqu’un. Parler au psychologue, c’est compliqué… » Des demandes d’ordre spirituel peuvent aussi survenir : accompagnement, prière, sacrement de réconciliation… Il arrive aussi que le détenu ne formule pas de souhait explicite. C’est à l’aumônier de s’adapter. « Nous sommes des hommes et des femmes de foi qui rendons témoignage à plus grand que nous ; nous avons une fonction symbolique », résume Claude Decocq.
Celle-ci évoque une rencontre avec un détenu qu’elle accompagne depuis cinq ans : « longtemps, pendant ma visite, il n’éteignait pas la télévision qu’il continuait à regarder d’un œil et la conversation était extrêmement pauvre apparemment. Il n’avait pas vraiment l’air content de me voir, mais je savais néanmoins que c’était important que je vienne car il n’avait aucun contact avec l’extérieur. Ce n’est que ces dernières semaines qu’il éteint la télévision et que nous pouvons avoir des échanges authentiques, évoquer sa honte et son espérance, envisager une trajectoire de l’une à l’autre… Mais c’est récent et ténu. Parfois, il semble qu’il ne se passe rien et puis, tout de même, quelque chose advient qui ne nous appartient pas… » Ses visites se poursuivent tant qu’il ne manifeste pas la volonté d’y mettre fin. « Nous avons aussi la conviction que plus la personne est pauvre, démunie, rejetée, non seulement par la société, mais aussi par son entourage et la prison, plus elle doit être privilégiée dans nos rencontres. » Pour elle, « l’option préférentielle pour les pauvres est évidemment d’application dans le milieu carcéral ».
L’ÉCOUTE DES PETITS
« La rencontre transcende le jugement moral que nous pouvons bien sûr avoir sur les faits commis par la personne que nous écoutons. Si elle est dans le déni total ou si elle adopte une posture séductrice ou manipulatrice, notre lucidité est requise pour lui renvoyer notre désir d’une relation authentique. En aumônerie, l’écoute cherche toujours à être en vérité, car c’est cette vérité qui libère. Même s’il peut y avoir, selon la personnalité de chacun, différentes manières d’entreprendre le déni, la visée reste celle d’une rencontre qui se dépouille des faux-semblants, sous le regard aimant d’un Dieu qui peut tout entendre. Mais cela passe souvent par un temps où nous actons simplement où en est la personne à un moment donné. Car reconnaître la réalité de faits graves est difficile et c’est un chemin. »
Les aumôniers ne sont là ni pour accabler ni pour mener des investigations psychologiques, mais pour témoigner d’un regard qui, au-delà de tout, aime et ouvre à une espérance renouvelée. Dans cet accompagnement-là, il s’agit de sentir les choses et de toujours se souvenir que la grâce peut davantage, que la bonne volonté et la compétence de l’aumônier sont absolument nécessaires, mais que l’essentiel se passe ailleurs. En outre, les aumôniers travaillent toujours en équipe de deux, jusqu’à quatre selon la taille de la prison, ce qui permet d’échanger sur les accompagnements qui posent question et d’éviter les exclusives. La durée des entretiens varie en fonction de la demande et dépend aussi du fonctionnement interne de la prison. À Ittre, les aumôniers sont traités comme des collègues par les agents et leur travail est soutenu par l’équipe de direction. La prison est bien gérée et il est donc possible d’avoir facilement un entretien. Mais il y a d’autres prisons où ce n’est pas le cas.
UN SYSTÈME BROYEUR
« Le système broie parce qu’il est bâti sur une exigence sécuritaire, juge Claude Decocq, mais son intention explicite n’est pas de broyer. La loi de principe prévoit de permettre une détention plus humaine et d’aider les détenus à se réinsérer. Son intention, au-delà de la sanction, est de sauvegarder les droits et la dignité des personnes détenues et de faciliter la réinsertion dans la société. Je vois ce désir même parfois dans le chef des directions de prisons et des services psycho-sociaux dédiés. Mais la logique systémique, impersonnelle, rigide et le manque de financement font que ce que nous entendons des détenus, ce que nous voyons, c’est quand même un système carcéral qui écrase les individus. Entre manque de temps, manque de personnel dans les prisons et parmi les acteurs sociaux, et contraintes de fonctionnement, il reste peu de place pour trouver des solutions un peu plus personnelles. C’est difficile indépendamment de la bonne volonté des acteurs. »
Il existe d’autres formes d’écoute en prison. Le SPS (service psycho-social des établissements pénitentiaires) évalue les capacités de réinsertion des détenus… qui ont souvent vis-à-vis d’elle un regard très négatif. Ils ne se sentent en effet ni écoutés ni entendus par ses psychologues, alors qu’ils ont plutôt un regard positif face aux services d’aide extérieurs (SAD), malheureusement débordés… La spécificité de l’aumônerie est d’offrir une écoute longue. L’aumônier n’a pas une position surplombante d’expert, mais fraternelle. « Lorsqu’un travail avec les psychologues est parfois trop exigeant pour certains détenus, explique Claude Lecocq, ils peuvent reprendre souffle avec nous dans une autre forme d’attention. Mais il ne s’agit pas d’opposer les services. En fait, nous sommes très complémentaires au sein d’une prison. Et cette indispensable complémentarité doit servir à la fois la personne détenue et la société, même si cela n’est pastoujoursbien compris. »
Thierry MARCHANDISE