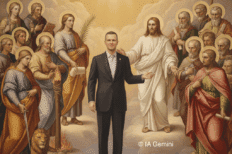Les péchés plus si capitaux que ça
Les péchés plus si capitaux que ça
Avec son thème traditionnellement “catholique”, cette exposition verviétoise dédiée aux sept péchés capitaux pourrait donner l’envie de ne pas aller la voir. Au contraire, celles et ceux que les questions de sens interpellent devraient s’y rendre. Car on y aborde le sujet d’une bien originale manière.
Publié le
· Mis à jour le

« Les sept… quoi ? Je ne vois pas ce que tu veux dire. » Qui, parmi les moins de soixante-cinq ans, connaît les “sept péchés capitaux” et sait ce que ces mots signifient ? Quant aux plus âgés, ils ont bien un jour plus ou moins su ce qu’ils représentaient. Mais de là à en citer sept… Ils n’en connaissent souvent qu’un : la luxure. Hormis dans les milieux “catholiques-jusqu’au-bout-des-ongles”, les prescrits du catéchisme, les catégories des péchés, leur confession obligatoire…, tout cela a été remisé au grenier. Et ne rappelle plus que des mots entendus de la bouche d’arrière-grands-parents, ou de religieux parfois pas si vieux que cela…
MONSTRUEUX
Dans le catholicisme, le nombre de “péchés capitaux” et leurs noms ont été fixés au quatrième concile de Latran (1215), qui classera dans cette catégorie l’orgueil, l’avarice, l’envie, la colère, la paresse, la gourmandise et la luxure. Toutefois, huit “mauvaises pensées” avaient déjà été pointées dès le IVe siècle par Evagrius Ponticus, un des “Pères du désert”, ces moines-théologiens qui vivaient en Égypte. Cette nomenclature, ramenée en 590 à sept péchés par Grégoire Ier, servira de base à l’inventaire dressé au concile de Latran, puis officialisé par Thomas d’Aquin dans sa Somme théologique.
Alors qu’il ne faut pas confondre “péché capital” et “péché mortel”, la peur de ces manifestations du mal a longtemps poussé à les associer à des monstres, diables ou divers personnages de fiction. Et à les représenter liés à des situations horribles et infernales. Ces sept péchés marqueront pendant des siècles un imaginaire catholique dominé par les idées de faute, de punition et de rédemption. La notion de “péchés capitaux” figure d’ailleurs dans tous les catéchismes, y compris dans la version 1998 due à Jean-Paul II.
Mais, aujourd’hui, qui s’en soucie encore vraiment ? Même si, sur le fond, “le mal” qu’ils représentent n’a bien sûr pas disparu. Alors, pourquoi ne pas mettre en interrelation les représentations anciennes de ces fameux péchés et leur présence dans l’imaginaire actuel ?
DEUX REPRÉSENTATIONS
Telle est l’intention de cette exposition, qui invite à confronter deux types d’illustration des péchés capitaux : celui de Pierre Bruegel l’ancien, qui vivait à Bruxelles au XVIe siècle, et celui de street arteuse et illustratrice française Amandine Urruty, née en 1982. Le premier a réalisé plusieurs séries de gravures destinées à illustrer le catéchisme catholique, et notamment les vices et les vertus. Dans ce cadre, dans la ligne des œuvres et de l’imagerie du peintre Jérôme Bosch, il a représenté en sept dessins ce que lui inspiraient les péchés capitaux. En y caricaturant avec humour les comportements du peuple de son temps, à qui les gravures s’adressaient. Sur base des dessins de Bruegel et du style de Bosch, Amandine Urruty a, elle, réalisé sept dessins sur le même thème. Elle y a actualisé les représentations des péchés en pêchant dans la culture de masse, les séries, les mangas et les vidéos, ainsi que dans les infos et les faits divers.
CONFRONTATION PASSIONNANTE
L’exposition ne possède bien sûr pas les originaux de ces œuvres, mais des reproductions de grande taille. En huit chapitres, elle aborde un à un les péchés, en illustre la présence dans des œuvres qui ont marqué le temps, ainsi que dans des objets du quotidien et des maximes populaires. Puis elle met dos à dos les dessins de Bruegel et de Urruty, en veillant à en commenter les éléments les plus signifiants. Ensuite, au visiteur d’agir. De ce parallèle surgit une confrontation passionnante, qui démontre que les formes de mauvais comportements n’ont pas quitté de monde. Elles présentent certains aspects éternels. Mais se sont aussi transformées au fil du temps. Restent-elles pour autant des “péchés” liés à une religion ? Ou le bien et le mal ne font-ils pas partie des fondements de l’identité humaine ? À chacun de méditer.
Visiter l’exposition en solitaire demande non seulement de prendre le temps de décortiquer les dessins de Bruegel et Urruty, mais aussi de lire de nombreux textes et panneaux. Pour une expérience plus dynamique, on peut se glisser dans une visite guidée. Une découverte individuelle permet par contre de mieux s’approprier le côté interactif de l’exposition, qui ne recourt pas à l’informatique. Ce qui sera surtout apprécié des plus jeunes… à condition qu’ils fassent le pas et acceptent d’entrer dans cet univers peccamineux où ils ne se retrouvent peut-être pas volontiers. Pour les y amener, de nombreuses visites sont organisées dans le cadre scolaire. Les élèves peuvent alors se déguiser et porter la toge pour partir chasser les monstres.
Alors que la vérité est devenue toute relative, et que chacun estime pouvoir s’approprier “le bien” et “le mal” à sa guise, cette exposition amène utilement à ouvrir le regard et à réfléchir. Bien au-delà de l’aspect suranné que peuvent inspirer les “péchés capitaux”.
Frédéric ANTOINE
Les 7 péchés 31/12, Centre Touristique Laine & Mode (CTLM), rue de la Chapelle 30, 4800 Verviers. Ma-Di 10-17h. Visites guidées de 14h à 15h15 lesme 21/09, 19/10 et 23/11 et de 10h à 11h15 les di 9/10 et 27/11. Inscription requise. www.expo7peches.be www.aqualaine.be
SUIVRE LA FLÈCHE ?
On est bien surpris lorsque, aux quatre coins d’une ville de Verviers pas encore remise des inondations de l’an dernier, on aperçoit des panneaux de signalisation indiquant la direction : Les 7 péchés. Il faut les suivre jusqu’aux abords de la Vesdre pour découvrir que cet intitulé mystérieux n’est pas celui d’un café, d’un cabaret-spectacle ou d’un sex-shop, mais… d’un musée. « Le découvrir » à condition d’arriver à destination, car les derniers mètres de ce jeu de piste s’avèrent subitement vierges de toute indication. Et comme on ne sait pas ce que l’on cherche, on tourne alors un peu en rond. D’autant que, sur le lieu où l’on aboutit, rien ne mentionne que se trouve un musée. Et, quand bien même le saurait-on, comment imaginer que les 7 péchés se cachent dans le Centre touristique de la laine et de la mode, lieu qui n’a, a priori, rien à voir avec la religion et le péché ? Même si le thème est bien fléché, il faut donc un peu le vouloir pour pénétrer dans la cour anonyme de cette ancienne manufacture lainière, où une permanence de l’ONE est mieux indiquée que l’entrée des expositions. Mais une fois celle-ci trouvée, les choses s’éclairent fort heureusement…