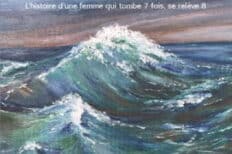Contextualiser la question de la femme en islam
Contextualiser la question de la femme en islam
La question centrale aujourd’hui, pour un islam digne du XXIe siècle, est celle de la gestion d’une tension fondamentale entre la volonté de ne pas désavouer le Coran et celle de coller à l’évidence moderne de l’égalité homme-femme.
Publié le
· Mis à jour le

femme en islamDe toutes les questions sujettes à polémique, la place des femmes en islam est certainement l’une des plus brûlantes. Le statut des femmes dans les pays à majorité musulmane n’est, pour parler avec euphémisme, pas toujours des plus enviables. Même dans nos démocraties, plusieurs crimes maladroitement dits “d’honneur” suscitent questionnements et inquiétudes.
Si les religions monothéistes n’ont jamais été avant-gardistes sur les droits des femmes (et de bien d’autres…), il semble néanmoins que l’islam soit aujourd’hui au centre des attentions. Comme souvent, entre tentatives des apologètes de justifier l’injustifiable et les assignations à résidence idéologique opérées par des islamophobes, un peu de complexité aide à voir au-delà des polémiques et des raccourcis.
CONTEXTE TRIBAL
Dans l’Arabie du VIIe siècle, la situation des femmes doit être replacée dans le contexte tribal et patriarcal prévalant à l’époque. Les sociétés étaient structurées en tribus et en clans où l’autorité revenait principalement aux hommes, surtout aux aînés. Les femmes dépendaient fortement de leur tribu et de leur clan pour leur protection et leur statut social. En somme, la seule entité sociale qui correspondait à ce que nous, aujourd’hui, nous appelons un “adulte” — c’est-à-dire un acteur libre et autonome — était l’homme.
L’islam étant né dans un tel creuset anthropologique, il ne pouvait qu’hériter, en partie, de ce patriarcat. Pour autant, on ne saurait nier quelques innovations qui peuvent sembler triviales aujourd’hui, mais qui avaient un poids réel pour l’époque. Par exemple l’égalité spirituelle décrétée par le Coran (cf. S.33 V.35), une timide ouverture vers la monogamie (cf. S.4 V.3), l’affirmation de la création de l’humain à partir d’une « essence unique » (nafs wâhida en arabe, cf. S.4 V.1), sans oublier la reprise du récit d’Adam et Ève qui semble faire porter à ces derniers une responsabilité égale de la consommation du fruit défendu (cf. S.20 V.121). Ces éléments montrent que le locuteur du Coran cherchait, a minima, à créer les conditions de rapports renouvelés entre l’homme et la femme.
MURS ANTHROPOLOGIQUES
Pour autant, ce même locuteur avait conscience des “murs anthropologiques” de sa société. En S.33 V.64, on relève chez lui une gêne réelle concernant la prostitution de femmes esclaves, qu’il cherche conséquemment à proscrire. Cependant, conscient de ne pouvoir subvertir cette pratique trop bien ancrée chez les Arabes de l’époque, le locuteur du Coran se “contente” de promettre le pardon de Dieu à celles qui seront contraintes…
La question centrale aujourd’hui, pour un islam digne du XXIe siècle, est celle de la gestion intellectuelle et spirituelle d’une tension fondamentale. Un grand écart entre, d’un côté, la volonté de ne pas désavouer le Coran — « Parole de Dieu révélée en l’état » selon certains prédicateurs — même lorsqu’il se fait l’écho d’un patriarcat aujourd’hui inaudible ; et, d’un autre côté, la volonté de coller à l’évidence moderne de l’égalité homme-femme, pas uniquement au niveau spirituel, mais à tous les niveaux.
Gageons que le futur laissera entrevoir une théologie de la révélation renouvelée, où la musulmane et le musulman moyens n’auront pas à choisir entre la Parole de Dieu et leur propre dignité.
Hicham ABDEL GAWAD, Écrivain