Nouveaux évêques : Namur et Tournai, terres de mission ?
Nouveaux évêques : Namur et Tournai, terres de mission ?
La toute récente nomination de deux évêques en Belgique illustre la représentation que le pape Léon XIV a de l’Église catholique sur le Vieux Continent, et de son souci d’en faire une terre de mission plutôt que de lui permettre de s’organiser par elle-même pour implémenter le catholicisme local dans la culture et la modernité.
Publié le
· Mis à jour le
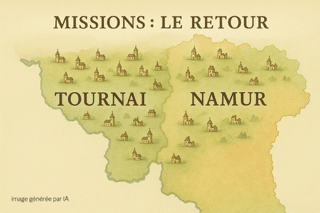
Robert F. Prevost a beau être né américain, il est d’abord un missionnaire. Religieux augustin, il a passé 18 ans au Pérou puis, après un passage par Rome, y est retourné en tant qu’évêquedeChiclayo de 2014 à 2023. C’est alors qu’il acquiert la nationalité péruvienne. Dans son homélie d’inauguration (18 mai 2025), celui qui est devenu Léon XIV met l’accent sur une Église qui sort, annonce et sert, dans la ligne d’une évangélisation proche des personnes. Un registre typiquement missionnaire.
Considérant la vieille Europe comme un continent déchristianisé, Léon XIV choisit d’y appliquer les méthodes qu’il a toujours utilisées : pour faire revenir les foules vers l’Église, il faut que, dans les pays qui ne semblent plus assez « catholiques » (ou dont le catholicisme prend quelques libertés avec la ligne officielle), remettre les choses en place en y mettant aux commandes… des missionnaires. Et non des personnalités « du terroir », issues des Églises locales, et ancrées dans les réalités complexes du monde contemporain. À l’opposé d’évêques enracinés, les missionnaires sont des envoyés, “étrangers” (dans la plupart des sens du terme) au monde dans lequel on les envoie. Ils sont “parachutés“ pour accomplir des missions (d’évangélisation) : annoncer l’Évangile, fonder ou soutenir des communautés chrétiennes…
Les deux nominations que le nouveau pape vient de faire pour les diocèses de Namur et de Tournai se situent clairement dans cette ligne.
Si Mgr Fabien Lejeusne a bien des racines tournaisiennes et n’a jamais été « missionnaire » à l’autre bout du monde, le nouvel évêque de Namura toutefois eu un parcours surtout… hors de Belgique. Le diocèse de Namur indique lui-même qu’il « n’est plus venu en Belgique depuis environ trente ans », en raison d’un itinéraire mené principalement en France (vicaire paroissial, aumônerie de jeunes/Scouts et Guides de France, direction du Pèlerinage national à Lourdes, puis supérieur provincial Europe des Assomptionnistes). Il n’a pas exercé de ministère paroissial identifié en Belgique avant sa nomination, et l’image qu’il a acquise du rôle de l’Église et de sa gouvernance laisse penser qu’elle est essentiellement inspirée du modèle du catholicisme français, dont certains pendants sont devenus de plus en plus rigoristes.
De son côté, Mgr Frédéric (Pierre) Rossignol est un « vrai » missionnaire. S’il s’est formé en Belgique (séminaire de Malines-Bruxelles et études à l’UCLouvain (philosophie, criminologie) avec une immersion ecclésialebelge pendant les années de formation), son ministère a été essentiellement exercé à l’étranger : mission au Vietnam (puis supérieur majeur de la circonscription Vietnam-Inde), passage en Bolivie, puis Rome (directeur spirituel d’un collège missionnaire pontifical). Aucune affectation paroissiale en Belgique n’est mentionnée à propos du nouvel évêque de Tournai dans les notices officielles. Ces choix mettent donc en avant des profils religieux et missionnaires plus que des curés/auxiliaires issus du terrain paroissial belge, ce que confirment les communiqués de nomination.
Ces profils sont ainsi en rupture parfaite avec l’histoire récente de ces diocèses.
À Namur, les derniers évêques étaient des prêtres diocésains, et les deux derniers avaient été évêque auxiliaire dans un diocèse. Idem à Tournai, où l’avant-dernier évêque (qui avait occupé le poste près de 30 ans) se distinguait par son ancrage local.
Les nominations indiquent aussi un changement de rythme générationnel : après des épiscopats longs et nommés à un âge plus avancé arrive une génération plus jeune susceptible d’installer une ligne sur la durée.
Mais les nouvelles nominations manifestent surtout une bascule des “diocésains” vers les “religieux”. On passe de profils administratifs/académiques à des profils missionnaires avec expérience internationale et gouvernance d’ordre. Dans une Église belge très sécularisée, le nouveau pape choisit de miser sur la l’évangélisationet, peut-être, la capacité à (re)nouer avec des publics éloignés.
La question qui se profile est celle de l’acclimatation (ou non) des nouveaux nommés à la nature de l’humus dans lequel ils ont auront à mener leur “mission” : s’adapteront-ils aux réalités d’un terrain complexe et d’une Église vieillissante dont ils ignorent beaucoup de spécificités, ou chercheront-ils à lui imposer leurs propres visions et stratégies, issues de leurs expériences passées ? Se reposeront-ils sur le public de plus en plus épars et âgé des paroisses et des unités pastorales ? Miseront-ils sur les “nouvelles communautés”, parfois plus attachées à leur identité qu’à leur implémentation dans le monde ? Ou choisiront-ils de faire fi des risques et se lanceront-ils dans un dialogue avec la société et la culture où ils “atterrissent” ? Aller vers les périphéries aura-t-il comme but de ramener les brebis qui s’y trouvent au inamovible bercail d’une Église en perte de contact avec les réalités du monde contemporain ? Est-ce de l’arrivée de missionnaires qu’a besoin l’Église catholique de Belgique, elle qui, jusqu’à présent, tente de maintenir un dialogue avec la diversité de la société belge et de sa modernité ? Comme on écrit dans ces cas-là, « seul l’avenir nous le dira »…
Frédéric Antoine, rédacteur en chef du magazine L’appel.




