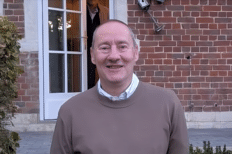Piétiner le mal en nous
Piétiner le mal en nous
Pardonner n’est pas absoudre l’injustice ; c’est affirmer que le mal n’a pas le dernier mot.
Publié le
· Mis à jour le

Dans l’iconographie bouddhique japonaise, Tamonten – gardien du Nord et l’un des Quatre Rois célestes – apparait campé sur un démon vaincu : son talon immobilise la créature, mais la lance dans sa main droite reste sous contrôle. Le démon n’est pas empalé. Cette scène subtile dit plus qu’une victoire ; elle exprime une manière de dompter le mal sans l’anéantir, de maintenir l’ombre sous le joug de la lumière, tout en lui laissant la possibilité de se convertir. Il suffit d’observer l’autre main de Tamonten : elle brandit une petite pagode, symbole du trésor spirituel et du savoir illuminant. L’ordre n’est pas assuré par la force brute ; il naît de la connaissance qui discerne, jauge et hiérarchise – bref, rend justice.
LA JUSTICE COMME UNE ÉCOUTE
La justice est aussi l’une des grandes quêtes de l’islam. Le Coran l’érige en pilier de toute foi qui se veut authentique : « Ô vous qui croyez ! Soyez fermes dans l’équité, témoins pour Dieu, fûtce contre vousmêmes. » (4 : 135) L’imagination peut se laisser tenter d’y voir un parallèle avec Tamonten. La foi se tient, tel un gardien, sur les penchants qui pourraient l’emporter vers l’injustice, mais il ne les nie pas ; il les discipline. De même que le démon n’est pas écrasé jusqu’à disparaître, l’instinct n’est pas amputé : il est redirigé, orienté, mis au service d’un ordre supérieur.
Envie de lire la suite ?
Découvrez nos offres d’abonnement…
Vous aimez le contact du papier ? Vous aimez lire directement sur Internet ? Vous aimez les deux ? Composez votre panier comme bon vous semble !