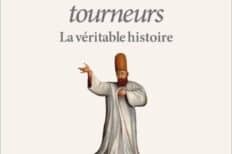Raviver la foi pascale
Raviver la foi pascale
En cette année jubilaire sur le thème de l’espérance, dans un monde travaillé par beaucoup de tensions, il est urgent de raviver notre foi pascale.
Publié le
· Mis à jour le
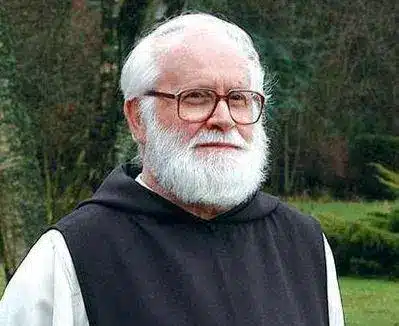
Durant la Semaine sainte de 2005, le pape Jean-Paul II, à peine sorti de la clinique Gemelli, apparaissait chaque jour à la fenêtre de son appartement au-dessus de la place Saint-Pierre, à Rome. Il était si affaibli qu’aucun son ne sortait de sa bouche lorsqu’il bénissait la foule de sa main. L’homme qui avait démontré tant de force dans un grand nombre de situations difficiles, donnait en fin de vie un puissant message de courage à travers la fidélité à sa tâche dans une faiblesse extrême.
Vingt ans plus tard, le pape François, marqué lui aussi par la maladie, conscient d’approcher la fin de son pèlerinage ici-bas, manifeste, lui aussi, un courage impressionnant dans ses messages répétés en faveur de la paix et de la dignité humaine, dans une société toujours menacée par la violence et la guerre. Le même pape François a proclamé l’année 2025 année de l’espérance, tout comme un autre de ses prédécesseurs, Benoît XVI, avait ouvert à Rome, en octobre 2012, l’année de la foi, lors du cinquantième anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II. Benoît XVI avait aussi convoqué à l’époque un synode sur la Nouvelle Évangélisation, à la conclusion duquel il invitait les pères synodaux à « raviver le feu de braise » de l’Évangile chez ceux qui avaient perdu la grande richesse de la foi – en d’autres mots, à « raviver la foi pascale ».
Envie de lire la suite ?
Découvrez nos offres d’abonnement…
Vous aimez le contact du papier ? Vous aimez lire directement sur Internet ? Vous aimez les deux ? Composez votre panier comme bon vous semble !