Bichara Khader: « Ce qui se passe à Gaza me brise le cœur »
Bichara Khader: « Ce qui se passe à Gaza me brise le cœur »
Professeur émérite à l’UCLouvain, Bichara Khader y a enseigné et dirigé le Centre d’Études et de Recherches sur le Monde arabe contemporain. Né en Palestine en 1944, il retrace son parcours et livre son regard sur la situation dramatique à Gaza et le conflit en cours dans son dernier livre, Palestine, cimetière du droit international.
Publié le
· Mis à jour le
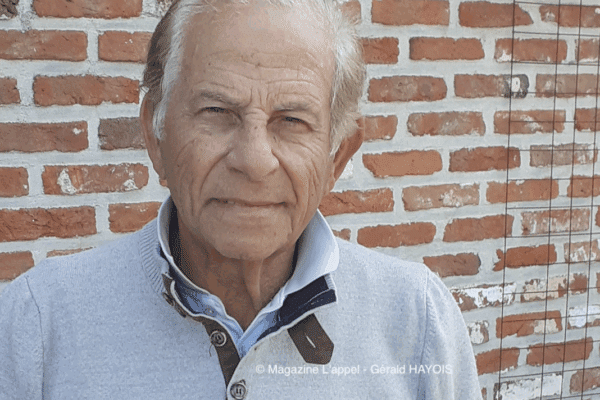
— Quel est le sentiment dominant qui vous anime aujourd’hui à propos de la guerre à Gaza ?
— Cela me brise le cœur et je trouve difficilement le sommeil. Les images projetées par les télévisions d’enfants et d’adultes palestiniens déchiquetés, blessés ou gisant sous les décombres, toute une population soumise à une famine qui n’est pas une catastrophe naturelle, mais induite par l’action des hommes, oui, constamment, ces images m’obsèdent.
— Qu’est-ce qui vous parait essentiel de comprendre sur ce qui se passe actuellement à Gaza et en Palestine ?
— Pour moi, la tragédie palestinienne n’est pas seulement ce qui se passe maintenant et l’action induite par Benyamin Netanyahou et le gouvernement actuel d’Israël, dont on dit qu’il inclut des ministres ouvertement fascistes, racistes. C’est une tragédie permanente qui dure déjà depuis plus d’un siècle, inhérente à l’idéologie même du sionisme. Dès lors que des Juifs européens ont décidé de créer un État en Palestine, pays alors habité à 95% par des Palestiniens musulmans et chrétiens et à 5% par des Juifs, c’est là que se trouve la source du problème palestinien. De nombreux dirigeants sionistes appelaient ouvertement à vider le territoire. C’est le propre du colonialisme de peuplement qui déplace la population autochtone pour la remplacer par de nouveaux colons. La particularité de ce colonialisme, c’est que les sionistes qui débarquaient en Palestine ne prétendaient pas aller chez l’autre, mais chez eux. Ils ont inventé un slogan : « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre. » La volonté de rendre invisible le peuple palestinien est à l’origine même de la tragédie. Les ministres d’extrême droite en Israël disent ouvertement qu’il n’y a pas de place sur ce territoire pour deux peuples. Pour eux, les Palestiniens doivent quitter les lieux. Un ministre israélien a dit : « Vous, Palestiniens n’avez le choix qu’entre deux options : soit rester et mourir de faim, soit partir. »Ils appellent donc ouvertement à la purification ethnique. Ce qui me brise le cœur, c’est donc quelque chose de structurel, c’est-à-dire le projet sioniste qui est toujours en cours.
« La tragédie palestinienne est inhérente à l’idéologie du sionisme »
— Vous-même êtes né en 1944 à Zababdeh, un village de Palestine…
— Zababdeh était le seul village à majorité chrétienne dans le nord de ce qu’on appelle la Cisjordanie, à quelques kilomètres de Jénine, cette ville martyrisée aujourd’hui par les incursions israéliennes. Dans mon enfance, il y avait quatre églises et deux mosquées pour environ huit cents habitants. Ma famille au sens large était une des familles chrétiennes importantes du village. Ma mère était protestante, mon père catholique, mes oncles melkites ou orthodoxes. Mon père est mort quand j’avais deux ans. Ma mère est restée avec sept enfants sur les bras. Elle a fait preuve d’une très grande résilience pour nous mener à l’âge adulte. Nous n’avons manqué de rien d’essentiel, mais sans rien de superflu. Ma famille a vécu grâce à un troupeau de chèvres qui nous a permis de subvenir à nos besoins essentiels. J’ai fait mes études à l’école paroissiale et, à 12 ans, j’ai rejoint le séminaire latin dans un village à côté de Bethléem. J’y suis resté huit ans. Je suis reconnaissant à cette école de m’avoir ouvert à la culture et aux langues occidentales, ce qui m’a beaucoup aidé dans ma carrière académique, comme historien et écrivain. Comme beaucoup de mes condisciples, je n’avais pas la vocation et ne suis dès lors pas rentré dans la vie religieuse.
— Vous êtes devenu professeur d’histoire et de géographie à Jérusalem et, en 1965, vous arrivez à l’UCL à Louvain…
— J’ai eu la chance de rencontrer une dame belge très gentille que j’avais guidée en Palestine et qui a facilité mon inscription à l’université. Je me suis intégré rapidement, connaissant déjà le français, et j’ai obtenu la licence en sciences politiques.
— Comment êtes-vous devenu professeur à l’UCL ?
— Après l’obtention de mon diplôme, je me suis rendu compte que je n’avais pas eu un seul cours sur le monde arabe, comme si celui-ci était sur une autre planète. J’ai expliqué cela au recteur, Monseigneur Massaux, et je lui ai demandé de créer un centre d’études de recherche sur le monde arabe contemporain. Il m’a donné son accord. J’ai commencé avec cinq ou six étudiants la première année et j’ai fini ma carrière avec cinq cents qui suivaient l’ensemble de mes cours. C’est ma fierté d’avoir créé ce centre qui, avec de modiques moyens, a réussi à informer les étudiants sur les réalités du monde arabe.
— L’opinion publique belge ou européenne a-t-elle une connaissance suffisante du monde arabe et de la Palestine ?
— En 1965, la majorité des Belges ignoraient presque tout de cette réalité. Il y avait quelques clichés. Très souvent, on voyait le monde arabe à travers les yeux d’Israël. On peut dire qu’alors 90% des Belges étaient favorables à cet État. Beaucoup de gens, dans les années 50 à 70, en parlaient de manière très positive, disant que sa naissance et son développement relevaient du miracle, mais ignorant pratiquement que cette naissance avait donné lieu à une persécution, une purification ethnique, un déplacement du peuple palestinien.
— Dans votre nouveau livre, Palestine, cimetière du droit international, vous expliquez cette histoire et les derniers développements tragiques du conflit…
— Aujourd’hui, beaucoup de Belges savent ce qu’est la Palestine, connaissent un peu le monde arabe. Cela ne veut pas dire qu’ils sont véritablement informés sur les enjeux et les causes profondes des turbulences actuelles, mais il y a chez eux une prise de conscience, en tout cas pour ce qui concerne la Palestine, et l’évolution de l’opinion publique est nette. C’est pour eux que j’ai écrit ce livre. Beaucoup de Belges sont aujourd’hui scandalisés par ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie. Les gens commencent à comprendre quelle est la nature coloniale de l’État d’Israël. Pourtant, s’il y a une évolution positive des opinions publiques, cela ne se traduit pas par une politique belge et européenne beaucoup plus ferme, avec des sanctions sérieuses, et pas seulement symboliques, à l’égard d’Israël.Quand je vois ce qui se passe en Ukraine et la quasi-unanimité de l’Europe à ce sujet, quand je vois comment l’Europe a commencé immédiatement à imposer à la Russie dix-sept paquets de sanctions considérant que l’agression russe est inacceptable et une violation des lois internationales, je constate que si l’Europe dit la même chose pour Israël, que son occupation est inacceptable, que sa colonisation est illégale, en même temps, il n’y a pas de sanctions véritables.
— En remontant dans votre histoire personnelle, on ne peut manquer d’évoquer l’assassinat, en 1981, de votre frère qui était le représentant de l’OLP à Bruxelles et à qui vous avez consacré en 2021 un autre livre, Lettre à mon frère Naïm…
– Cela a été un choc terrible. J’ai mis beaucoup de temps pour surmonter l’épreuve et essayer de trouver le courage et la résilience suffisante pour continuer son combat par d’autres moyens. Mes amis m’ont aidé. Le fait que la Belgique a salué sa mémoire avec beaucoup d’émotion, ce fut aussi un encouragement. Cela veut dire que ses paroles ne sont pas tombées dans le vide.J’ai ici, dans ma bibliothèque, un livre d’un ancien membre des services secrets israéliens, le Mossad, qui dit ouvertement que mon frère a été assassiné par ces services secrets parce qu’il jouait un rôle très important dans le cadre du dialogue euro-arabe et qu’il avaitrecueilli une importante sympathie chez des hommes politiques, dans la société civile et la communauté juive progressiste de Belgique où il avait des amis. Il préconisait une solution équitable pour la question palestinienne, c’est pour cela qu’il a été éliminé.
— En 2003, vous avez tenté de comprendre le traumatisme juif en allant à Auschwitz avec des Palestiniens…
— Cela a été pour moi une révélationetm’a permis de comprendre comment cet événement d’une portée colossale, cette tragédie innommable, ce traumatisme pouvait effectivement agir sur le subconscient collectif juif et israélien. J’écrivais alors que j’espérais que les Israéliens iraient aussi un jour à la rencontre de la souffrance du peuple palestinien dans les camps de réfugiés, sur le chemin de l’exil, pour comprendre comment la Nakba, la purification ethnique en Palestine où deux tiers de la population palestinienne ont été expulsés pour faire place à l’État d’Israël, continue à habiter l’esprit des Palestiniens. Cette rencontre de la souffrance palestinienne ne se fait pas encore en Israël, mais elle devra se faire.
— Un dialogue entre Israéliens et Palestiniens est-il encore possible ?
— Aujourd’hui, non. Je crois que tant que les cœurs ne sont pas apaisés, tant que le conflit continue, les traumatismes et les blessures sont encore trop béants. Assez paradoxalement, au moment où la Palestine redevient centrale dans l’agenda mondial et où tout le monde en parle, sur le terrain, elle dépérit. Ce qu’on appelle la Cisjordanie est devenue un ensemble de confettis, une série d’enclaves déconnectées, entourées par des colonies juives, séparées par des routes de contournement et par un mur qui éventre la Palestine. La Palestine est réduite à une peau de chagrin alors que la question palestinienne est au centre de l’agenda international. Toute la communauté internationale parle de la solution des deux États. Mais cette solution est actuellement une impossibilité géographique. Il y a un tel enchevêtrement des populations en Cisjordanie que cette solution ne pourra jamais s’appliquer si elle n’est pas imposée. Pendant trente ans, on a eu beaucoup de processus et peu de paix. La solution doit être imposée par le Conseil de sécurité de l’ONU, ce qui nécessite évidemment un changement profond de la politique américaine à l’égard d’Israël, mais aussi de la politique européenne.
« Le discours européen sur la Palestine est un discours creux car non suivi d’effets et de vraies sanctions à l’égard d’Israël »
— De nombreux Israéliens sont opposés au gouvernement de Netanyahou. Voyez-vous un espoir de ce côté-là ?
— Dans la situation actuelle, le camp de la paix a été laminé en Israël.Il y a quelques balbutiements. On voit maintenant de plus en plus dans les manifestations des pancartes affichant “Arrêtez la guerre, la paix, la paix”, mais ça reste un mouvement minoritaire. Pour espérer un règlement de la question palestinienne, il est primordial qu’il y ait un éveil critique, moral, éthique à l’intérieur du pays. Penser le rapport entre Israël et la Palestine sous forme de rapport de force, ça ne conduit nulle part. Israël peut engranger des victoires militaires, mais s’il ne parvient pas à remporter la seule victoire qui vaille, c’est-à-dire celle de la paix, il court un très grand danger pour sa propre existence, son image, son standing dans la communauté des nations aujourd’hui. Si Israël continue dans cette voie, il va devenir un État paria, ce que disent aussi des voies juives.
— Aux États-Unis, le récit de juifs orthodoxes et de chrétiens évangélistes ultras parle d’un peuple élu pour une terre qui leur est due. Ce récit religieux joue aussi un rôle problématique ?
— Certainement, et il existe aussi une parenté culturelle historique entre les États-Unis et Israël. Pour les Américains, condamner la colonisation d’Israël aujourd’hui, c’est condamner a posteriori celle de l’Amérique. En Europe, le soutien à Israël est probablement dû au sentiment de culpabilité suite à l’Holocauste, tandis que le soutien américain à Israël renvoie au mouvement de colonisation de peuplement. En Amérique, on a colonisé une région en déplaçant les populations autochtones. C’est ce que fait Israël aujourd’hui.
Bichara KHADER, Palestine, Cimetière du droit international, Bruxelles, Éditions SAMSA, 2025 et Lettre à mon frère Naïm, même éditeur, 2021.
Propos recueillis par Gérald HAYOIS



