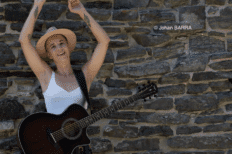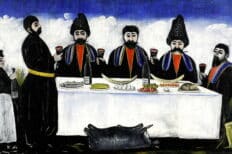Tori et Lokita: les papiers ou la vie
Tori et Lokita: les papiers ou la vie
Luc et Jean-Pierre Dardenne livrent un film saisissant sur le sort réservé aux mineurs étrangers en Belgique. Tori et Lokita, deux ados venus d’Afrique, construisent leur fraternité dans l’adversité. Mais suffira-t-elle à les sauver ?
Publié le
· Mis à jour le

Une fois encore, les deux frères liégeois ont ému la Croisette et sont revenus de Cannes avec une récompense spécialement créée pour eux : le Prix spécial du 75e festival. Leur film, Tori et Lokita, est un véritable coup de gueule contre le sort réservé aux MENA, les mineurs étrangers non accompagnés. Lokita approche de ses dix-huit ans. Si elle a déjà un corps de femme, elle a encore le sourire d’une enfant. Sa douceur, son innocence et sa générosité en font une proie de choix pour les réseaux criminels. Dans quelques mois, elle ne pourra plus bénéficier de la protection réservée aux mineurs et, si elle n’obtient pas de papiers, elle sera renvoyée dans son pays. Elle vient du Cameroun et n’a qu’un espoir : envoyer assez d’argent à sa maman pour que ses frères puissent aller à l’école.
DES PROIES FACILES
Lors de la traversée, sur le bateau, elle a rencontré Tori, un jeune garçon de onze ans qui a fui le Bénin parce qu’on le considérait comme un enfant sorcier. Dans son pays, lorsqu’un enfant est mal né, parce qu’il est venu trop tôt ou qu’il est mal formé, il est vu comme un porte-malheur pour sa famille et sa communauté. Tori a donc pu obtenir facilement des papiers qui lui accordent le droit de rester en Belgique. Ce n’est pas le cas de Lokita qui a du mal à répondre aux questions sur sa véritable identité à l’Office des étrangers.
Les deux enfants ont créé de réels liens d’entraide et de solidarité. Ils se présentent comme frère et sœur, résident dans le même centre d’accueil et dorment souvent dans le même lit, dans les bras l’un de l’autre. Lokita veille sur son frère de cœur et, pour l’aider à s’endormir, elle lui murmure une berceuse de son pays. Tori est un garçon énergique, débrouillard et parfois rusé. Il leur arrive de chanter ensemble dans un restaurant pour quelques euros. Ils aiment interpréter Alla fiera dell’est, une chanson traditionnelle italienne qu’Angelo Branduardi a rendue célèbre dans le monde entier. Cet air a été suggéré aux réalisateurs par le musicien qu’ils avaient engagé. C’est, à l’origine, une chanson d’exil. Tout un symbole pour ces deux jeunes qui ne peuvent compter que sur eux pour grandir dans ce monde qui ne veut pas d’eux. Sans papiers, pas de droit, pas de reconnaissance et pas de place dans la société.
QUI S’EN ÉMEUT ?
Le cuistot du restaurant où ils chantent les a recrutés pour revendre sa drogue. Grâce à leur jeunesse, ils passent inaperçus. Lokita veille à ce que Tori ne rate pas l’école, mais, après les cours, ils dealent jusqu’à 22h, l’heure où ils doivent être rentrés au centre d’accueil. Contre cinquante euros de plus, Lokita doit « faire des choses » au cuistot qui la font se sentir sale. Mais Tori la rassure : « Il t’a forcée, c’est lui qui est sale. » Ce qu’elle parvient à économiser, elle l’envoie à sa maman, mais elle est aussi à la merci des passeurs qui continuent de la racketter en lui réclamant sans cesse de l’argent et en lui imposant des fouilles intimes humiliantes. Lorsque l’ultime chance d’obtenir des papiers s’éloigne pour elle, elle n’a plus d’autre solution que d’entrer en clandestinité et l’étau se resserre autour d’elle.
Quand ils se sont intéressés au sort des MENA, les frères Dardenne ont découvert la solitude de ces jeunes exilés. Leurs informateurs de la police leur ont expliqué comment fonctionnent ces réseaux de grand banditisme, où la violence est de plus en plus présente et où le recours aux armes à feu n’est plus rare. Ces jeunes mineurs n’ont rien ni personne pour veiller sur eux. Beaucoup d’entre eux disparaissent, parce qu’ils parviennent à traverser la Manche ou parce qu’ils plongent dans la clandestinité à l’approche de leur majorité. Ce sont des innocents qui tombent dans un monde de brutes, complètement dépassés par ce qui leur arrive. Mais personne ne s’inquiète de leur sort.
Les réalisateurs liégeois sont convaincus que si la loi changeait, si tous les jeunes qui ont entamé un cursus scolaire ou d’apprentissage d’un travail avaient l’assurance de rester dans le pays après leurs dix-huit ans, la situation serait très différente. Ils ont d’ailleurs dédié leur prix cannois à Stéphane Ravacley, ce boulanger de Besançon qui avait fait une grève de la faim en 2021 pour soutenir son apprenti menacé d’expulsion du territoire français. Lorsqu’ils l’ont eu au téléphone après la remise du prix, ils ont appris que le jeune Guinéen est devenu boulanger à son tour et qu’il va se marier.
NATUREL CONFONDANT
Fidèles à leur style, les frères ont le don pour trouver des acteurs non professionnels et leur donner du talent. Pablo Schils est une boule de nerfs qu’il a fallu apprivoiser et Joely Mbundu souhaiterait continuer une carrière d’actrice. Au cours des cinq semaines qui ont précédé le tournage, les enfants ont appris à ne plus craindre la caméra ni d’avoir l’air bête. Finalement, ils sont d’un naturel confondant et le film y gagne en intensité.
Ce souci des plus faibles, des exclus, Luc et Jean-Pierre Dardenne en voient la source dans leur enfance et dans leur éducation. Leur père était très engagé dans l’Action catholique, et en particulier dans la société de Saint-Vincent-de-Paul. Leur maison familiale était toujours ouverte, ils ont donc baigné dans un esprit où solidarité et entraide n’étaient pas de vains mots. La lutte contre le racisme est une valeur commune héritée des Lumières et du christianisme, et ils s’étonnent de voir aujourd’hui combien ces valeurs sont malmenées en Europe.
Luc, le plus philosophe du duo, rappelle l’urgence de penser. Pour vivre ensemble, il faut être universaliste. On ne peut plus, comme cela était le cas lors de la colonisation, penser que certains êtres humains sont inférieurs à d’autres, que certains sont nés pour être les maîtres et d’autres pour devenir leurs esclaves. Pour tous les deux, la lecture de romans est ainsi essentielle, elle permet de rencontrer des expériences, des aventures humaines qu’on n’aurait jamais pu imaginer et elle force à réfléchir. Ils rappellent aussi l’importance de l’école, qui est souvent la première à proposer aux enfants ce genre d’expériences esthétiques, morales et humaines. Et à cet égard, leur cinéma est un fameux allié.
Jean BAUWIN
Tori et Lokita, film de Luc et Jean-Pierre Dardenne. En salle dès le 7/9.