Wallonie, terre pour missionnaires ?
Wallonie, terre pour missionnaires ?
La récente nomination de deux évêques en Belgique illustre la vision du nouveau pape pour l’Église catholique en Europe : en faire une terre de mission plutôt que de lui permettre de s’organiser elle-même pour ancrer le catholicisme local dans la culture et la modernité.
Publié le
· Mis à jour le
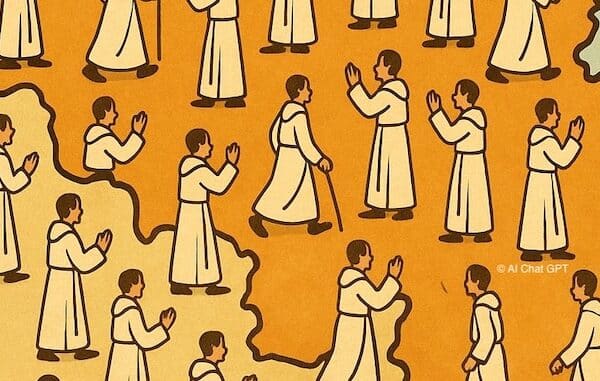
Né américain, ce pape est d’abord un missionnaire. Religieux augustin, il a passé 18 ans au Pérou avant d’y revenir comme évêque (2014-2023), après un passage à Rome, et y a acquis la nationalité. Dans son homélie d’inauguration, il a insisté sur une Église qui sort, annonce et sert, dans la ligne d’une évangélisation proche des personnes : un registre typiquement missionnaire.
Considérant la vieille Europe comme déchristianisée, il y applique les méthodes qu’il connaît : pour faire revenir les foules, il faut, dans les pays jugés insuffisamment « catholiques » (ou trop libres vis-à-vis de la ligne officielle), remettre de l’ordre en plaçant aux commandes… des missionnaires. Non des personnalités du terroir issues des Églises locales et ancrées dans les réalités contemporaines, mais des envoyés, souvent étrangers, parachutés pour annoncer l’Évangile et soutenir des communautés chrétiennes.
Les deux nominations récentes pour Namur et Tournai s’inscrivent clairement dans cette logique. D’un côté, un évêque aux racines tournaisiennes, jamais missionnaire au bout du monde, mais dont le parcours s’est déroulé presque entièrement… hors de Belgique. Le diocèse de Namur indique lui-même qu’il « n’est plus venu en Belgique depuis environ trente ans », ayant exercé surtout en France, où il a même été supérieur des Assomptionnistes), et il a intégré un modèle d’Église parfois plus rigoriste. Sans aucune affectation paroissiale en Belgique.
De l’autre, un « vrai » missionnaire, formé en Belgique, mais au ministère surtout exercé à l’étranger : Vietnam, Bolivie, puis directeur spirituel d’un collège missionnaire pontifical à Rome. Là encore, aucune affectation paroissiale en Belgique.
Ces profils rompent avec l’histoire récente des deux diocèses : à Namur comme à Tournai, les derniers évêques étaient des prêtres diocésains, et certains avaient d’abord été évêques auxiliaires. On assiste donc à un basculement des « diocésains » vers les « religieux » : on passe de profils administratifs ou académiques à des profils missionnaires, marqués par l’expérience internationale et la gouvernance d’ordre. Dans une Église belge très sécularisée, le pape mise sur l’évangélisation et la capacité à renouer avec des publics éloignés.
Ces nominations posent évidemment des questions : les nouveaux évêques s’adapteront-ils aux réalités complexes d’un terrain qu’ils connaissent mal, ou chercheront-ils à y imposer leurs visions issues d’expériences passées ? S’appuieront-ils sur le public épars et âgé des paroisses ou sur les « nouvelles communautés », parfois plus attachées à leur identité qu’à leur implantation dans le monde ? Oseront-ils dialoguer avec la société et la culture où ils arrivent ? Aller vers les périphéries aura-t-il pour but de ramener les brebis vers un bercail en perte de contact avec les réalités contemporaines ?
On peut se demander si l’Église de Belgique, qui tente de maintenir un dialogue avec la diversité de la société et sa modernité, a vraiment besoin de missionnaires…
Frédéric Antoine.




