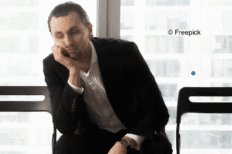La terre de Nadji Habra
La terre de Nadji Habra
Il a quitté « une dictature sans futur », s’est ébloui d’un Louvain-la-Neuve en ébullition, a planté ses racines à Namur. Naji Habra, ancien recteur de Namur, signe un livre à la croisée des identités.
Publié le
· Mis à jour le

Il sert un café bien corsé, « comme [lui] ». Naji Habra attrape un paquet de pains plats. « On le trouve dans dix magasins aujourd’hui. Avant, nulle part, et on l’appelle libanais alors que c’est aussi syrien », sourit-il. Sa maison de maître à Salzinnes, tout en longueur et en hauteur, donne sur un joli écrin de nature, au pied de la citadelle. Le portrait de son grand-oncle évêque prénommé Attala – ce qui veut dire “don de Dieu” – trône au cœur des pièces en enfilade aux côtés de mobilier syrien ancien finement sculpté et incrusté de nacre. Et puis, il y a le parc coloré de Clémence, dernière-née de ses petits-enfants.
Longtemps, Naji Habra a été le seul Syrien d’origine à Namur. Lorsqu’il a été nommé recteur de l’université, en 2017, tout ça avait changé mais, pour une série de personnes, il est devenu un symbole ou une icône qu’il n’a jamais voulu être. Le jour de son élection, un serveur dans un restaurant lui a dit : « Ça veut dire que c’est possible. » Il lui a juste fait une petite tape dans le dos. On ne l’entendra jamais parler de discrimination, comme pour trouver un logement ou un travail, avec une tête ou un nom “d’ailleurs”. L’étranger victime, c’est la posture qu’il déteste le plus. Il a quitté sa Syrie natale pour saisir sa chance. Aujourd’hui, lui, ses enfants et petits-enfants sont complètement belges. « Il y a un prix à l’intégration, il faut passer au-dessus de toutes les difficultés, tranche-t-il. Je n’ai jamais voulu voir un plafond de verre de l’Arabe. Je n’ai jamais voulu me plaindre de ségrégation. » Il a eu la gêne du prénom qu’il faut tout le temps répéter, mais on passe outre. On lui a collé l’étiquette du migrant qui réussit. Il s’est accroché à un livre Les identités meurtrières, et à un modèle qui le fascine, Amin Maalouf.
Envie de lire la suite ?
Découvrez nos offres d’abonnement…
Vous aimez le contact du papier ? Vous aimez lire directement sur Internet ? Vous aimez les deux ? Composez votre panier comme bon vous semble !